|
Paul
F. SPECKLIN
AU
FIL
D'UNE
HISTOIRE
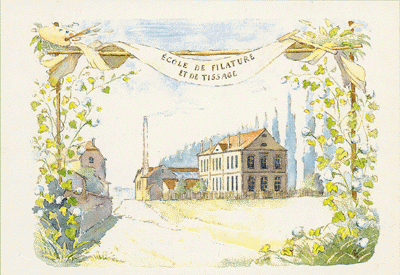
CHRONIQUE
DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
DE
L'ÉCOLE TEXTILE
DE MULHOUSE
(1896-1996)
Éditeur
: Association des Anciens Élèves de
l'Ensitm
11,
rue Alfred Werner 68200
Mulhouse

Table
des matières
Préface
Professeur
Raymond OBERLÉ
Avant-propos
René
DUC, président de l'Association
des Anciens Élèves
Le
mot du directeur
Professeur
Marc RENNER, Directeur
Introduction
Paul
SPECKLIN
Chapitre
I
Un
contexte socio-politique et économique
sinueux
11. Une
puissante mais vulnérable
industrie textile
Une
croissance fulgurante
Mulhouse
et ses manufacturiers
Au
fil des ans, des effectifs en peau
de chagrin
12.
Douloureuse rupture en 1871
L'Alsace
devenue "Reichsland"
Politique
de germanisation : suspicion et méfiance
13.
Retour dans le sein de la mère-patrie
"Dehors
les Teutons !"
Tendances
centrifuges et velléités centripètes
"Une
horrible crise économique"
"La
plus sombre période de l'histoire
de l'Alsace"
14.
Les "trente glorieuses"
et l'industrie textile
Interminable
récession
Les
vrais grands problèmes de demain
Chapitre
II
Une école en perpétuelle
adaptation
21.
Un foisonnement de l'enseignement
technique
A Mulhouse au XIX° siècle
Ailleurs en France
Des écoles textiles dans le Monde
22.
Les prémices à Mulhouse
Une école de tissage mécanique
en 1861
Une école de filature en 1864
23.
Un enseignement évolutif
Formation tous azimuts
En 1868, la nouvelle École de
Filature et de Tissage
1870 : l'élan brisé
Un
second départ
Enseignement français puis
bilingue
Des cours de perfectionnement pour
les actifs
Le cataclysme mondial de 1914-1918
Un nouveau visage : l'École Supérieure
en 1919
Cours préparatoires et de
perfectionnement
24.
Combat pour le titre d'ingénieur
De 1924 à 1937
L'enfer de la guerre de 1939-1945
Réfugiés indésirables
Annexion nazie de 1940 à 1944
Un an de flottement en 1945
25.
Vers la Nationalisation
1966 : École Supérieure des
Industries Textiles
1971 : le creux de la vague
1977 : l'Ensitm dans sa
nouvelle maison
Un rayonnement international
Formation pluridisciplinaire de
haut niveau
26.
Bâtiments et matériel
1865 : la première école textile
1977 : un bâtiment grandiose sur
le campus universitaire
27.
La grande famille des étudiants
Les fils des manufacturiers et les
autres
De tous les coins du monde
Chapitre
III
La
vie tumultueuse d'une association
centenaire
31.
Une structure et des hommes
Sur
les fonds baptismaux
Les
Statuts : pérennité et adaptation
Des
assemblées générales contrastées
Comité
et membres, actifs, honoraires et
d'honneur
Qui
sont nos Anciens ?
32.
Des activités Mulhousiennes qui perdurent
Formation
continue centenaire
Visites
d'usines instructives
Actions
sociales
Un
local pour une permanence
Un
office de placement efficace
La
convivialité par les excursions, sorties
et rallyes
Joyeux
banqueteurs
33.
Groupes régionaux : expansion et
contraction
Les
remuants Vosgiens sont les premiers
Les
Lions de Belfort en 1907
Les
tièdes Nordistes
Les
Parisiens batailleurs
34.
Les publications de l'Association
Des
Anciens peu participatifs et un gouffre
financier
Des
hommes s'engagent
Vers
un périodique d'audience internationale
Faiblesse
des moyens et évolution des besoins
Sources
et bibliographie sommaire
Publicités
De
constructeurs de Matériel Textile relevés
dans les
Bulletins
de l'Association des Anciens Élèves
de
1900 à 1905

Préface
L'enseignement
technique a obtenu tardivement droit de
cité en France. Consciente et fière de
sa culture littéraire et humaniste,
l'Université ne portait longtemps qu'un
faible intérêt aux disciplines
techniques et scientifiques. Contraint par
l'évolution de l'économie moderne et
l'influence des SAINT-SIMONIENS, il fallut
bien envisager l'organisation d'un
enseignement moderne. La presse prit
position. LE NATIONAL écrivait en 1849
"qu'au lieu d'enseigner le latin, il
vaudrait mieux constituer un enseignement
répondant aux besoins de la Société".
LA REVUE DES DEUX MONDES militait à son
tour pour une réforme de l'enseignement
(1848). Après SAVANDY, le nouveau
ministre de l'Instruction Publique,
FORTOUL, s'engagea dans une nouvelle voie.
Or,
l'initiative privée avait déjà pris les
devants à Mulhouse par la création en
1822 de la formation des chimistes destinés
à l'industrie et en ouvrant en 1860 une
École de Tissage mécanique et en 1864
une École Théorique et Pratique de
Filature dont le succès était indéniable.
Ces créations s'inscrivent, qui oserait
en douter, dans l'ensemble des
prestigieuses réalisations du patronat
libéral de Mulhouse au cours du XIXième
siècle.
Paul
SPECKLIN nous trace à travers l'histoire
de "L;Association des Anciens Élèves
de l'École textile de Mulhouse" l'évolution
et le développement de cet établissement
et de ses objectifs. Ce travail
consciencieusement préparé, riche aussi
bien d'une solide connaissance
professionnelle que de l'environnement
historique, dépasse le cadre d'une rétrospective
du passé d'une association ou d'un établissement
scolaire. C'est à tort que
l'historiographie a longtemps ignoré
l'histoire locale. M. SPECKLIN donne un démenti
patent à une attitude dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elle est réservée, de
la part de beaucoup de maîtres de la très
vieille discipline. L'auteur nous présente
la naissance d'un nouvel enseignement qui
ne peut se targuer d'une vieille expérience,
ni d'exemples à imiter. Or, les
incessants progrès techniques et
scientifiques requièrent une adaptation
continuelle donc une mobilité constante nécessitée
par les impératifs du marché et les aléas
d'événements politiques que subit
particulièrement notre région frontalière.
L'étude
de Paul SPECKLIN dépasse la dimension
d'une monographie d'un établissement
scolaire, l'auteur ne perd pas de vue le
contexte général qui encadre le sujet
traité. histoire locale s'inscrit dans
l'histoire générale qu'elle éclaire et
illustre. C'est le mérite de l'auteur et
nous lui en savons gré. C'est un travail
fondé sur des sources qui ne se contente
pas de répéter et de résumer des études
antérieures.
L'exposé concis, bien
documenté et varié par les thèmes abordés,
fait participer le lecteur à travers un
siècle à l'histoire, au développement
d'une institution qui aboutit au niveau
supérieur, à la recherche scientifique.
Le recrutement des étudiants, celui des
professeurs, nous permettent de jeter un
regard sur l'aspect sociologique, sur une
radiographie de l'établissement et sur
l'histoire de la formation des cadres
ainsi que sur l'impact des crises
internationales.
L'étude
de Paul SPECKLIN est un exemple éloquent
que l'histoire, axée sur un sujet de
prime abord secondaire, permet d'aboutir
à une histoire globale vivante et
convaincante.
Raymond
OBERLÉ
Président
d'honneur de l'Académie d'Alsace

Avant-propos
Lorsqu'arriva
le temps de célébrer le centième
anniversaire de la création de notre
Association, il nous a paru tout naturel
de mieux connaître son histoire.
Pêle-mêle,
plusieurs documents de nos archives
relataient certains faits, mais les liens
existant entre ces faits et périodes étaient
flous et ne constituaient guère plus que
des anecdotes dans le temps.
Et
puis, intimement, nous sentions bien que
la vie de l'Association était un peu le
reflet de l'existence de notre École dans
les périodes troubles qu'avait dû
traverser l'Alsace pendant ces cent dernières
années.
Pourquoi
alors ne pas demander à un historien de
se plonger dans les documents existants
aussi bien à l'Association qu'à l'École
et dans les autres centres d'archives pour
tenter de retrouver le "fil" de
l'Histoire de notre Association et de son
École.
Cet
historien, nous l'avions. Nous
connaissions sa passion de la recherche du
détail juste et piquant qui fait de
l'histoire "une" Histoire. De
plus, cet historien est ancien élève de
l'École, membre de l'Association et
Alsacien, ce qui, le lecteur le sentira
bien, est un atout maître pour mieux
comprendre les vicissitudes de la province
"ALSACE".
Nous
savons gré à notre ami et ancien élève
Paul F. SPECKLIN d'avoir accepté de mener
à bien cette étude et d'avoir, avec
habileté, par une présentation
originale, guidé le lecteur à travers le
temps en lui racontant l'histoire de
l'Association et de l'École dans le
contexte socio-politique et économique
des différentes périodes qui ont
constitué ces années passées.
Qu'il
en soit vivement remercié et
chaleureusement félicité pour ce travail
très complet et d'une haute portée
historique qui fait de cet ouvrage une véritable
histoire de notre industrie textile et des
cadres qui l'ont servie.
A
vous maintenant, cher lecteur, de vous
plonger dans la lecture de cette
merveilleuse saga.
René
DUC
Président
de l Association
des anciens élèves de l'Ensitm

Le
mot du Directeur
Plus
qu'une histoire, la chronique de
l'Association des Anciens Élèves de
l'ENSITM retrace une part de
l'Histoire, à savoir, celle, ô combien
mouvementée, de Mulhouse au cours du siècle
écoulé.
Si
cette histoire, agrémentée de
"suspens", nous permet de suivre
le projet pédagogique de l'École Textile
mulhousienne au travers des conflits et
des changements de nationalité, elle
nous montre également que l'industrie
textile a su, de tout temps, affronter
les crises économiques et s'y adapter.
Depuis ses débuts, avec l'impression
des "indiennes" dès le milieu
du XVIIIe siècle, notre industrie a
soutenu le développement régional, généré
des besoins de formation et appelé à une
forte diversification.
Si
elle apparaît totalement métamorphosée
de nos jours, avec des effectifs qui ont
fondu, l'industrie textile continue
d'innover fortement. Notre École, à
l'image de ses débuts au milieu du XIXe
siècle, répond à des besoins bien spécifiques.
C'est ainsi qu'ont été créées récemment
les options "Confection -
Habillement" et "Textiles
Techniques et Traitements" à côté
de celle plus classique de la
"Conception et Fabrication de
Produits Textiles".
L'ouvrage
de Paul F. SPECKLIN nous invite à jeter
un regard lucide vers le passé. A l'image
des expériences passionnantes d'acteurs
hors du commun, il doit nous conforter
dans notre démarche vers l'avenir de la
formation et de la profession d'ingénieur
textile.
Professeur Marc
RENNER
Directeur de l'ENSITM

Introduction
Le présent
ouvrage n'est pas une plaquette
publicitaire avec une suite de discours
dithyrambiques sur l'Association jubilaire
ou sur l'École bien plus que centenaire.
C'est une étude historique. Mais d'abord
sociale avec ses facettes économiques et
politiques, celle des hommes - qui ont des
noms -. Comportementale, en dénichant, à
l'occasion, des arrière-pensées non
inscrites dans les procès‑verbaux.
Événementielle, qui relate les faits
positifs et glorieux mais aussi les
avatars. Des esprits chagrins nous
reprocheront peut-être des interprétations
hasardeuses ou des jugements de valeur
personnels, mais existe-t-il une
objectivité historique, une neutralité?
Nous essayons néanmoins de ne pas tomber
dans le piège de la réinterprétation du
passé vécu en fonction du présent.
L'Association
des Anciens Élèves mérite bien, à
l'occasion de son Centenaire, que l'on se
penche de façon plus approfondie sur sa
longue, impétueuse et passionnante
histoire. Encore que pour l'Assemblée générale
de notre jubilaire, cet ouvrage subit un
certain retard. Mais ce ne fut pas le
premier incident de parcours de son
histoire. Déjà le dixième anniversaire
ne put être fêté en 1906 à cause du décès
du Président de l'Association et suite
aux graves troubles sociaux à Mulhouse.
Pour le quarantième anniversaire que l'on
devait marquer en 1936, on s'abstint de
lire les textes de fondation de 1896 parce
qu'ils étaient rédigés en langue
allemande. Pas de chance non plus pour le
Cinquantenaire, car en 1946, les archives
étaient à peine revenues de leur planque
dans le Lot-et-Garonne. Personne n'avait
eu le temps de les étudier pour en parler
! Et puis, en 1946, l'inauguration de la
plaque commémorative des Morts au Champ
d'Honneur était primordiale. Décidément,
notre Association et son École sont plutôt
des torrents impétueux qu'un long fleuve
tranquille !
Notre
livre n'est pas une énumération
chronologique des événements. Nous avons
privilégié la démarche thématique pour
mieux situer notre Association et l'École
dans le contexte social, politique et économique
et mettre l'accent sur les interdépendances.
Dans le premier chapitre nous essayons de
restituer les circonstances historiques et
politiques générales de la période
considérée et le milieu socio-économique
alsacien et surtout mulhousien. Le deuxième
chapitre est consacré à la raison d'être
de notre Association, la prestigieuse et
la plus ancienne École textile française
fondée à Mulhouse en 1861. Il parle également
d'autres initiatives d'enseignement
technique, européen, français,
mulhousien, de leur but et de l'évolution
de l'enseignement dispensé. Il aborde les
problèmes de son adaptation aux besoins
de l'économie et de ses risques. Il étudie
l'action de ses dirigeants qui ont porté
cette institution et de ses 5000 élèves
qui y furent formés depuis l'origine.
Quant à l'histoire de notre joyeuse
Centenaire, l'Association des Anciens,
avec ses structures permanentes et ses
multiples manifestations, ses groupes régionaux
et ses publications qui naissent, vivent
et meurent, elle fait l'objet du troisième
chapitre. De nombreuses illustrations d'époque
témoignent des étapes de la vie de l'École
et de l'Association et fixent pour
l'avenir des souvenirs du passé.
Grâce au dépouillement minutieux des
nombreuses sources, nous avons pu réaliser
ce sixième ouvrage d'histoire en quelque
huit cents heures de travail. Les rapports
publiés dans les 684 pages de registres
d'Assemblées générales et de Comité de
l'Association entre 1896 et 1954, les 252
numéros de la Revue de la Filature et du
Tissage de 1917 à 1939, les 75 numéros
des Annales Textiles de 1948 à 1972, les
50 numéros du Bulletin d'Information des
Membres de 1973 à 1996, les Annuaires des
Anciens de 1949 à 1996, les excellents
rapports publiés dans les Bulletins de la
Société Industrielle de Mulhouse
(SIM) de 1863 à 1961 et d'autres
nombreuses sources archivistiques privées
ou publiques diverses nous ont permis de
le réaliser.
Remerciements
Avant
de donner la parole à l'histoire, j'ai
l'agréable devoir de remercier tous ceux
qui m'ont encouragé, conseillé et
facilité la tâche.
J'exprime
d'abord toute ma gratitude au Professeur
émérite Raymond OBERLÉ, grand spécialiste
de l'histoire mulhousienne et notamment de
l'enseignement, qui m'a soutenu, assisté
de ses conseils et qui a bien voulu préfacer
cet ouvrage.
Un
grand merci au Président de l'Association
René DUC qui m'a encouragé à
entreprendre ce travail et a permis sa
publication. Mes remerciements vont aussi
au Comité de l'Association et spécialement
à Madame Alice GEORGER ainsi qu'à son époux;
ils m'ont facilité l'accès aux cent ans
d'archives et de revues de l'Association.
Merci
aux responsables et au personnel de
nombreuses institutions qui m'ont fourni
des informations archivistiques: la
Bibliothèque de l'Université et de la
Société Industrielle de Mulhouse, la
Bibliothèque Municipale de Mulhouse, les
Archives Municipales de Mulhouse, l'École
de Chimie de Mulhouse, les Écoles
textiles d'Épinal, de Roubaix, de
Villeneuve d'Ascq, de Lyon, de Troyes, les
Archives Municipales de Fourmies, de
Reims, de Saint Etienne, etc.
Toute
ma gratitude au Directeur de l'École, le
Professeur Marc RENNER et au personnel
administratif qui ont mis des documents à
ma disposition ainsi qu'aux Professeurs
Auguste KIRSCHNER, Richard SCHUTZ et leurs
collègues pour les compléments
d'information, les conseils prodigués et
la relecture de mon ouvrage.
Merci à notre ami
Roger GOTHSCHECK (promo 1947), artiste
peintre, qui a bien voulu illustrer la
couverture avec une aquarelle reproduisant
un ancien dessin de notre École.
Paul
SPECKLIN
(promo
1947)
Septembre
1996

Chapitre
I : un contexte socio-politique et économique
sinueux
Au XIXe siècle,
c'est par l'industrie textile et ses
activités dérivées, la chimie, le
papier peint, la construction mécanique
et le dessin avec la lithographie et la
photographie que Mulhouse et la
Haute-Alsace affirment leur suprématie.
11.
Une puissante mais vulnérable industrie
textile
En dépit des
inconvénients que présentaient Mulhouse
et sa région à l'époque, à savoir une
main-d'œuvre peu formée, un manque de
tradition locale, des matières premières
lointaines, des débouchés locaux
insuffisants, la réussite de l'industrie
textile est due à des hommes au dynamisme
extraordinaire.
Une croissance
fulgurante
Tout le monde
connaît l'histoire des trois jeunes
pionniers qui sont, en 1747, à l'origine
de l'industrie textile de Mulhouse. Samuel
KOECHLIN à 27 ans, Jean-Henri DOLLFUS à
22 ans et Jean-Jacques SCHMALTZER à 25
ans, tous apparentés à la bourgeoisie
dominante, créent la première
"indiennerie", une usine
d'impression sur tissus de coton, rue de
la Loi à Mulhouse. Notre ville compte
alors quelque 4000 habitants. Ces familles
disposant des plus grandes fortunes
mulhousiennes, nos jeunes patrons
obtiennent durant les sept premières années
des avances de 31.000 Livres tournois.
Jean-Henri DOLLFUS étant le fils du
bourgmestre, le Conseil proclame
l'indiennage "art libre", indépendant
des corporations, ce qui dispense nos
entrepreneurs de payer la taxe du
Pfundzoll durant deux ans, puis uniquement
une taxe forfaitaire annuelle de 500
Livres tournois. Quant à la main-d'oeuvre
spécialisée, dessinateurs, graveurs,
imprimeurs, etc., ils la font venir de
Neuchâtel en Suisse, plus tard d'autres régions,
notamment du pays (protestant) de Montbéliard.
Le nombre de
manufactures d'impression augmente régulièrement,
à raison d'une tous les deux ans en
moyenne, pour atteindre, 40 ans plus tard,
19 imprimeurs avec 794 tables à imprimer
sur un total de 26 fabricants de coton. Déjà
deux ans après le lancement, le total des
ventes se chiffre à près de 100.000
Livres tournois et en 1756 Mulhouse
produit 30.000 pièces de tissus imprimé,
soit 540.000 mètres. Avec la levée de la
prohibition en septembre 1759, l'essor se
confirme et s'accélère. Les grandes
fortunes (plus de 30.000 Livres)
grossissent. Si avant l'indiennage, elles
représentent, selon OBERLÉ, 41,4 % de la
masse successorale, elles atteignent vers
la fin du siècle 72,5 % de la valeur
totale des successions.
Mais la
jalousie des autres villes haut-rhinoises
et des anciennes provinces françaises ne
tardent pas à se manifester, tant au
niveau des barrières douanières et des
taxes que du trafic postal considérablement
accru. Vers la fin du XVIIIe siècle, la
conjoncture s'annonce mauvaise, les récoltes
désastreuses. La Révolution est à nos
portes, l'intégration de Mulhouse à la
France imminente. Une nouvelle époque
commence.
L'indiennage
entraîne au début du XIXe siècle la création
d'usines concentrant des moyens financiers
et humains immenses, faisant disparaître
les petits artisans fileurs et tisserands.
Des filatures de coton, telles
DOLLFUS-MIEG en 1809 à Dornach, et des
tissages mécaniques, tels Martin ZIEGLER
en 1805, etc., sont montés. C'est le début
de la puissance industrielle de Mulhouse
devenue le "Manchester français",
oeuvre d'hommes exceptionnels.

Mulhouse
et ses manufacturiers
Ces
industriels, ces "Herren
Fabrikanten", avec leur mentalité républicaine
de calviniste, leur atavisme, leur éducation
de base reçue en Suisse et leur formation
supérieure reçue à Paris, leur caractère
rude et rigoureux, leur sens du devoir
accompli, leur vie austère voire ascétique,
leur amour des sciences et des arts,
passent leur vie à l'usine, de 5 à 6 h
du matin à midi et toute l'après-midi
jusqu'à 19 heures. A l'usine, ils sont
hautains et autoritaires, davantage
craints qu'aimés, mais, au moment des élections,
ils fraternisent avec les ouvriers
catholiques. S'ils aiment gagner beaucoup
d'argent en payant, à l'instar des
patrons catholiques du Nord, des salaires
de misère, au temple, ils ont des élans
de générosité philanthropique. Le poste
de Maire et la présidence de la Chambre
de Commerce sont des droits acquis et ils
gèrent aussi bien leur ville que leurs
affaires, favorisent les actions sociales
(salles d'asile, écoles primaires et
professionnelles, cours du soir et de
manufactures, caisses d'épargne et
bureaux de bienfaisance, cités ouvrières
et églises, assistance aux femmes en
couches, etc.), les initiatives
culturelles (musées, théâtres,
associations, etc.) et le développement
économique (industries, agriculture,
routes, voies d'eau, chemin de fer,
tramway, banques, postes, transit
douanier, etc.).
Pour illustrer
ce caractère du manufacturier du XIXe siècle,
laissons la parole à deux personnalités
d'époque :
- d'une part,
au procureur général LE VIEIL DE LA
MARSONNIERE, installé à Colmar, qui écrit
après les élections de mai 1869 dans un
rapport au Ministre : "Ce monde
industriel de Mulhouse, si hautain, si dénigrant,
si infatué de son initiative, si dédaigneux
de l'action du gouvernement, ne cesse de récriminer
contre le Gouvernement Impérial de ce
qu'il n'intervient pas suffisamment dans
ses affaires"
- d'autre
part, à Gustave DOLLFUS, président de la
Société Industrielle de Mulhouse de 1864
à 1911 et premier président du Conseil
d'Administration de l'École textile,
travailleur acharné, qui note vers la fin
de sa vie dans son journal intime:
"Au pensionnat de M. DAUTHEVILLE j'ai
pris l'habitude, avant de m'endormir, de
repasser ma journée. Dois-je dire que
souvent je suis obligé de me faire de
graves reproches ? J'ai mal passé ma
journée; j'ai mal fait. Je me promets de
ne plus retomber dans les mêmes fautes;
mais hélas! les mêmes fautes se répètent,
et mon oreiller, avec lequel je suis si
intime, devait par moments se révolter.
Que n'en a-t-on qui puissent changer leurs
douces plumes en durs noyaux de pêche
!"
Mais Mulhouse,
ce n'est pas seulement les manufacturiers.
Par l'apport d'une immense masse de
main-d'œuvre non qualifiée (catholique)
abandonnant les vallées ingrates du
Sundgau et des Vosges, attirée par
l'industrie maigrement rémunératrice
pour devenir ce Fawrikervolk méprisé par
les paysans aisés, Mulhouse passe
de 7.000 habitants au début du siècle à
46.000 en 1861 et à près de 90.000 à la
fin du siècle. Sous le Second Empire, si
les ouvriers restent fidèles à
l'Empereur, la bourgeoisie par contre,
pacifiste et libérale, n'est pas
favorable à sa politique autoritaire.
L'individualisme mulhousien défend la
libre entreprise et le libre échange. En
1860, NAPOLÉON 111, pataugeant dans ses
ambiguïtés, signe un Traité de Commerce
Franco-Anglais, aux pourparlers duquel
d'ailleurs jean DOLLFUS est associé, avec
l'orgueilleuse Angleterre victorienne,
consciente de son avance industrielle, maîtresse
des mers et des marchés commerciaux. Ce
traité fait prévaloir le libre-échange
sur le protectionnisme dont la France était
le champion jusque là. Mais une grande
partie du patronat de notre secteur,
regroupé depuis 1826 au sein de la Société
Industrielle de Mulhouse, redoute cette
concurrence anglaise et réagit en développant
production, outillage et formation du
personnel. Car l'industrie textile
alsacienne ne produit que des articles
ordinaires. Son personnel, par ailleurs
travailleur et soigneux, dont 70 % sait
lire et écrire, manque d'instruction de
base technique et de connaissances
professionnelles suffisantes, notamment
depuis l'introduction dans les années
1840 des métiers à tisser mécaniques,
puis dix ans plus tard, des métiers à
filer self-acting.
C'est dans ce
contexte qu'il faut situer la fondation,
dans "la cité aux 100 cheminées"
en 1861, de l"'École Théorique et
Pratique de Tissage mécanique" puis
celle de l"'École Théorique et
Pratique de Filature", institutions
privées, initiées, financées
partiellement et régentées par la SIM
A cette initiative de la SIM, la
Municipalité de Mulhouse et la Chambre de
Commerce de Mulhouse (C.C.M.) apportent
leur appui. D'ailleurs, à la tête de
toutes ces institutions on trouve les mêmes
personnages, presque tous apparentés les
uns aux autres, de la puissante
"fabricantocratie": Nicolas
KOECHLIN, président de la SIM de 1861 à
1864, Joseph KOECHLIN-SCHLUMBERGER, maire
de 1852 à 1862 et Jules-Albert
SCHLUMBERGER, président de la CCM de1849
à 1891.

Au
fil des ans, des effectifs en peau de
chagrin
Le but de
notre étude ne consiste pas en une
analyse précise de l'évolution de
l'industrie textile alsacienne. Néanmoins
nous en donnons quelques points de repère,
bien qu'il soit difficile de comparer, sur
une longue période de plus de 120 ans,
des statistiques qui ne sont pas établies
selon les mêmes bases.
L'ensemble de
l'industrie textile du Haut-Rhin représente
au 1er janvier 1870 les chiffres suivants,
selon un rapport du Comité de mécanique
de la SIM de 1871 :
* 63.000
personnes employées
* 35 MF de
salaires annuels payés, dont
: 10
MF en filature,
17 MF en tissage,
8 MF en ennoblissement
*
1.440.000 broches filant
20.000 tonnes de filés (dont 2,65 %
exportés)
* 40.000 métiers
à tisser dont 27.000 mécaniques
produisant 172.000 km de tissus
* 210.000 km
de tissus blanchis, teints ou imprimés
(dont 9 % exportés)
Au vu de ces
chiffres, Gustave DOLLFUS conclut en 1871,
suite à l'annexion de l'Alsace par
l'Allemagne: "On voit par là combien
notre industrie aura d'efforts à faire
pour trouver de nouveaux débouchés une
fois que les livraisons en France seront
entravées par les droits de douane".
On trouve en
Annexe N° 1 la liste (non exhaustive) de
plus de 80 entreprises textiles et 20 établissements
de construction textile existant au début
du XXe siècle, lorsque l'industrie occupe
47 % de la population active du Haut-Rhin.
A noter que la S.A.C.M. à elle seule
compte à l'époque 10.000 salariés dans
ses trois usines.
Dans un exposé
publié dans le Bulletin de la Société
Industrielle de 1958 / I I, Pierre
WARNIER, président du Conseil
d'Administration de l'École Supérieure
de Filature, Tissage et Bonneterie de
Mulhouse cite les chiffres (arrondis) pour
1957 de l'industrie textile alsacienne
(les deux départements) :
* 42.000
personnes employées,
* 130.000
broches filant 44.700 tonnes de filés
coton et 7500 tonnes de filés laine (dont
45 % exportés),
* 17.300 métiers
à tisser coton (116 du matériel de la
France) tissant 28.000 tonnes de tissus
coton (dont 20 % exportés) et 1047 métiers
à tisser laine,
* 40 % des
machines à imprimer de France.
Comparons avec
1994. L'industrie textile de l'Alsace (les
2 départements) représente, selon le
Syndicat Textile d'Alsace et
l'A.S.S.E.D.I.C. (chiffres arrondis) :
* 9.500 salariés
dans 113 établissements (dont 7.650
salariés pour les 5 branches principales
(filature, tissage, ennoblissement,
bonneterie, nontissés),
* 1,4 milliards
F de masse salariale pour la filature et
le tissage,
* 13,5
milliards F de Chiffre d'Affaires dont 52
% à l'exportation,
* 44.000
broches à filer en activité filant 5.400
tonnes avec 390 personnes,
* 850 métiers
à tisser en activité produisant 10.000
tonnes avec 740 personnes,
* 37.200
tonnes livrées par la transformation avec
1310 personnes.
Mais
revenons aux premières années de
fonctionnement de notre École

12.
Douloureuse rupture en 1871
L'annexion par
l'Allemagne des trois départements de
l'Est abandonnés par un vote de l'Assemblée
Nationale française à Bordeaux en février
1871, puis ratifiée par le Traité de
Francfort du 10 mai 1871, eut des répercussions
que les gouvernants de l'époque ne
pouvaient prévoir. Si, après la débâcle
des troupes françaises, les généraux
victorieux et le peuple allemands considéraient
le "retour de cette terre
allemande" comme légitime, il n'en
fut pas de même pour les habitants de
cette province que BISMARCK baptisa
Reichsland (Terre d'Empire).
L'Alsace
devenue "Reichsland"
Selon les
historiens, un premier temps, entre 1871
et 1887, est celui de la protestation
sentimentale mais inefficace d'une forte
majorité d'habitants de notre pays annexé,
dans un réflexe induit par les milieux
intellectuels, industriels et bourgeois et
dans l'espoir d'un retour prochain d'une
France républicaine. De nombreux résidents,
notamment les cadres, fonctionnaires et
industriels, quittent le pays pour
chercher refuge et construire une nouvelle
vie en France, en Algérie voire aux États-Unis.
Ainsi dans l'arrondissement de Mulhouse,
6.738 personnes s'expatrient, soit 5,3 %
de la population, 17.000 dans tout le
Haut-Rhin. L'exode continue encore durant
de nombreuses années et on estime à
quelque 350.000 personnes le nombre
d'Alsaciens et de Lorrains ayant quitté
leur patrie.,
L'intégration
et l'assimilation des émigrés alsaciens
ne sont pas toujours une réussite,
notamment à Paris et dans nos départements
limitrophes où l'afflux est considérable
et l'accueil mal organisé. Ainsi, en mai
et juin 1883, le journal belfortain
"La
Frontière" lance une violente
campagne anti-alsacienne en relatant
"le comportement agressif des masses
ouvrières alsaciennes, ces infectes étrangers,
provoquant presque chaque
dimanche de véritables sauvageries,
chantant nuitamment le chant
national allemand dans les rues de
Belfort, mettant les paisibles habitants
au défi de
sortir, s'attaquant même au maire de
Valdoie ceint de son écharpe," etc.
Ces faits
eurent pour conséquence le renforcement
de la force publique par l'installation
d'un poste de gendarmerie à Valdoie.
En revanche,
de nombreux Allemands, notamment
administrateurs, fonctionnaires, policiers
et militaires, affluent en Alsace annexée
pour occuper les places vacantes et les
meilleurs postes, surtout dans les villes.
Ainsi on compte 20 % d'Allemands à
Mulhouse et 25 % à Strasbourg. Lorsqu'en
1874 le chancelier BISMARCK octroie aux
Alsaciens le droit d'envoyer des députés
au Reichstag à Berlin, pratiquement tous
les députés élus jusqu'en 1887,
notamment des prêtres catholiques, sont
des protestataires.
Une deuxième
période entre 1887 et 1902 est caractérisée
par la dictature prussienne, le bâton après
la carotte. Dissolution de nombreuses sociétés
alsaciennes, artistiques, littéraires,
scientifiques ou sportives. Surveillance
étroite de toutes les activités,
notamment celles de la presse et du clergé
catholique et de toutes les initiatives
associatives. En 1888 est instaurée pour
tout Alsacien voulant se rendre en France
ou inversement, l'obligation du passeport
visé par l'Ambassade d'Allemagne à
Paris. Ceci fait chuter à pratiquement zéro
le nombre d'élèves de l'École Textile
venant des départements de France
jusqu'en 1891, date de l'abolition de
cette règle. Il fallait des autorisations
pour tout, notamment pour accueillir dans
les comités
des Associations des étrangers (surtout
des Français). En 1893, le président du
Conseil
d'Administration de l'École souligne, que
"nous avons mis en lumière le
libéralisme de notre enseignement et nous
sommes parvenus à obtenir de
l'administration les tolérances nécessaires
à notre recrutement cosmopolite".
Néanmoins, encore en 1901, les autorités
infligent à quatre Français, candidats
à
l'école, des refus de séjour. Pendant
cette période pénible de suspicion et de
méfiance, les Alsaciens se replient sur
eux-mêmes tout en prenant conscience de
leurs
propres valeurs personnelles et
culturelles avec le slogan "L'Alsace
aux Alsaciens".
La troisième
période est celle d'une libéralisation
avec la levée en 1902 du paragraphe dit
de la dictature, d'une certaine
autogestion et du développement économique
et culturel. A partir de 1900, des
syndicats ouvriers se structurent et la
vie politique commence à s'animer avec
l'apparition d'une nouvelle génération
d'Alsaciens. Elle culmine en 1911 par
l'application à l'Alsace d'une nouvelle
constitution octroyant une grande
autonomie de gestion. Malheureusement, en
1914, cette expérience est
douloureusement interrompue et la guerre
fait replonger le pays dans la dictature
militaire germanique.
Nous pouvons
suivre des péripéties politiques et économiques
à travers comptes rendus des Assemblées
générales et des Comités de notre
Association. La crise économique est aiguë
dans les années 1890 et le président du
Comité de surveillance de l'École
souligne, dans son rapport de 1893, qu'il
"n'a pas voulu raconter nos luttes et
nos alarmes pour ne pas éloigner de nous
une clientèle déjà déçue". Le président
BICKING rappelle en 1898 "le rude
combat pour la survie de notre industrie
alors que dans de nombreux pays on
augmente le nombre de broches de filature
et de métiers à tisser". En 1906, -
année où un certain Auguste WICKY suit
une formation de syndicaliste à Berlin -
l'Association renonce à fêter le dixième
anniversaire de son existence à cause du
décès de son président et par suite des
grèves sévères qui perturbent la marche
des entreprises à Mulhouse.
Le président
de l'Association Albert STORCK ne pouvait
s'empêcher d'annoncer une heureuse
nouvelle à l'Assemblée Générale de
juillet 1907 : "Depuis un an,
l'industrie cotonnière se réjouit d'une
prospérité qu'on n'a plus connue depuis
30 ans". C'est la seule fois, en un
siècle, - il faut le souligner - qu'on ne
se plaint pas de la situation économique
de l'industrie textile.
Toutefois,
l'industrie européenne reste en crise
quasi-permanente. En conséquence, la sécurité
des hommes n'est pas si assurée qu'on
s'imagine. A Mulhouse même, le président
de la commission d'examen de l'École
textile depuis 1863, Henri SCHWARTZ
(1845-1895), manufacturier, est assassiné
en octobre 1895 par un ouvrier
"anarchiste déséquilibré des idées
socialistes", dans la rue de l'Espérance
entre son usine (actuelle rue SCHUMANN) et
son domicile (actuelle rue LEFEBVRE),
"le meurtrier s'étant fait justice
lui-même". En Pologne en 1907, le
licenciement d'un ouvrier suite à la
situation économique troublée a des conséquences
tragiques pour un de nos Anciens, Édouard
RAIS (promo 1894), directeur de la
filature Posznanski à Lodz qui est
assassiné par ce révolutionnaire. En
janvier1908, Aimé PETIT, un ancien élève
alsacien de 28 ans, directeur de la
Filature TERNYNCK à Roubaix, est assassiné
de plusieurs coups de couteau en rentrant
chez lui le soir.
Voici le
parfait vade-mecum du jeune diplômé,
entendu lors du discours présidentiel
s'adressant aux jeunes à l'A.G. de 1908 :
"La valeur d'un industriel, d'un
directeur, est de veiller à la
production, à la qualité des produits,
de s'entendre avec ses patrons et avec ses
ouvriers. Quant à l'ouvrier, maintenant
qu'il est syndiqué, vous ne pouvez plus
lui imposer votre volonté comme jadis, il
faut avant tout s'entendre avec lui, être
juste et poli et le respecter quand c'est
possible. Une fois que vous aurez un bon
noyau de véritables travailleurs, il vous
sera très facile d'éliminer les
non-valeurs et vous aurez une main d'œuvre
modèle". Un modèle de cadre,
"Edouard GOLDER (promo 1865/66, né
en 1836 à Dornach, mort en 1910 à
Habsheim) reçoit en juin 1908 de la
Filature Raphaël DREYFUSS à Mulhouse
qu'il a dirigée pendant 35 ans, une
montre en or et une rente appréciable à
l'occasion de son départ à la retraite
à l'âge de 70 ans. Ses contremaîtres et
ouvriers lui offrent un souvenir comme
gage de leur attachement et de leur
estime". A la même époque on
souligne "un geste remarquable de
contremaîtres et ouvriers qui offrent à
leur directeur d'une usine près de Milan
une médaille en or en souvenir de leurs
bonnes relations. Ce geste est doublement
méritoire par les temps qui courent où
les ouvriers sont si exigeants". Un
Ancien, dirigeant depuis longtemps la
Filature de Schappe à Moscou, encourage
les jeunes, à l'occasion d'un voyage à
Mulhouse en 1910, à aller travailler en
Russie dont il vante le potentiel immense.
Sur
l'importance de l'industrie textile en
Allemagne en 1910, écoutons le président
du C.A. de l'école, l'ancien député Théodore
SCHLUMBERGER: "Notre industrie
textile (de l'Allemagne) est essentielle
avec 751.000 ouvriers contre 1,2 million
pour l'industrie métallurgique, en y
ajoutant le personnel de la confection et
des industries annexes on arrive à 1,1
million. Par ailleurs, le capital investi
dans cette industrie se monte à 2
milliards de Mark".
A l'Assemblée
Générale du groupe régional de Belfort
en octobre 1910, le président FLAMAND
fait un éloge de la ville de ses études:
"Mulhouse est notre ville-phare avec
ses oeuvres philanthropiques et sociales,
scientifiques et artistiques, ses écoles
professionnelles, de commerce, de dessin,
de chimie, de filature et de tissage
servant de modèle à de nombreuses créations".

Politique
de germanisation: suspicion et méfiance
Étant donné que
le Comité de notre Association d'anciens
élèves comprenait en 1901 quatre étrangers,
deux Suisses et deux Français vivant à
Mulhouse, le secrétaire BRUGGEMANN fut
chargé de demander à la Kreisdirektion
de Mulhouse une autorisation spéciale nécessaire
à cette présence d'étrangers au sein du
bureau.
Un incident
"politique" concernant notre
Association, relaté dans les journaux en
été 1905 est évoqué au cours de
plusieurs réunions du comité. Il démontre
bien le malaise permanent régnant à l'époque.
Le journal gouvernemental
"Strassburger Post" ne rate pas
une occasion pour transformer un banal
incident en affaire politique monumentale.
Il relate qu'à Strasbourg sur la place
Broglie une Société de musique
alsacienne donnait un concert samedi après-midi,
concert qui fut perturbé
par les
prestations d'une fanfare militaire
allemande jouant au Cercle des officiers.
Les Strasbourgeois furieux protestèrent.
Le même jour eut lieu à Mulhouse une
affaire analogue au Jardin du zoo où un
concert militaire était organisé ; à
l'instant de l'exécution d'un pianissimo
de trompette, des étudiants de l'École
textile manifestèrent bruyamment en
applaudissant le discours que leur major
de promotion venait de
terminer, perturbant l'audition ; ils ne
s'étaient pas rendu compte de cette
gaffe et notre vice-président, suite à
la réclamation du directeur du restaurant
du
zoo, alla s'excuser auprès du chef
militaire allemand ; le journaliste
strasbourgeois
releva que les journaux de Mulhouse
n'avaient pas rapporté cet incident et se
demanda "l'auraient-ils fait si les
perturbateurs avaient été des
Allemands?". Cela
devint quasiment une affaire d'État dont
les quotidiens se régalèrent pendant
plusieurs jours. BRUGGEMANN, le secrétaire
(allemand) de l'Association envoya une mise
au point à la "Strassburger
Post".
Prenant la
parole au cours du banquet de l'AG de
1906, Paul SCHLUMBERGER souligne
que l'école se situe à la pointe de
toutes les écoles textiles du monde
"en dépit
des prescriptions policières allemandes
qui entravent son développement".
Autre incident
significatif au cours d'un banquet de
l'Association à l'Hôtel Central en 1908:
des petits draps tricolores piqués dans
les plats sont accueillis par des
applaudissements frénétiques et déclenchent
une vibrante Marseillaise chantée en chœur
par les Anciens. Heureusement la police
n'en eut pas vent et il n'y eut pas de
suite fâcheuse.
Au cours de
l'A.G. de 1909, le président STORCK,
suite à la demande d'un membre
"pourquoi les Alsaciens recevaient
les invitations, revues et bulletins en
langue allemande et pas en français",
répondit "qu'en Alsace la loi
prescrit d'utiliser l'allemand comme
langue d'affaires. L'Association avait
obtenu l'autorisation de diffuser les
imprimés
en français à cause du grand nombre
d'Anciens français et étrangers et du
fait que certains Anciens alsaciens ne maîtrisaient
pas la langue allemande.
D'ailleurs la traduction complique considérablement
le travail".
L'année
suivante, le président de l'Association
adjure les Anciens d'éviter, au cours
des réunions ou des banquets, les dérapages
verbaux ou les manifestations politiques
publiques qui risquent d'indisposer les
autorités allemandes et pourraient avoir
des conséquences fâcheuses pour notre
Association et surtout pour l'École.

13.
Retour au sein de la mère-patrie
Dès les
premiers mois de la guerre, le
gouvernement français déclare que son
but de guerre principal est le retour de
l'Alsace-Lorraine dans la communauté française.
En février 1915 est réunie à Paris une
conférence d'Alsace-Lorraine composée de
ténors de la politique française et de
plusieurs Alsaciens installés à Paris
depuis plus ou moins longtemps. Les
nombreuses résolutions pour l'avenir de
l'Alsace adoptées par cette instance
laissent apparaître une profonde méconnaissance
des vrais problèmes alsaciens. Un haut
fonctionnaire français n'a-t-il pas déclaré
"nous avons fermé le dossier
alsacien à la page 1871 et l'avons
rouvert à la page 1918" ? Comme si
l'Alsace avait été inexistante pendant
47 ans.
Dans ces
conditions, il n'est pas surprenant qu'à
Épinal, en octobre 1915, une réunion
de huit Anciens du groupe régional des
Vosges de notre École engage "une
discussion sur la réorganisation de l'École
et sur la transformation indispensable des
statuts de l'Association dont la plupart
des articles sont à modifier ou à
changer". Le lieutenant Henri BONDOIT
(promo 1905106, habitant à Romorantin
(Loir-et-Cher)) du 113e Rég. d'Infanterie
(Bureau du Commandant) à Chevilly
(Loiret) - fort loin des carnages de la
Marne et de la boucherie de Verdun -
soumet, dans l'édition
provisoire du Bulletin de l'Association N°
1, les réflexions sur l'avenir. Il émet
des vœux "que le fonctionnement des
groupes régionaux reprenne le plus
tôt possible, que l'exclusion de l'élément
teuton nous ramène les anciens élèves
qui ne faisaient plus ou pas encore partie
de l'Association ... Quant à
l'Association, une solution radicale paraît
s'imposer, déchirer les statuts et en
refaire des nouveaux". Voici quelques
propositions quant aux admissions et
exclusions et à la qualité des membres :
"tout ancien élève jouissant de ses
droits civils et politiques et n'ayant pas
été renvoyé de l'École pourra, sous réserve
des exceptions ci-après, faire partie de
l'Association. Nationalité: la présence
dans notre Association de membres
allemands ou austro-hongrois n'est plus
possible ; la question serait rapidement réglée
si nous ne devions nous préoccuper de nos
camarades Alsaciens-Lorrains".
Les Spinaliens
veulent distinguer plusieurs cas
"1) Les
Alsaciens nés en Alsace depuis la guerre
de 1870 de parents allemands,
2) Les
Alsaciens, nés en Alsace de parents
alsaciens, mais ayant servi pendant la
guerre actuelle avec un grade égal ou supérieur
à celui de sous-officier dans l'armée
allemande,
3) Comme
ci-dessus, mais non-gradés ou caporaux
seulement,
4) Les
Alsaciens ayant fait du service militaire
en Allemagne mais n'ayant pas combattu
dans la guerre actuelle,
5) Les
Alsaciens domiciliés en France au moment
de la mobilisation, en âge de porter les
armes et qui ont été dirigés sur les
camps de concentration,
6) Les
Alsaciens de France qui se sont engagés
dans l'armée française,
7) Les
Alsaciens qui, à la mobilisation, étaient
en Alsace ou dans les rangs allemands et
qui ont rejoint l'armée française
depuis.
Les catégories
1 et 2 seraient exclus sans discussion,
les catégories 3, 4 et 5 après enquête,
les catégories 6 et 7 admises de plein
droit".

"
Dehors les Teutons ! "
Après quatre
années d'atroce guerre, de dictature, de
privations et après l'effondrement de
l'Allemagne, les troupes françaises
victorieuses entrent à Mulhouse le 17
novembre 1918 et sont accueillies avec un
enthousiasme populaire délirant. Pour les
grands hommes politiques, cet accueil a
valeur de plébiscite. Mais à peine les
lampions éteints, des déceptions se
manifestent dans la population. Après
l'expulsion expéditive de 110.000
Allemands installés depuis 1871 en
Alsace, après le classement des habitants
en quatre catégories selon leurs
origines, on entre dans une période de
suspicion, de haine et de vengeance. Le
jacobinisme parisien et l'anticléricalisme
français multiplient les maladresses. En
raison du mécontentement, l'Alsace
conserve jusqu'en 1925 une structure spécifique.
Mais, après la victoire du Cartel des
Gauches en 1924, ces services d'Alsace et
de Lorraine à Strasbourg sont
progressivement rattachés à des ministères
siégeant à Paris et alignés sur le système
français. A ce sujet, l'historien Bernard
VOGLER écrit: "Un véritable fossé
se creuse entre le peuple et les représentants
du nouveau gouvernement, aggravé par
l'incompréhension réciproque de la
langue de l'autre et le changement des méthodes
administratives".
Notre
Association souffre également de cette
adaptation. En 1919, dix réunions de
comité très animées auxquelles
participent plusieurs délégués d'Épinal
et de Paris, et l'Assemblée Générale du
12 juillet essayent de venir à bout des
problèmes posés.
Les
Mulhousiens estiment que la classification
des camarades alsaciens proposée par les
Spinaliens est trop rigoureuse et veulent
faire juger les cas douteux de certains
Alsaciens par une sous-commission issue de
leur Comité, une espèce de commission d'épuration.
Ils protestent contre la tendance à
vouloir éliminer de l'Association une catégorie
d'Alsaciens ayant servi dans l'armée
allemande. BRUGGEMANN, l'homme-orchestre
depuis 1896, fondateur et secrétaire-trésorier
de l'Association, directeur de la Revue et
responsable du service de placement,
professeur et sous-directeur à l'École,
professeur textile à l'école de chimie,
expert textile international et patron
d'un cabinet conseil à Mulhouse, mais
d'origine allemande, est sommé de démissionner.
Il quitte Mulhouse et est remplacé
pendant un an au poste-clé de
l'Association par Robert DUBOIS, secrétaire
et futur président, auquel BRUGGEMANN
lance, avant de partir: "Soit, je
donne ma démission, mais ce sera la ruine
de l'Association". Si ce mot
"ruine" est une obsession et un
puissant stimulant pour DUBOIS dans les
moments de découragement devant la tâche
submergeante, il fallait admettre la dure
réalité et, déjà au bout de quelques
mois, répartir ces charges entre cinq
membres du Comité. Un autre ancien
professeur de l'école, né à Lörrach de
parents alsaciens, officier dans l'armée
allemande pendant la guerre et accusé
d'avoir tenu des propos hostiles à la
France, passera "une année de
purgatoire" après quoi il pourra
faire sa demande d'admission à
l'Association et profiter du service de
placement. Quant aux autres Anciens,
allemands et autrichiens, le Comité est
unanime à les éliminer en
"oubliant" de les inviter à
l'Assemblée Générale, non sans avoir
auparavant demandé conseil à un avocat
sur leurs droits éventuels.

Tendances
centrifuges et velléités centripètes
Déjà en
1897, un Ancien de l'école installé à
Épinal suggère de tenir une réunion
annuelle de l'Association à Épinal où
le président et le secrétaire de
Mulhouse seraient invités. Mais, flairant
une initiative séparatiste et redoutant
un affaiblissement de l'Association, le
Comité ne donne pas suite. Nouvelle
tendance centrifuge deux ans plus tard par
la relance de plusieurs Anciens des Vosges
pour fonder une "section française"
avec statuts propres, siège et
administration à Épinal, le Comité
central refuse encore cette initiative
mais propose la création d'un groupe régional
d'Anciens.
En été 1924,
curieuse coïncidence. C'est l'époque de
l'attaque en règle des institutions
locales de l'Alsace-Moselle par le Cartel
de la Gauche conduit par Edouard HERRIOT
qui déclenche une vraie levée en masse
du peuple alsacien menée par le clergé.
Une pétition demandant le maintien du
statut scolaire local en Alsace rassemble
335.315 signatures d'adultes soit 80 % des
familles.
A cette époque,
les délégués des Anciens de Paris
reprennent une idée émise en mars 1918
au Congrès du Génie Civil à Paris,
tendant à fonder une Fédération des
Associations des anciens élèves des écoles
textiles de France à Paris, en prélevant
un supplément de 10 F de cotisations par
membre (pour comparaison, prix d'un dîner
au Moll 15 F) et en installant un local
avec secrétariat, service de placement et
plusieurs employés à Paris. Le groupe de
Paris se dépêche de déposer des statuts
au Tribunal avant de recevoir l'accord de
Mulhouse. Le Comité de Mulhouse consacre
au cours de l'année une dizaine de réunions
à cette affaire. Les Mulhousiens,
craignant une mainmise des Parisiens sur
notre Association, s'élèvent contre
cette initiative. En décembre 1924 DUBOIS
est invité à une réunion à Paris où
des paroles offensantes sont adressées au
Comité. A Mulhouse, on ne savait pas trop
comment se tirer de ce piège: demander à
Paris de retirer les remarques blessantes,
charger un sage d'une mission de bons
offices, annuler tout ce qui a été dit
au cours des derniers mois, etc.? Toujours
est-il que le président DUBOIS offre sa démission
qui est refusée par le Comité, mais il décède
quelques semaines plus tard. Une assemblée
générale (A.G.) extraordinaire, convoquée
pour avril 1925, présidée par le vice-président,
se déroule dans une confusion houleuse.
A cette
occasion, une nouvelle initiative commune
aux délégués des groupes de Belfort, Épinal,
Lille et Paris propose la modification des
statuts de l'Association en formant pour
la gestion et l'administration de
l'Association un Comité Supérieur
uniquement composé des présidents ou délégués
des groupes régionaux, en d'autres
termes, de supprimer le Comité central
mulhousien tel que les statuts de 1896 le
prévoient. HUGELIN, ancien professeur à
l'école installé à Paris, argumente :
"Comme il y a désaccord entre la
majorité et l'organisme, un Comité supérieur
évitera que l'Association soit maintenue
en état permanent de conflit latent et déprimant".
GÉGAUFF, membre fondateur de
l'Association, ingénieur à la S.A.C.M.
et inventeur d'une peigneuse, professeur
vacataire à l'école, d'une voix de
stentor, prend position contre ces
propositions séparatistes en dénonçant
les tendances de mainmise sur
l'Association par leurs initiateurs.
Finalement la motion GÉGAUFF est adoptée
par 190 voix contre 124 sur 329 votants.
L'Assemblée Générale
ordinaire de juillet 1925 réunissant 116
membres est présidée par le secrétaire
démissionnaire jules PFLIMLIN, le Comité
central ayant donné sa démission
collective. PARRENT d'Épinal attaque :
"Avant la guerre, nous avions supporté
longtemps la tyrannie d'une Direction
imposée qui représentait pour nous
l'esprit d'Outre-Rhin. Après la guerre
notre Association aurait dû être libre,
mais le Comité central l'a mise sous la
tutelle occulte des industriels
mulhousiens et nous n'avons fait que
changer de maître". C'est le chahut
mais on n'en vient pas aux mains. Des voix
de Mulhousiens s'élèvent: "Nous,
Alsaciens, nous n'avons pas mérité de
nous faire dire des sottises de cette
sorte" - "Il est indigne que des
gens qui n'ont rien fait élèvent des
protestations". GÉGAUFF, encore lui,
tel un tribun, entraîne ses partisans,
conclut en défendant le travail du Comité
central et soumet au vote une proposition
de rejet de l'adhésion à la Fédération.
Elle est adoptée par 81 % des membres. L'Association
est sauvée.
Le calme
semblait revenu. Au Comité de janvier
1926 "on scelle l'entente unanime,
cordiale et définitive entre tous les
groupes et le Comité central, on oublie
les incidents et on ne reviendra pas sur
ces questions". Mais une lettre du
mois de juin du groupe de Paris annonce
que son Comité régional a démissionné
en bloc et un rapport d'octobre dit "étant
donné que les discussions avec le Comité
central continuent sans amener l'entente
... le président estime que le comité régional
doit démissionner".

"
Une horrible crise économique "
Si les démêlés
au sein de l'Association s'apaisent, il
n'en est pas de même en ce qui concerne
ceux de l'économie mondiale des années
1930. Dès 1929, les réunions du
Comité et les discours d'Assemblées générales
en sont de plus en plus infestés.
Plusieurs indicateurs objectifs en font
foi: les entrées à l'école tendent à
baisser, les demandes au service de
consultation technique diminuent considérablement,
les places offertes ne suffisent plus à
satisfaire les nombreuses demandes
d'emploi, des appels à l'aide pour des
Anciens nécessiteux sont présentés, les
industriels résilient les contrats de
publicité pour la revue, les membres
honoraires ne payent plus de cotisations
et les membres actifs traînent pour régler
les leurs.
Au cours de
l'A.G. 1930, le président LAUER adresse
spécialement ses conseils aux Anciens qui
enverraient leurs fils à l'école
"n'ayez pas de fausse honte à
commencer à travailler en usine comme
ouvrier, vous comprendrez mieux leurs
problèmes, puis faites pendant un certain
temps le métier de contremaître salarié
pour apprendre à commander les ouvriers
avec équité et justice, enfin vous
pourrez entrer dans l'industrie pour
gravir les échelons comme sous-directeur,
directeur et plus tard chef
d'industrie". L'année suivante, on
évoque cette "horrible crise qui
provoque le chômage en espérant qu'elle
passera rapidement". Si en 1932,
l'Association se félicite qu'un Ancien,
Alfred WALLACH (promo 1898/99, 1878-1961)
est élu député de Mulhouse et met tous
ses espoirs en lui pour défendre les intérêts
de notre industrie textile, l'année
suivante le président LAUER constate avec
amertume que "la crise n'a jamais été
aussi intense pour l'industrie textile que
pendant les deux dernières années :
fermetures d'usines, réductions d'activités,
patrons ruinés, directeurs licenciés,
impossibilité de trouver des emplois pour
les jeunes diplômés, ce qui les force à
se lancer dans d'autres branches, certains
camarades ont juste de quoi vivre
honorablement. Cette période d'attente
dictée par la situation économique et
politique a des effets néfastes". En
1934, LAUER avoue que l'année écoulée
est encore plus désastreuse que les deux
précédentes et en dénonce les causes:
"les barrières douanières que les
pays érigent coupent l'exportation, les
pays clients ne payent plus, en France une
crise de confiance diminue la
consommation, les industriels travaillent
à perte pour occuper leurs machines, les
impôts et charges sont trop lourds. Si on
ne réagit pas, nous verrons notre belle
industrie se mourir lentement". Des
remèdes sont proposés au cours de ces
discours : " ententes
professionnelles pour proportionner la
production aux besoins, mise en chômage
d'une partie du matériel, interdiction du
travail en équipe, faire pression sur le
gouvernement grâce à notre camarade député
WALLACH, et les beaux jours reviendront
... ". L'année suivante, le président
dénonce la crise de confiance et la
propagande défaitiste en se lançant dans
les incantations: "chacun doit
travailler au redressement national de
notre industrie !"
L'année 1936
marque un sommet de la crise économique
et sociale. LAUER aurait aimé, pour le
quarantième anniversaire le
l'Association, lire le procès-verbal de
la première A.G., mais comme il est rédigé
en allemand, on s'en abstient. Il enchaîne
: "Il y a un an, nous formions le vœu
pour un avenir meilleur, mais toutes nos
espérances ont été déçues.
Aujourd'hui tout va mal, l'industrie, le
commerce et l'agriculture. Les pouvoirs
publics ne protègent même plus la propriété
privée, exemple l'ignominieuse occupation
des usines de ces derniers temps. Après
la hausse des salaires qu'on nous a imposée
et qui nous ferment les débouchés
maigres à l'exportation, la loi des 40
heures nous portera le coup de grâce.
Pour parer au chômage, les pouvoirs
publics auraient depuis longtemps dû
faire une autre politique coloniale. Il
est inadmissible qu'un pays étranger
puisse nous faire concurrence sur nos
marchés coloniaux... Les convulsions
sociales doivent cesser. Il y va
actuellement de l'existence même du pays,
menacé dans ses bases morales et matérielles
par les mains criminelles d'agitateurs
professionnels inspirés par l'étranger".
En juillet 1937 on dénonce les difficultés
sans nombre: "les accords sociaux de
MATIGNON, les vacances payées, la semaine
de 40 heures, les lois d'arbitrage, la
hausse effrénée du coût de la vie,
l'impossibilité d'exporter à cause de
nos prix 20 % plus chers que ceux de l'étranger,
le chômage, les dévaluations du franc. Où
allons-nous...?" A l'Assemblée Générale
de 1938, même refrain: "lutter
contre ce régime d'instabilité qui
complique tous nos problèmes, conditionné
par notre situation politique, instabilité
de notre monnaie, des prix, des salaires,
des charges". Enfin, en 1939, les
lamentations continuent mais un orage
apocalyptique se profile à l'horizon.
LAUER : "Après un commencement de
reprise prometteur, les événements de
septembre dernier ont d'un coup de frein
brutal mis fin à cette velléité de démarrage
que les accords de Munich n'ont pas
revivifiée. La grève générale du 30
novembre a montré quand même que le pays
se ressaisissait et que les mauvais
bergers n'étaient plus écoutés comme
auparavant... les rapports entre ouvriers
et patrons sont devenus plus
cordiaux..." On dénonce les maux :
"Les grands coupables sont le manque
d'entente professionnelle - que n'a-t-on
pas suivi l'exemple de nos voisins
d'Angleterre, où, entre autres, les
filateurs se cantonnent dans la production
de quelques numéros de fil seulement, les
tisseurs dans un nombre d'articles limité"
- et les pouvoirs publics qui auraient dû
secourir notre industrie textile, imposer
des ententes dans les différentes
branches, des tarifs protecteurs, des
primes à l'exportation,... Il est vrai
que la situation politique actuelle ne
facilite pas les choses surtout dans notre
région frontière avec tous les risques
qu'elle comporte. Mais il est permis d'espérer
que l'intelligence humaine sera suffisante
pour éviter la catastrophe que serait une
nouvelle guerre avec son cortège de
ruines et de deuils". Espoirs vains !

"
La plus sombre période de l'histoire de
l'Alsace "
Les
tribulations de l'École durant l'annexion
de fait nazie entre 1940 et 1944 sont évoquées
au chapitre deux. La dernière réunion plénière
du Comité de l'Association a lieu en décembre
1939. C'est déjà la guerre et deux
membres absents du Comité sont mobilisés.
Le président LAUER signale qu'il a envoyé
les archives en lieu sûr dans le
Lot-et-Garonne et suspendu la publication
de la revue. De 1940 à 1944, deux seules
réunions plutôt clandestines d'un Comité
restreint de huit membres restés sur
place, d'autres s'étant réfugiés en
France, expédient les affaires courantes,
notamment financières (un seul procès-verbal
de la réunion de mars 1944, rédigé en
langue française, subsiste). Car les
autorités occupantes avaient suspendu
l'Association du 6 septembre 1940 au 26
juillet 1941 jusqu'au moment du paiement
de la somme de 216 RM (correspondant à
3400 F de l'époque), le compte chèque
postal ayant été confisqué par le
Stillhaltekommissar. Des contacts discrets
sont maintenus avec des Anciens du
secteur, notamment les présidents et secrétaires
des groupes de Colmar et de Strasbourg.
Après la Libération,
la première réunion du Comité a lieu le
26 avril 1945 avec les mêmes membres que
ceux des années de guerre, les autres n'étant
pas encore revenus. Autour de l'ancien
directeur Fritz ORTLIEB, le Comité
manifeste ses graves préoccupations au
sujet de l'École qui n'a pas encore
rouvert ses portes. En juin 1945, avec le
retour du président LAUER, de Paul
SCHLUMBERGER et de jean DOLLFUS du Conseil
d'Administration de l'école, on s'occupe
de la rentrée et de la réactivation de
l'Association par l'élection de nouveaux
membres au Comité, notamment de Paul
WINTER, alias Commandant DANIEL, un des
chefs de la Résistance du Haut-Rhin.
Le 20 juillet
1946, dans le grand amphi de l'école,
retrouvailles de plus de 100 Anciens pour
une triple manifestation émouvante: la
première Assemblée Générale de
l'Association après la guerre, le
Cinquantième Anniversaire de sa fondation
en 1896 (on n'a pas pu faire d'exposé
complet sur les 50 ans de l'Association,
car les registres des procès-verbaux
n'avaient été récupérés que trop récemment)
et la cérémonie du Souvenir par
l'inauguration d'une Plaque commémorative
en bronze d'une trentaine de camarades
morts au champ d'honneur, fusillés par
les Allemands ou morts dans des camps de
concentration, durant les guerres de
1914/18 et 1939/45. Plus tard, le nom d'un
jeune camarade mort durant la guerre d'Algérie
y est encore inscrit. (Néanmoins, comme
il semble que les noms de certaines
victimes ne figurent pas sur cette plaque,
il y aurait lieu de refaire une enquête
pour compléter les inscriptions).
Après le
discours inaugural du président LAUER, le
secrétaire BARTH évoque "les
souffrances et les humiliations auxquelles
les Alsaciens étaient exposées durant
l'occupation. Abandonnés à eux-mêmes,
vivant sous la menace perpétuelle de la
Gestapo, traqués sans répit, les
Alsaciens ont connu tous les stades de
l'oppression, allant de l'expulsion, la déportation,
l'enrôlement de force dans les formations
politiques et dans la Wehrmacht, par le
calvaire des camps de concentration
jusqu'aux condamnations à mort. Malgré
tout cela, et au lendemain même de la défaite,
des patriotes alsaciens s'organisaient
pour venir en aide à nos prisonniers
d'abord, aux persécutés civils ensuite.
Mulhouse fut le berceau de la plus
importante filière d'évasion
d'Alsace-Lorraine. Des milliers d'évadés
de tous les grades furent rapatriés par
la Suisse ou par Lons-le-Saunier grâce à
cette organisation. D'innombrables actes
d'héroïsme furent accomplis dans la
clandestinité accusant le plus pur désintéressement
et un esprit de sacrifice et d'abnégation
totale. Nous sommes particulièrement
fiers de compter parmi ces héros obscurs
et inconnus de la grande masse
quelques-uns des membres de notre
Association".

14.
Les "trente glorieuses" et
l'industrie textile
Durant les
premières années d'après guerre, outre
les problèmes de dévaluation et
l'augmentation galopante des prix,
salaires et cotisations, on ne relève guère,
dans les procès-verbaux et les discours
des Assemblées Générales, de préoccupations
sociales, politiques et économiques.
Par contre, à
l'école, on se plaint du trop plein. En
1949, le directeur de l'école, Victor
HILDEBRAND, signale un nombre record de
187 élèves dont 143 Français et des étrangers
de 16 nationalités. En 1950, il y a trop
de demandes d'admission et pas assez de
places à l'école, ce qui nécessite le
recours à un examen d'entrée plus sévère
et l'agrandissement des locaux. Et puis,
les problèmes d'adaptation des programmes
d'études aux nouvelles exigences se font
de plus en plus pressants. Nous en parlons
ailleurs.
Interminable
récession
Toutefois dès
1951, les soucis économiques
resurgissent. Pierre LAUER à l'A.G. 1952
: "... Les emplois disponibles sont
moins nombreux que jadis, c'est un effet
de cette malheureuse crise qui touche si
durement notre industrie, peut-être une
des plus aiguës que nous ayons connues,
partout la mévente et le chômage qui
s'en suit. Le gouvernement a bien pris les
mesures telles que fermeture des frontières
à l'importation, encouragement à
l'exportation et augmentation des
allocations de chômage... mais il
faudrait surtout que les prix baissent au
détail ...". Le placement des
sortants devient plus difficile.
"L'industrie souhaite des cadres
ayant 10 à 15 ans d'expérience. La route
s'annonce dure pour les jeunes".
Voici que réapparaissent
en 1955 de nouvelles mais passagères velléités
d'autonomie du groupe régional du Nord
"demandant que soient définis les
rapports entre le Comité central et les
groupes régionaux, que ceux-ci soient
considérés comme des Amicales autonomes
indépendantes du groupe central et que
les groupes soient consultés avant une
prise de décision du Comité
central". Mais il n'y eut pas de
suite.
A l'AG de
1955, jean DOLLFUS, président de la
SIM : "Dans la crise qui sévit si
durement, nous n'avons aucune raison de
nous montrer tant soit peu pessimistes. Le
triomphe du goût français à
l'Exposition de Bruxelles, la qualité de
la production française ... l'Europe a
montré au monde la voie à suivre ... le
jour où elle aura repris confiance en
elle‑même, notre pays se trouvera
à la tête du progrès ..." et à
l'A.G. de l'année suivante: "La S.A.C.M. n'a aucunement le projet de
sacrifier la construction de machines
textiles... Les moteurs sont dessinés et
mis au point par des Alsaciens...".
En 1957 " il s'agit de conserver à
l'École de Mulhouse qui a été la première
en France, sa situation de premier plan.
L'industrie française face au Marché
Commun, saura montrer la suprématie des
techniques françaises".
Le couplet de
la crise du textile est repris en 1959. On
constate la désaffection des jeunes pour
l'industrie textile qui rend la sélection
d'admission à l'école plus problématique.
Les moyens financiers mis à sa
disposition sur le plan de l'adaptation
rapide aux méthodes modernes sont
insuffisants. Le rattachement de l'École
à l'Éducation Nationale devrait lui
procurer les moyens nécessaires. Après
les festivités du Centenaire de l'École,
en 1961, on trouve que le rattachement de
l'École à l'Université, promis depuis
juin 1959, traîne parce qu'on met des bâtons
dans les roues en haut lieu. Mais le président
Paul WINTER souligne également que
l'Association ne montre pas assez de cohésion
pour appuyer cette démarche alors qu'elle
devrait être une "force de
frappe". En 1967, Jean OULMANN, président
de l'Association, rappelle : "pour de
nombreux camarades, le versement de la
cotisation annuelle semble constituer
l'effet libératoire par excellence.
N'appartenons-nous pas à une industrie
qu'on présente comme condamnée ? Notre
École a été présentée comme devant être
logiquement fermée. Mais notre industrie
qui continue à occuper le 2e rang des
industries françaises par l'importance
des effectifs, a besoin de dirigeants d'un
haut niveau scientifique".
Mai 1968 a
aussi influencé notre Association, ne
serait-ce quant à la date de son A.G. qui
n'a lieu qu'en octobre. OULMANN :
"Les événements de mai-juin ont eu
des répercussions profondes sur l'économie
française en général et sur l'industrie
textile en particulier. La Convention de
Grenelle, en autorisant des améliorations
substantielles de salaires a, entre
autres, introduit dans la trésorerie des
entreprises des charges telles que le
processus de restructuration et d'élimination
des entreprises marginales en ressort
grandement accéléré". Néanmoins,
en 1969, le président constate : "un
an après les événements de mai 1968, on
note qu'après quelques semaines déjà,
les carnets d'ordre se sont regarnis, les
stocks regonflés, les prix améliorés,
un certain équilibre entre l'offre et la
demande, le tout sans l'emballement
habituel au lendemain des crises. Rares
sont les entreprises qui ne connaissent
pas un niveau d'activité élevé".
Mais déjà en 1970 le président Paul
BARTH relève que les affaires marchent
moins bien à cause de l'encadrement du crédit
et de la surproduction, le marché métropolitain
étant en baisse de 15 %, l'export en
croissance de 150 à 200 %. Le vice-président
Pierre SIEGER constate en 1971 "une
évolution trop rapide de la mode qui
remonte de la rue au lieu d'être imposée
d'en haut, une absence totale du commerce
de gros qui est régulateur et qui a une répercussion
défavorable sur l'activité rationnelle
des entreprises". Toutefois,
"toutes les entreprises qui se sont
spécialisées en abandonnant aux pays
sous-développés la fabrication
d'articles très classiques jouissent
d'une situation privilégiée".

Les vrais
grands problèmes de demain
Entre-temps l'École
est entrée dans une période de
bouleversements. Au terme de plus de dix
années de longues et laborieuses négociations
avec le Ministère de l'Éducation
Nationale, l'École est transformée en École
Nationale Supérieure d'Ingénieurs
(E.N.S.I.) et intégrée dans la jeune
Université de Haute-Alsace, devenant Unité
d'Enseignement et de Recherche
Universitaire.
A l'occasion
de l'inauguration des nouveaux bâtiments
de l'Ensitm en décembre 1977,
Pierre SIEGER, président du Conseil
d'Administration et de la Société Civile
de l'École, se met à l'heure de vérité
en rappelant : "... les vrais grands
problèmes des générations à venir sont
"comment, à terme, répartir les
fruits de la croissance sur le plan
mondial et arriver ainsi à faire évoluer
l'ensemble des pays en voie de développement
vers ce mieux et plus être ?". Il
faudra être politiquement capable de dire
la vérité à nos populations
- que nous
sommes allés trop loin dans nos
exigences, limités que nous étions,
aveuglés et cristallisés dans notre
univers de pays évolués,
- que
nous vivons au-dessus de nos moyens,
- qu'il faudra
peut-être travailler plus et non moins,
gagner moins et non plus,
- que la société
d'abondance, la société de loisirs sont
des mythes...".
Dans les années
1980, l'évolution des structures de l'École
devenue composante à part entière de
l'Université de Haute-Alsace, la
restructuration des enseignements
scientifiques et techniques, le développement
des activités de recherche au sein d'un
laboratoire propre, ainsi que les actions
de coopération internationale
prennent le pas sur les préoccupations
sociales, économiques et politiques des
anciens élèves.
Au cours de
l'A.G. de 1982, alors que le directeur
Richard A. SCHUTZ souligne avec
enthousiasme "le virage des
constructeurs de machines textiles vers
l'automatisme,
la régulation
informatisée et la conception intégrée,
d'où la nécessité de formation
à l'école d'informatique utilitaire dans
une nouvelle salle d'informatique avec
huit consoles
utilisables en libre service", le président
René DUC rappelle que "sur le
plan économique de la France, le bilan
n'est pas très brillant: déficit de la
balance
commerciale, aggravation du chômage,
diminution du pouvoir d'achat,
augmentation des charges des entreprises,
dépôt de bilan qui plane sur la
S.A.C.M.". Et en 1983,
"force est bien de constater un décalage
croissant dans notre pays entre les
espoirs
et les réalisations, il y a deux ans, on
croyait à la relance, aujourd'hui le
temps de
la rigueur a sonné, l'économie française
est en récession". R. SCHUTZ publie
dans
le B.I.M. de janvier 1984 une remarquable
étude de 4 pages sur la robotique en
posant la question : "A la limite, la
robotique conduit à la suppression des
conducteurs de machine, est‑ce un
bien absolu?" Si on parle de
l'affranchissement de l'intervention
humaine, on n'évoque pas le chômage qui
pourrait en découler.
En 1990, le président
DUC constate : "l'école se porte
bien, les élèves se placent facilement,
l'industrie demande de plus en plus d'ingénieurs,
face à cela, les gros titres de la presse
n'engendrent pas l'euphorie "filature
en déprime, le coton ne tient pas le bon
fil"... ". Cette campagne de dénigrement
de la presse à l'égard du textile et du
métier d'ingénieur, en général,
n'incite guerre les jeunes bacheliers à
poursuivre des études
supérieures, le diplôme n'étant plus
synonyme d'emploi. En 1993,
l'Ensitm, à l'instar des autres écoles
textiles françaises, constate une baisse
significative des flux d'entrée. A l'A.G.
de 1994, le directeur Auguste KIRSCHNER
fait le
point : "L'Ensitm subit à son
tour le contre-coup de la crise économique.
A la rentrée 1993 nous n'avons accueilli
qu'une trentaine d'élèves en première
année contre
40 en 1992. Ce n'est certes pas le moment
de céder au défaitisme alors que la
qualité de la formation dispensée par
l'Ensitm tant sur le plan
scientifique que technologique est
reconnue au plus haut niveau et son
rayonnement cité en exemple".
Effectivement, grâce à une stratégie de
recrutement plus directe, à une refonte
des
programmes d'enseignement alliée à un
projet de diversification des filières et
une nouvelle stratégie de synergie avec
les forces vives de l'Université de
Haute-Alsace dans le domaine de la mécanique,
la crise de recrutement n'est bientôt
plus qu'un mauvais souvenir. Dès la rentrée
1994, les effectifs de première année
remontent à
43 élèves, l'année suivante
à un chiffre record de 48 élèves. Ces résultats
justifient
un nouveau projet d'extension de 2000 m2
des bâtiments de l'École. Sa population
estudiantine, toutes filières confondues,
atteint alors 250 élèves.
*
*
*
Inséparables
les uns des autres, les événements
politiques et socio-économiques de plus
d'un siècle d'histoire alsacienne ont
marqué profondément la vie de notre École,
vue à travers les états d'âme des
Anciens.
Limage
permanente véhiculée par l'industrie
textile, puissante et omniprésente au
XIXe siècle, est celle de crise et de récession.
Une exception en 1907 où l'on se réjouit
d'une prospérité qu'elle n'a jamais
connue depuis 30 ans. Pour les Anciens,
les fauteurs de la crise de 1929 à 1939
sont bien définis et dénoncés, en
l'occurrence, le gouvernement. La crise
textile, interminable, continue à sévir
à partir des années 1950, en dépit des
bonnes mesures gouvernementales...
Quant
à la conjoncture politique, elle est
particulière à l'Alsace, province
convoitée entre deux puissants États.
Après 1871, la politique de
germanisation, émaillée de nombreux
incidents, entrave le fonctionnement et le
développement de l'École. Toutefois, la
politique d'assimilation française
instaurée après 1918 ne fut pas moins aléatoire,
déclenchant des tentatives d'ostracisme
et de mainmise. La période d'annexion
nazie n'est en rien comparable aux autres
époques. Depuis 1945 la vie politique
n'est plus évoquée dans les procès-verbaux,
sauf en mai 1968. Un temps de sérénité
permet d'envisager les problèmes
d'adaptation au futur.

Chapitre
II : une école en perpétuelle adaptation
L'histoire de notre vieille École, contrairement à
celle de l Association, a fait l'objet de
plusieurs publications relatant son
développement, notamment un luxueux livre
de
120 pages édité en 1961 à l'occasion de son
Centenaire, une plaquette de 50 pages
éditée en 1982 et un bref Historique de
l'École
rédigé sur deux pages, actualisé par
ses Directeurs et inséré dans les Annuaires des
Anciens. Même si nous puisons d'intéressants renseignements dans ces publications,
nous estimons qu'il est néanmoins
utile à la connaissance de l'histoire de compléter
ces informations par des faits relevés dans les archives de la Société
Industrielle de Mulhouse et dans les procès-verbaux
de l'Association et complétés par des anciens
directeurs.
Comme nous l'avons vu, c'est la convergence de
trois facteurs, le besoin d'une main-d'œuvre
mieux formée, la
constatation du manque de cadres qualifiés
dans l'industrie textile alsacienne et la
signature d'un Traité de commerce entre
la France et l'Angleterre supprimant la
prohibition, qui incita les industriels
mulhousiens à fonder en 1861 une
"École Pratique et Théorique de Tissage
Mécanique".
La Société Industrielle de Mulhouse fondée la
veille de Noël 1825 par vingt-deux
manufacturiers du secteur de Mulhouse et déclarée
d'utilité publique par décret royal en
1832, se préoccupait du développement de
la région, de son industrie mais aussi
d'institutions sociales et d'instruction.
21.
Un foisonnement de l'enseignement
technique
Depuis
des lustres, la SIM, emboîtant le pas aux
édiles mulhousiens, se souciait de la
formation de base mais aussi
professionnelle de la jeunesse par la création
de nombreuses écoles professionnelles spécialisées
et secondaires, dont voici quelques
exemples de réalisations.
A Mulhouse au XIX ° siècle
Collège
Municipal de Mulhouse : existait de 1812 à
187, formation en latin, français,
dessin, statistiques commerciales, hygiène
élémentaire; frais d'écolage 12 F par
an, 15 F avec le latin; en 1822, il
comptait 4 classes avec l'enseignement de
français, latin, grec, allemand,
religion, géographie, histoire, histoire
naturelle, calcul, mathématique,
physique, écriture, dessin, chant ; en
1831 on cherchait à se rapprocher de
l'organisation des lycées; à partir de
1849, les programmes furent conformes à
ceux des lycées de l'enseignement
secondaire.
École de Chimie : fondée en 1822 pour dispenser
des "cours de chimie appliquée aux
arts" au laboratoire du Collège
municipal, dirigée par DEGENNE, ancien élève
de l'École Normale Supérieure, puis en
1825 par le Dr. Achille PENOT, originaire
de Nîmes, elle devint en 1871 École Municipale de Chimie Industrielle. En 1879
le nouveau bâtiment du Quai du Fossé accueillait
l'École dirigée par Emilio NOELTING (1851-1922) qui fut expulsé par les
Allemands en 1915. Érigée en École Supérieure
de Chimie en 1930, elle fut rattachée à
l'Université de Strasbourg en 1957 pour
devenir École Nationale Supérieure et
jouir d'un prestige international.
École de Dessin et de Gravure : fondée par la SIM
en 1829 et installée à la Porte Haute en
1853. Les cours d'abord payants pendant de
longues années étaient gratuits à
partir de 1868 grâce aux dons de H.
HAEFFELY En 1899, l'École dirigée par
GLEHN avec le professeur de dessin ROEDER,
comptait 174 élèves exécutant 2500
dessins.
École Israélite d'Arts et de Métiers : fondée
en 1842 pour la jeunesse israélite de
Mulhouse, elle comptait trois ans d'études
en internat complet.
École des Sciences Appliquées : ouverte en 1855
dans les locaux de l'École professionnelle et de
l'École de Dessin de
la rue Huguenin avec un programme se
rapprochant de la licence ès-sciences,
elle fut dirigée par PENOT jusqu'en 1870
où elle fut fermée.
École Professionnelle de l'Est : érigée en 1854
à l'initiative de l'État sur proposition
du Recteur de l'Académie de Strasbourg à
titre expérimental à Mulhouse et dirigée
par Paul SCHUTZENBERGER, elle
"distribue l'instruction aux enfants
de la classe ouvrière destinée à compléter
leur éducation par l'apprentissage d'un métier".
Elle devint Gewerbeschule en 1872 et fut
dirigée par le Dr. CHERBULIEZ (d'origine
suisse) de 1872 à 1898. Étude des langues
vivantes et sciences exactes, travaux
manuels et de laboratoire, préparation
aux carrières de l'industrie et du
commerce.
École Supérieure de Commerce : fondée en 1866 à
Mulhouse (avec une dotation de 100.000 F
de Jules et Jacques SIEGFRIED) organisée
selon le modèle de l'Institut supérieur
de Commerce d'Anvers, elle fonctionnait
jusqu'en juillet 1872. On y étudiait en
deux ans : langues (anglais, allemand,
italien, espagnol), calligraphie, histoire
commerciale et géographie, législation
et économie commerciales, arithmétique
sociale et comptabilité. Frais d'écolage
600 F par an. Entre 1866 et 1872 l'école
avait formé 174 élèves. Par suite de
l'annexion, le directeur PENOT et
l'ensemble du corps professoral avec la
presque totalité des élèves venant de
France, quittèrent Mulhouse pour Lyon en
1872. Le Dr. PENOT ouvrit dans cette ville
avec l'appui de la Chambre de Commerce de
Lyon une École supérieure de Commerce et
de Tissage, selon le modèle mulhousien.
École technique des Apprentis : fondée en 1899 à
l'initiative des industriels mulhousiens
et de la Municipalité, elle formait en 3
ans des jeunes pour la construction mécanique
;
vers 1900 une collaboration avec l'École
de Filature et de Tissage permit une
meilleure préparation de certains jeunes
qui voulaient entrer à l'École textile.

Ailleurs en France
Avec les avancées de la science et les multiples
inventions techniques dans l'Europe du XIX°
siècle, la formation se développe
partout, répondant à un ardent besoin.
Dans son rapport de fin 1900 à la SIM, le président
du Comité d'Administration de l'École de
filature et de tissage de Mulhouse
constatait que "les écoles
d'enseignement textile se multiplient
autour de nous: Lyon, Saint-Etienne, Reims, Roubaix,
Tourcoing, Fourmies, Flers, une école en
formation à Épinal". Certaines de
ces écoles subsistent toujours.
De nombreuses institutions continuent à
dispenser, encore en 1980, un enseignement
textile de niveau C.A.P., B.E.P., B.T.S.,
etc... à
Lyon, Villeneuve d'Ascq, Caudry, Roanne,
Rouen, Castres, Lavelanet,
Roche-la-Molière,
La-Tour-du-Pin,
Troyes, etc. Pour quelques villes, nous
avons pu trouver dans les archives
municipales ou dans des revues textiles
des traces d'écoles textiles disparues.
Ainsi, une école textile fonctionnait à
Reims en 1895. A Fourmies, la Société
Industrielle avait créé en 1885 une École
de Peignage, Filature et Tissage.
Devenant en 1892 l'École Pratique de
Commerce et d'Industrie, elle dispensait
des cours du soir pour former des générations
de techniciens de filature et de tissage.
A Saint-Étienne une École Nationale
Professionnelle fut fondée en 1882 où
l'on enseignait, entre autres,
"l'analyse et la contexture des
tissus, quelques façonnés, le Jacquard,
la mise en carte et le lisage", matières
ayant été enseignées depuis 1874 en
cours du jour ou du soir à l'École de
Fabrique de l'École Municipale de dessin
de cette ville. A Flers (Orne) une École Industrielle est créée en 1872 par
ARMBRUSTER, un ancien élève et ancien
sous-directeur de l'École de Mulhouse, aidé
en 1903 par le professeur Emannuel
TOUSSAINT, un autre ancien de Mulhouse
(promo 1888). L'École de Flers dispense en
un ou deux ans un enseignement en tissage
et fabrication des tissus, complété éventuellement
par le blanchiment et la teinture et un
enseignement théorique de la filature.
Les élèves se recrutent dans toute la
France, en Suisse et en Italie. En 1889 la
Chambre de Commerce de Tourcoing et un
syndicat d'industriels et de négociants
fondent l'École Industrielle de Tourcoing
dispensant en deux ans un enseignement théorique
et pratique en filature de coton, peignage
et filature de laine, tissage mécanique
et à la main, mécanique, dessin, électricité
et comptabilité.
De prestigieuses écoles textiles françaises,
dont voici un bref historique, offrent
encore aujourd'hui une formation supérieure.
École Nationale Supérieure des Arts et
Industries Textiles (E.N.S.A.I.T.) à Roubaix.
La Municipalité de Roubaix envisageait dès
1876 la création d'une École d'art et de
textile avec le concours de l'État.
Officiellement créée par une loi d'août
1881 et une convention bilatérale de 1882
entre la ville et l'État, l'école ouvrit
ses portes en 1889 avec le nom d'École
Nationale des Arts Industriels qui devint
en 1921 École Nationale Supérieure des
Arts et Industries Textiles. En 1926, elle
fut rattachée à la Direction de
l'Enseignement Technique et divisée en
trois sections: l'enseignement de l'art
avec la peinture, l'architecture et la
sculpture, l'enseignement préparatoire au
génie civil, l'enseignement technologique
des industries textiles (filature,
tissage, teinture, impression et apprêts).
Elle formait le personnel de maîtrise et
d'encadrement. L'école fut autorisée à
délivrer le diplôme d'ingénieur à
partir de 1947 et a formé un millier
d'ingénieurs E.N.S.A.I.T. jusqu'à ce jour.
École Supérieure des Industries Textiles de l'Est à Épinal
(E.S.I.T.E.). Dès 1875, l'idée
de fonder un cours de filature et de
tissage à Épinal germa dans les esprits
des industriels de l'Est, notamment ceux
qui avaient quitté l'Alsace pour des
raisons politiques quand elle est devenue allemande en 1871.
Mais la création définitive ne fut décidée
qu'en 1903 à l'initiative du Président
du Syndicat Cotonnier de l'Est, Georges
JUILLARD-HARTMANN (un Ancien de l'École de Mulhouse, promo 1865) et avec
le soutien de la Ville d'Épinal et de sa
Chambre de Commerce. La première rentrée
de cette École, rattachée à l'École
Industrielle des Vosges à peine créée
également, eut lieu en octobre 1905. En
1913 l'École baptisée École de Filature
et Tissage de l'Est et dirigée par Xavier
HUGUENY, un ancien élève de l'École de
Mulhouse qui y fut également professeur
pendant quelques années, s'installa dans
de nouveaux locaux de la rue d'Alsace
construits à cet effet. Elle s'appellera
en 1922 École Supérieure de Filature et
de Tissage de l'Est, puis, après la création
en 1952 d'une section d'ingénieurs, École
Supérieure des Industries Textiles de
l'Est à partir de 1980. Formant des B.T.S.
Techniques du textile, des B.T.S. Techniques
de la confection et des Ingénieurs, l'E.S.I.T.E. décerna pour la première fois en
1996, dans le cadre de l'Institut National
Polytechnique de Lorraine, le label d'ingénieur
européen junior à certains de ses ingénieurs.
Institut Textile et Chimique de Lyon (I.T.E.C.H.). Né
de la longue et brillante tradition de la
soierie lyonnaise, un cours de théorie de
tissage fut dispensé dès 1840 par le
professeur AUDIBERT au Palais des Arts à
Lyon. En 1884 la ville créa l'École
Municipale de Tissage qui, à partir de
1905, alors dirigée par Félix GUICHERD,
fils de canut, atteignit une réputation
mondiale en tissage. Installée en 1933
dans de nouveaux locaux sur la colline de
la Croix-Rousse, l'École devint en
1984 École Supérieure des Industries
Textiles de Lyon et fusionna en 1988 avec
l'École Supérieure du Cuir et des
Peintures, Encres et Adhésifs, issue
elle-même de l'École Française de
Tannerie datant de 1889, pour devenir l'I.T.E.C.H.
École Supérieure des Techniques Industrielles et
des Textiles (E.S.T.I.T.) à Villeneuve d'Ascq
(Nord), anciennement Institut Technique
Roubaisien (I.T.R.), fut créé et dirigé en
1895 par le Chanoine Henri Philomène
VASSART (1840- 1916) dans le but
de "former pour la direction des
usines dans les différentes branches de
l'industrie textile, des hommes de devoir,
de justice, de travail et de progrès".
Entre 1930 et 1935, le niveau de formation
scientifique fut relevé pour aboutir au
diplôme d'ingénieur textile I.T.R., parallèlement
à une formation de techniciens supérieurs.
En 1956, la durée de formation passait à
4 ans. L'I.T.R. dirigé par des prêtres
jusqu'en 1969, rejoignit entre 1960 et
1966, les autres grandes écoles de
l'Université catholique de Lille et en
1967, l'I.T.R. est membre fondateur du
Polytechnicum de Lille. La formation de
l'ingénieur I.T.R. passait à 5 ans avec 2
options, Mécanique ou Chimie Textile, et
celle du Technicien Supérieur à 2 ans.
En 1982 l'I.T.R. quitta Roubaix pour
s'implanter à Villeneuve d'Ascq et
s'appeler E.S.T.I.T. De nouvelles options
furent proposées aux étudiants:
Automatisme et Informatique, puis en 1994,
Développement Industriel mettant l'accent
sur la dimension commerciale. Cette École
a formé depuis sa fondation près de 5000
diplômés et actuellement elle forme 60
ingénieurs et techniciens par an, dont 35
% viennent de la Région Nord-Pas
de Calais et quelques % de l'étranger.

Des écoles textiles dans le Monde
Dans le domaine de l'instruction professionnelle
du tissage, de la filature, de la
teinture, du dessin, de la mécanique,
etc..., c'est encore l'Angleterre qui avait
pris au XIXe siècle une longueur d'avance sur les pays du
continent européen. Des écoles textiles
furent ainsi créées à Bradford, Leeds,
Glasgow, Keighley, Huddersfield (1880),
Manchester, etc... dans le Lancashire et le
Yorkshire, des écoles polytechniques à
Kensington près de Londres, etc.
Aux États-Unis, on trouve des prémices
d'enseignement textile dès 1832 à
Clemson. De grandes et belles écoles
techniques à Boston, Philadelphie, etc.
forment des ingénieurs et des mécaniciens.
C'est en 1855 que fut créée l'École de Tissage
de Reutlingen à laquelle on adjoignit un
atelier de tissage mécanique en 1862.
Dispensant à certains élèves le titre
d'ingénieur textile à partir de 1941, l'École se développe considérablement
pour atteindre des effectifs de 750 élèves
dans les années 1955 avant de subir la récession
générale de l'industrie textile. Dans
les années 1990, elle devient École Supérieure
Economique et Technique avec onze filières
professionnelles, dont une textile, et
forme près de 3000 étudiants.
Dans le cadre de l'École Polytechnique de Zurich
(E.T.H.) fondée en 1855, fut créé en 1931
un Institut pour l'Industrie Textile et la
Construction de Matériel Textile dirigé
par HONEGGER. A Wattwil (Canton de Saint
Gall) fut fondée en 1881 une École de
Tissage à laquelle on adjoignit en 1948
une École de Filature; elle absorba les écoles
textiles de Saint Gall et de Zurich pour
devenir en 1973 École Suisse de Textile,
Habillement et Mode (S.T.F.) qui forme des
techniciens supérieurs en 2 à 3 ans.
D'autres écoles textiles en Europe forment des
cadres pour l'industrie textile : en Italie
à Milan et à Côme, en Belgique à
Verviers (1894), en Allemagne à Aachen, Mönchengladbach, etc.

22. Les
prémices à Mulhouse
Notre industrie textile alsacienne risquait d'être
placée dans une situation critique
comparativement à nos principaux
concurrents anglais. A la pointe du progrès,
tant dans l'innovation du matériel que
dans la production de tissus élaborés et
dans la formation de l'encadrement, les
Anglais nous étaient largement supérieurs
en création, en qualité et en rendement.
Il fallait réagir et rapidement.
Une École de tissage mécanique en 1861
Aussi, le 13 juillet 1861, le président de la SIM, Nicolas KOECHLIN adresse à tous les
industriels de la région un appel qui
expose, avec le projet de création d'une
École de tissage, les services que l'on
peut attendre de sa rapide réalisation.
Un mois plus tard a lieu une Assemblée
constitutive d'une Société Civile de l'École de Tissage mécanique
(cf. Annexe
N° 55) dont le président est Henri
THIERRY KOECHLIN et le vice-président
Fr. ENGEL-DOLLFUS avec ouverture
d'une souscription. On recueille 37.000 F
qui permet de faire face aux premiers
frais d'installation et de fonctionnement
pendant trois ans.
Au cours de cette réunion, Emile FRIES, un
camarade de pension du vice-président
de la SIM Gustave DOLLFUS, expose son idée
de création d'une École de tissage en Alsace. Cet homme d'à peine quarante ans, énergique
et doué d'une vive intelligence, avait
suivi un cours de théorie de tissage au
Palais des Arts à Lyon et dirigé
plusieurs grands tissages de nouveautés
à Lyon et à Manchester. Il venait de
quitter un poste de dessinateur dans cette
dernière ville et fut chargé de la
Direction de la nouvelle École, de l'élaboration
des cours théoriques et de l'enseignement
pratique et mécanique (théorie des
liages et technologie machines de tissage,
dessin et construction mécanique).
Un local provisoire situé à l'angle de la
Grand'rue en face de la Porte de Nesle est
loué pour trois ans. Il s'agit de
l'atelier de graveurs de rouleaux d'une
ancienne manufacture d'indienne qui
appartenait à Godefroy HEILMANN puis à
André KOECHLIN & Cie (A.K.C.). L'équipement,
modeste au début, s'enrichit rapidement
et comprend déjà après deux ans du matériel
divers prêté par différents
constructeurs et notamment les Ateliers de
Construction A.K.C. : des machines de tissage
(cinq métiers à tisser mécaniques A.K.C.,
quatre anglais de 1 à 6 navettes, deux métiers
à bras avec Jacquard), des machines de préparation
(bobinoir, cannetière, ourdissoir,
pareuse, etc.), une machine à vapeur
horizontale de cinq chevaux avec chaudière
et transmissions. Cette installation se
fait en deux mois et le er novembre
1861, quatre mois après la première démarche,
l'École ouvre ses portes à la première
promotion de 9 élèves. FRIES assure
l'enseignement théorique et un contremaître
est embauché pour l'enseignement
pratique. L'École progresse rapidement,
avec 15 élèves réguliers l'année
suivante et 29 en 1863/64.

Une École de filature en 1864
Encouragée par les succès initiaux de l'École
de tissage et constatant que des problèmes
analogues à ceux de l'encadrement des
tissages se présentent également en
filature, la SIM se décide de fonder également
une École de filature. D'autant plus que,
dans l'ère des grandes inventions
techniques du XIX° siècle, des
technologies modernes de filature (filage
et renvidage) apparaissent sur le marché
qui exigent de nouvelles connaissances
techniques.
Des structures administratives et une Société
Civile de l'École de filature sont créées
dans des conditions et avec un capital
analogue à celles de l'École de tissage.
La Direction de cette École est confiée
à Jacques-Mathieu WEISS (1837- 1904) qui avait suivi des cours
au Lycée CONDORCET à Paris et assisté
le professeur C.R.E.S.C.A. au Conservatoire des
Arts et Métiers avant de diriger la
filature HARTMANN. Si, initialement, on
avait envisagé de créer une
filature-école avec trois
assortiments complétés de 4 à 5000
broches marchant dans des conditions
analogues à un atelier industriel, on
abandonne ce projet pour une réalisation
plus modeste. En 1864, au moment où l'École de tissage quitte son ancien local
de la Grand'rue, l'École de filature y est
installée. Le matériel, battage, cardes,
peigneuses, bancs-à-roches,
métiers à filer automatiques et à main,
etc. est en grande partie fourni par André
KOECHLIN & Cie. A l'instar de sa
grande sœur, l'École de filature
fonctionne comme un petit établissement
autonome.
Quant à (organisation de l'enseignement de la
filature, il est étalé sur deux périodes,
l'une de novembre à septembre, l'autre de
janvier à novembre. De ce fait
il n'y a que cinq élèves la première année et
22 en fin de deuxième année. Au
programme initial de théorie et machines
de filature dispensé par le directeur
WEISS, il fallut ajouter des cours de
dessin et de mécanique donnés par le
professeur DRUDIN, car les connaissances
dans ces matières sont largement
insuffisantes. L'année suivante des cours
de prix de revient et quelques notions d'économie
industrielle complètent la formation.
Comme à l'École de tissage, les parents
sont trimestriellement informés des notes
de leur rejeton et les études sanctionnées
par un certificat de capacité.
Étant donné que, de bonne heure, on se rend
compte que les frais pour la conduite des
deux Écoles sont plus élevées que ceux
d'une École unique et que, par ailleurs,
le nouveau bâtiment pouvait abriter les
deux institutions, on se résout, en 1868,
à les fusionner.

23. Un
enseignement évolutif
Le premier directeur Émile FRIES devait
construire son cours de toutes pièces
avec l'aide des industriels car, à cette
époque, les théories des machines de
tissage et de filature étaient à peu près
inexistantes.
Du programme des études de l'École Théorique et
Pratique de Tissage Mécanique publié en
1863 (Annexe N°
3), on retient surtout
que l'objectif de l'enseignement est
l'acquisition dans des conditions aussi
proches que possibles de la pratique de
connaissances technologiques encyclopédiques
des processus traditionnels :
"L'organisation de l'École est établie
sur le pied manufacturier et constitue un
établissement complet, avec force motrice
à la vapeur, atelier de menuiserie et de
réparations". "Plan d'études
en deux divisions, théorique et
d'application, passant alternativement et
régulièrement de l'une à l'autre. Théorie:
décomposition et analyse des tissus unis,
grains, armures, façonnés, velours,
gazes ; "levée" et dessin des machines, étude
des meilleures implantations à donner à
un tissage nouveau, établissement de
plans et devis, calcul de prix de revient
et de fabrication, comptabilité
industrielle. Applications: travail
manuel, montage, réglage, ajustage, réparations,
entretien de toutes les machines; montage
d'articles décomposés en théorie,
"mettage", mise en marche et tissage, le
tout, assisté par un contremaître. En
plus, un cours spécial de deux heures est
dispensé le soir pour les personnes occupées
dans la journée qui désirent apprendre
le tissage".
"Conditions d'admission et dispositions générales
:
600 F par an par élève pour les cours théoriques
et pratiques d'une année scolaire de onze
mois. Pour le cours spécial de deux
heures du soir : 25 F par mois payé
d'avance. Les étrangers sont admissibles
à l'École au même titre que les
nationaux. Un élève peut se faire
admettre à toute époque de l'année et
doit produire à l'entrée les bulletins
ou notes de conduite et d'aptitude émanant
d'autres institutions. Après l'achèvement
de ses études, l'élève sera tenu de
passer un examen ..."
"Règlements d'ordre et de discipline et
avantages particuliers offerts par l'École
: Les cours durent chaque jour de 8
heures à midi et de 14 à 18 heures, sauf
le samedi où la fermeture a lieu à 16
heures. Les élèves ayant une
demi-heure de retard ne seront
plus admis. Les élèves travailleurs trouveront
l'École ouverte à 7 heures du matin et à
13 h. Les dimanches et jours fériés légaux,
l'École reste fermée. Tout ce qui peut
troubler l'ordre ou le travail est défendu:
bruit, chant, causeries; il est interdit
de fumer et d'introduire dans l'établissement
des comestibles, du vin ou des spiritueux.
Aucun élève ne peut faire voir les
ateliers sans l'autorisation du directeur.
Les fabricants ou négociants qui désireraient
des renseignements sur des genres de
fabrication spéciaux et articles façonnés
pourront en faire la demande au directeur;
ces consultations, confidentielles avec
visite de l'École, donneront lieu à une rémunération
proportionnelle au temps qu'elles nécessiteront.
Dans le but de faciliter aux inventeurs
les essais nécessités par les améliorations
et les perfectionnements à apporter aux
machines de tissage, l'École offre son
concours aux intéressés... "
Les structures indispensables pour la bonne
marche de l'École se mettent en place avec
célérité, d'abord un Comité de
surveillance issu de la SIM puis, en juin
1863, une Commission d'examen dont les
membres sont choisis parmi les spécialistes
les plus représentatifs d'entreprises
textiles du Haut-Rhin. Les membres
de cette Commission apposent leur
signature au bas du certificat de capacité
remis aux élèves à la fin de leur année
d'études. De ce fait, ils doivent non
seulement faire passer les examens aux élèves,
mais surtout valoriser le parchemin et
recommander son détenteur aux fabricants,
leurs collègues, appelés à les
employer. Ce principe de faire passer les
épreuves de fin d'année dans les matières
textiles par des examinateurs praticiens
de l'industrie fonctionne durant plus d'un
siècle, jusqu'à la "révolution de
mai 1968" où il est aboli. C'était
d'ailleurs la terreur des élèves car ces
examinateurs possédaient à fond quelques
questions spécifiques techniques,
scientifiques et pratiques qu'ils se régalaient
de poser aux étudiants.
Comment se passent les premières épreuves à l'École, par exemple celles des sept étudiants
de la promotion sortante du 23 juillet
1863 ? La Commission d'examen comprend
outre le président Henri SCHWARTZ
(1845-1895), membre de la C.C.I., du
Conseil Municipal, de la SIM et plus grand
filateur de laine peignée d'Europe avec
115.000 broches en 1895, Gustave DOLLFUS,
Henri ZIEGLER de Mulhouse, Théodore FREY
de Guebwiller, J. GROSHEINZ de Thann,
Gustave BORNEQUE de Bavilliers, R. WEERDER
de Wesserling et J. DIETSCH de
Sainte-Marie-aux-Mines. Le
matin de 9 h à midi ont lieu les examens
oraux et théoriques et après déjeuner
les travaux écrits et les examens
pratiques de réglage des machines. Une
liste de questions est proposée à
l'avance que les examinateurs ont la
latitude de modifier ou d'étendre et dont
ils proposent une à l'élève. En outre
l'étudiant présente et explique le
travail écrit dont le directeur l'a chargé
de soumettre à l'examen. Chaque
examinateur donne une note entre 1 et 20
à chacune des trois matières. Le
directeur de l'École y ajoute une note
pour la conduite et une pour l'application
de l'élève, notes qui entrent pour 215
dans la note finale. Ces épreuves passées
avec succès donnent lieu à l'établissement
de grands parchemins de 50 x 40 cm
richement ornés, un diplôme de premier
ordre pour une moyenne de 15 à 20 (Annexe
N° 4) ou de second ordre pour une moyenne
de 13 à 14,99 (Annexe N°
5) ou d'un
certificat d'études (ou de capacité)
pour une moyenne de 10 à 12,99 (Annexe N°
6).
Pour l'École Théorique et Pratique de Filature,
un programme analogue est établi en 1865
(Annexe N°
7).

Formation tous azimuts
Très tôt, le Comité d'administration et la
Direction se rendent compte de
l'insuffisance de la préparation des élèves, ce qui les
empêche de profiter au maximum des enseignements dispensés. Plusieurs démarches
sont entreprises tant pour améliorer le niveau des élèves entrants que pour parfaire
l'instruction des élèves et des salariés de l'industrie.
Déjà en décembre 1862, un accord est passé
avec la direction de l'École
Professionnelle de Mulhouse pour organiser dans leurs
classes supérieures un cours préparatoire spécial de deux heures par jour. Cette
initiative est destinée à des jeunes
gens
intéressés par l'entrée dans l'industrie
textile comme contremaîtres ou en tant
que
futurs élèves à l'École textile. Douze élèves
suivent ce cours dès la première année.
Ce nombre s'élève rapidement à
une vingtaine au cours des années
suivantes.
Quant à la filature, le directeur
Jacques-Mathieu WEISS dispense,
"sans rétribution
spéciale", à partir de 1865 des cours
populaires du soir à 35 élèves de 18 à
30 ans venant de l'industrie ou de l'École de Tissage et
qui cherchent à s'initier ou à se
perfectionner. On y trouve aussi bien
des contremaîtres, fileurs, mécaniciens,
dessinateurs que des employés de commerce
ou d'usine.
La même année et en 1866, l'École
de Filature fait appel à Ernest STAMM,
professeur aux Universités de Milan et
de Turin pour donner chaque fois deux conférences à Mulhouse sur la théorie
du renvidage sur self-acting, à
l'aide de tableaux explicatifs et d'une têtière de métier
à filer automatique. Tous les étudiants
et un
grand nombre de chefs d'entreprise,
directeurs, contremaîtres et ouvriers
assistent
à ces exposés suivis de
discussion. Plus tard, STAMM revient pour
parler de la théorie du battage et du cardage.
A peine a-t-on emménagé
en 1865 dans la nouvelle École fraîchement
construite,
qu'un nouveau projet de création
d'un atelier expérimental de tissage mécanique
exploité industriellement est
caressé. Ce serait une possibilité de
gagner de l'argent
en tissant à façon pour des
entreprises locales et, simultanément, de
perfectionner
les connaissances de contremaîtres
ou de directeurs ayant déjà une expérience
pratique dans l'industrie. On pensait
aussi à la formation, dans ce cadre,
"de futurs tisserands hors ligne propres à
devenir plus tard de bons contremaîtres
tout en
gagnant de quoi vivre". Sitôt
dit, sitôt fait. L'Assemblée générale
des fondateurs de
l'École vote au printemps 1866 une
augmentation de capital de 30.000 F pour
adjoindre dans un local de l'École
un atelier de 40 métiers à tisser mécaniques
avec
tout le matériel de préparation
conduit par du personnel autre que les élèves.
Ce
serait aussi pour des élèves
sortant de l'École avec des connaissances
théoriques et
pratiques, l'occasion de vivre
concrètement une expérience d'atelier
avec le souci du
rendement et de la direction des
ouvriers. Les ouvriers eux-mêmes
formeraient un
noyau, un vivier de futurs bons
contremaîtres. Toutefois, cette
initiative fut un coup
de sabre dans l'eau. Ce tissage
entrant en activité en 1867 dut être
fermé à peine trois ans plus tard, son rendement
étant d'autant plus mauvais que la
conjoncture
dans le tissage devenait "néfaste"
et, en conséquence, il travaillait à
perte.

En 1868, la nouvelle École de Filature et de
Tissage
1867 est une année exceptionnelle par la
participation à l'Exposition Universelle
de Paris d'une délégation des Écoles de
Tissage et de Filature de Mulhouse. Dans
une vitrine de la SIM sont exposées des
préparations de mèches, des filés et
des tissus produits à l'École ainsi que
les plans détaillés de ses salles de théorie
et de pratique. Une médaille d'or est décernée
à la SIM, fondatrice de ces institutions.
La fusion des deux Écoles sous la Direction
unique de Émile FRIES est décidée. Jacques-Mathieu WEISS reste l'adjoint
d'Émile FRIES, mais après une année de
collaboration, il préfère repartir dans
l'industrie pour diriger une filature du
Val d'Ajol tout en restant membre du Comité
d'Administration de la nouvelle École.
Un fonds spécial est créé par l'École en 1868
pour envoyer le major de tissage en
Angleterre en vue d'effectuer une
"tournée industrielle".

1870 : l'élan brisé
La nouvelle École atteint une belle prospérité
avec une quarantaine d'élèves par an
quand, le 19 juillet 1870, NAPOLÉON III déclare
la guerre à l'Allemagne. Les examens se
terminent et l'École ferme ses portes le
31 juillet 1870. En septembre la
Haute-Alsace subit des incursions
de troupes prussiennes et le 3 octobre
Mulhouse est occupée. Après l'armistice,
le "Traité des Préliminaires de
paix" est signé le 26 février 1871
entre la France (cédant aux vainqueurs
les trois départements de l'Est, sans le
Territoire de Belfort) et l'Allemagne. L'École ne rouvre ses portes qu'en avril
1871, un mois avant la signature du Traité
de Paix de Francfort. Mais l'élan est
brisé. Pendant les cinq premières années
après la guerre, le nombre d'élèves
recule à 15. Déjà en mai 1873, le
vice-président du Comité
d'Administration de l'École tire la
sonnette d'alarme. "Le nombre d'élèves
est trop faible pour faire vivre l'École". On énumère les causes
possibles de cet échec, indépendamment
de "l'influence fatale de la guerre :
le manque de publicité faite pour l'École, la jeunesse qui néglige les
ressources mises à sa disposition dans la
région, plusieurs écoles analogues qui
venaient de s'ouvrir en France, en Suisse
et en Autriche".
"On relève également les atouts de l'École
: l'outillage complet, une
École à
caractère international et libre de toute
ingérence gênante extérieure, (État,
Municipalité, Politiques, etc...), nos élèves
sont toujours accueillis par les
industriels pour des visites d'usines, un
directeur dynamique et de haute compétence,
l'Alsace est un centre textile
suffisamment grand pour pouvoir à lui
seul alimenter notre École sans secours de
l'étranger". Néanmoins, les faits
sont là ! En mai 1874, Gustave DOLLFUS, le
président du C.A. propose une nouvelle
souscription auprès des industriels pour
assurer la pérennité de l'École pour 3
ans, sinon ce serait la fermeture forcée
par manque de moyens. Cette souscription
rapporte la somme de 19.000 F et
garantissait ainsi la marche de l'École
pour 4 ans.
Un autre souci découle de la diminution
drastique du nombre de candidats à l'entrée,
le niveau d'instruction des élèves
diminue fortement par suite de la
suppression de l'examen d'admission,
notamment les notions de mécanique et le
dessin
manquent complètement. A partir de ce moment, la
Commission d'examen se transforme en
conseil pédagogique, se rendant plusieurs
fois par an à l'École, prodiguant
encouragements et conseils aux élèves.
De nouveaux cours dispensés par le
professeur DANZER devaient compenser les
lacunes : mécanique (transformation des
mouvements, force, travail), moteurs à
vapeur et hydrauliques, appareils à
vapeur, chauffage et combustibles,
comptabilité commerciale.

Un second départ
Enfin, à partir de 1877, on voit renaître
l'espoir avec des promotions d'une
trentaine d'élèves qui vont en
augmentant jusqu'aux années 1910 où
elles dépassent la cinquantaine. On
introduit un examen d'admission avec contrôle
des connaissances afin de relever le
niveau. En 1878, des cours supplémentaires
sont également ajoutés : dessin, préparation
de plans et de devis d'établissements de
filature et tissage.
Si la durée normale des études est de deux années,
dont une en filature et une en tissage,
des élèves avec une bonne formation
initiale, doués et travailleurs, avaient
la possibilité de faire les deux sections
en une année de séjour, ce qui arrivait
à quelques rares élus.
Après l'agrandissement des bâtiments et le
renouvellement du parc de matériel dans
les années 1880, on réorganise également
les programmes d'études, notamment à
cause de l'instruction de base
insuffisante des élèves et pour relever
le niveau des études en leur permettant
une incursion plus facile dans le domaine
théorique. On procède à une révision
des cours soutenus par des interrogations
fréquentes : cours de filature avec élargissement
à la laine, cours de tissage, théorique
et pratique, travaux pratiques sous la
surveillance de bons contremaîtres sur du
matériel produisant des filés ou des
tissus. Refonte des autres cours en les
rendant obligatoires: mécanique élémentaire
et appliquée, comptabilité, physique et
chimie industrielles (comme au début il
présentait des difficultés
d'organisation, ce cours est d'abord fondu
avec celui de mécanique), étude de la
chaleur, des générateurs et des
mouvements des gaz, électricité pour l'éclairage
et les moteurs, notions de chimie nécessaires
aux apprêts, comptabilité générale. En
1885, on est obligé d'admettre qu'il y a
"deux catégories bien distinctes d'élèves,
l'une distinguée pour les futurs chefs
d'ateliers, l'autre médiocre pour les
ignorants dont il fallait d'abord assurer
une préparation en dessin et mathématique".
Par ailleurs, au niveau du recrutement et du
placement des jeunes, la concurrence
d'autres Écoles en France et à l'étranger
ouvertes à partir des années 1880 se
fait
sentir. Le patronat haut-rhinois, à l'indépendance
sourcilleuse, souligne que ces
Écoles, contrairement à celle de Mulhouse qui
s'autofinance, sont largement subventionnées par l'État, les villes ou des
institutions diverses. Néanmoins,
"nous
sommes sur la bonne voie,
affirme-t-il, les armes pour
vaincre la concurrence seront
la supériorité de notre enseignement". Un
peu plus tard, le président du Comité
d'administration De LACROIX se rassure en
estimant que "les écoles rivales
fournissent plutôt des contremaîtres que des
directeurs".
En 1885, le directeur Emile FRIES qui a porté
pendant 24 ans "son École"
contre vents et marées à travers toutes
les difficultés, âgé et fatigué,
demande à prendre une
retraite bien méritée. Son fils Henry a
d'ailleurs fréquenté l'École en 1881 et
sera plus tard directeur-gérant de
DOLLFUS & NOACK à Sausheim. Oscar
WILD (1849- 1897), un ancien élève
sorti de l'École en 1877 qui avait dirigé
pendant quelques années un tissage de
Mulhouse, assumera la Direction de l'École
à partir de 1885.

Enseignement français puis bilingue
Dès avril 1871, l'administration allemande
introduit en Alsace annexée, en même
temps que l'obligation scolaire (Jules
FERRY ne le fait en France que douze ans
plus tard) l'allemand comme langue
d'enseignement au primaire, donc la
suppression de la langue française à l'école
communale. Le français subsiste comme
langue étrangère dans les collèges et
lycées. Certains journaux continuent à
paraître en français, la population et
les banques calculent toujours en Francs
jusqu'en 1891 alors que le Mark a été
introduit en 1874 (la parité, extrêmement
stable pendant des décennies, est de 1,25
F pour 1 Mark). La SIM n'a jamais
interrompu, entre 1870 et 1914, la
publication en langue française de son
Bulletin mensuel - par ailleurs, une
immense source d'informations, notamment
pour l'historien -.
Mais l'administration allemande supportait de
moins en moins cette École textile où
tout le monde, du directeur à la plupart
des élèves, non seulement parle français,
mais exhibe ostensiblement des sentiments
profrançais. Néanmoins la politique de
germanisation avance, même si c'est à
petits pas. En 1892, l'École est obligée
de dispenser un cours de filature en
langue allemande, obligatoire pour les élèves
alsaciens et quelques rares Allemands.
C'est d'ailleurs un ancien élève sorti
major en 1887, Henry BRUGGEMANN, venant de
Cologne, qui devient professeur de
filature à l'âge de 25 ans. En juin
1894, à la suite d'un "incident
politique" que nous avons relaté
ailleurs, on se voit obligé d'enseigner
aux Alsaciens tous les cours en langue
allemande. Toutefois, pour les étrangers,
on continue à professer en langue française
jusqu'en 1914. Cet enseignement bilingue
représente une surcharge considérable
pour les professeurs qui devaient
pratiquement dédoubler leurs cours.
Mais de ce fait, certains obstacles de langue et
de frontière sont écartés. L'École
lance une campagne de publicité à
travers l'Europe dans l'espoir d'augmenter
le nombre de ses élèves. Effectivement,
" l'administration allemande a
compris la correction de l'attitude de la
Direction de l'École, inspirée du seul désir
d'élever l'enseignement et d'être utile
à une classe intéressante, celle des
fils de contremaîtres et d'employés de
notre pays". L'accroissement des
effectifs est dû en grande partie à
l'afflux d'étudiants français attirés
par Mulhouse à cause de ses industries
diverses et ses ateliers de construction,
même si, au cours des vingt dernières
années, plusieurs écoles textiles furent
fondées en France. On relève ainsi
"qu'en renonçant à l'enseignement
bilingue, l'École perdrait la moitié de
ses élèves que représente le contingent
des étrangers car, même les Vieux
Allemands viennent faire leurs études à
Mulhouse pour apprendre, selon leur propre
aveu, la langue française. Pour notre École, cela devient donc une question de
vie ou de mort". De toute façon,
l'Alsace et l'Allemagne ne fournissent
qu'un tiers des effectifs, ce qui justifie
l'enseignement bilingue.
Malheureusement, en juin 1897, en
plein élan d'expansion, la mort prématurée
du
directeur Oscar WILD vient
endeuiller l'École. Toutefois, les deux
professeurs de
filature et de tissage terminent
normalement les cours et les examens se
passent à
la date prévue de fin juillet. Se
pose alors le problème de trouver un
nouveau directeur. BRUGGEMANN, professeur compétent
de filature qui assure l'intérim de
direction, qui professera plus tard
également à l'École de chimie la législation
des
brevets ainsi que la filature et le
tissage des différentes fibres textiles,
est pressenti
et son mérite n'est contesté par
personne. Toutefois, comme il avait à
peine 30 ans,
"le Comité ne le jugea pas
assez mûr pour cette délicate
fonction". En réalité, mais ceci n'est ni dit officiellement ni
surtout écrit dans les procès-verbaux,
les industriels
mulhousiens ne veulent pas confier,
à l'instar de ce qu'ils firent pour l'École de
chimie, l'École textile de Mulhouse à
un Prussien. Par bonheur, un ancien
professeur
de mécanique et ancien
sous-directeur de l'École, ingénieur
de l'École Centrale de
Paris, ayant dirigé des tissages
importants à Mulhouse entre 1871 et 1896,
l'Alsacien
Albert ROHR (1847- 1914),
se trouve en disponibilité. Il prendra la
succession de
Oscar WILD et demande la création
d'un conseil permanent de perfectionnement
dont la mission serait de réviser
les programmes, les cours et les règlements.
Ce
conseil, composé de deux sections,
filature et tissage, comprenant le
personnel
enseignant, des praticiens de
l'industrie et les examinateurs, donnerait
des avis.
Dans la foulée on supprime le
cours de comptabilité et, avec les économies
ainsi
réalisées, on améliore les émoluments
des contremaîtres.
Vers la fin du siècle, avec la
mode des tissus fantaisie et articles spéciaux,
on se rend
compte de l'importance de
l'enseignement des armures fantaisie pour
former de bons échantillonneurs, des
techniciens artistes. "Nous ne
pouvons pas rester dans
le tissage ordinaire avec nos prix
élevés de main d'œuvre, déclare en
1899 Camille
De LACROIX, l'Alsace ne prospérera
dans la Grande Allemagne (sic) qu'en s'appliquant à demeurer l'initiatrice
de la mode et de la nouveauté". Étant
donné que
dans peu d'écoles on enseignait
parallèlement au tissage le dessin
d'imitation, on
institue à côté de notre cours
d'échantillonnage un cours de dessin
d'imitation, bien
que l'École de dessin et de gravure
le professait déjà en ville. En complément
du tissage du coton et de la laine, on
introduit au début du siècle le tissage
de la soie, du
lin et du tapis, en achetant un métier
à tisser le tapis.
Le régime des études est remis en
cause au début du siècle.
Faudrait-il créer une classe préparatoire et n'admettre
aux cours spéciaux que les élèves qui,
aux examens d'entrée, auraient fait
preuve de connaissances générales
suffisantes ? Une
année d'études semblerait à
peine suffisante, d'autant que dans
certaines écoles la
formation dure deux voire trois
ans. Mais la concrétisation de ces idées
se heurterait au problème du recrutement
car les ressources de nos jeunes, généralement
sans fortune, ne seraient pas
suffisantes. La question de la formation
de base est
également discutée au cours de l'A.G. des Anciens de 1904 où l'on
recommande vivement aux jeunes de fréquenter
d'abord une École industrielle, notamment
les cours
complets de l'École des apprentis
de Mulhouse qui venait d'être créée,
suivis d'un
stage de quelques mois dans une
filature ou dans un tissage. Malgré tous
les efforts,
on signale chaque année
l'insuffisance des connaissances
scientifiques des élèves à
l'entrée. Dans un moment de découragement,
Albert ROHR déclare en 1908 que
"la valeur moyenne des élèves
de tissage n'a jamais été aussi faible
depuis son arrivée à l'École en 1897. De plus,
comme l'État est chaque jour plus avide
d'interventions et de réglementations et que les
administrations allemandes pèsent d'une
main de plus en plus lourde sur certaines
institutions de la SIM, l'avenir
n'apportera rien de bien".
En dépit de ces déboires, la qualité de
l'enseignement et le nombre d'élèves
progressent. Les années 1910 et 1911
annoncent des records de 69 et 72 élèves.
Les développements rapides des techniques
nouvelles obligent les professeurs à
actualiser continuellement leurs cours. Le
professeur KAMMERER, ingénieur en chef de
l'Association des propriétaires
d'appareils à vapeur, captive son
auditoire avec son nouveau cours d'électricité,
un autre nouveau professeur,
self-made man, dispense avec succès
des cours de moteurs, chaudières et générateurs.
On décide de relever le coefficient de
ces matières dans les notes de
classement. Un professeur de l'École de
chimie est engagé pour des cours de
blanchiment et teinture sur filés et
d'analyse de tissus.

Des cours de perfectionnement pour les actifs
A l'instar des cours initiés dans les années
1862 à 1865 et destinés à un public extérieur
à l'École, l'idée de créer une école
de contremaîtres pour l'industrie textile
est relancée en 1908 par l'Association
des Anciens élèves. La Municipalité
semblait disposée à favoriser une telle
création analogue à l'École technique
des Apprentis déjà existante. Les
Anciens qui feraient partie du Conseil
d'administration et élaboreraient le
programme d'études de cette école,
expriment leurs craintes de voir la ville
agir trop bureaucratiquement et les
industriels de la SIM trop autoritairement
en tirant la couverture à eux.
Finalement, cette école de
perfectionnement pour contremaîtres, mécaniciens
et employés de l'industrie et du commerce
est organisée par la SIM en cours du soir
avec le professeur AUER de l'École textile
dispensant des leçons de tissage et décomposition
des tissus. Dès la première année en
1910, on enregistre 29 personnes, puis
entre 20 et 30.

Le cataclysme mondial de 1914-
1918
L'année 1913 est caractérisée, pour des
raisons politico-militaires, par la
défection des jeunes de sorte que le
nombre des élèves tombe à 38. D'autre
part, les étudiants éprouvent du mal à
se placer comme stagiaires débutants et
le professeur de filature BRUGGEMANN les
prend dans son bureau comme aide en
attendant qu'ils se placent dans
l'industrie. D'ailleurs cette année-là,
BRUGGEMANN quitte l'École pour se
consacrer entièrement à ses activités
de bureau d'expertise et de rédacteur et
est remplacé par SCHIRMER, également un
Ancien de l'École. Quant au directeur
Albert ROHR, il exprime le souhait de se
retirer mais doit rester jusqu'en 1914,
mourant à la tâche au mois de mai. La
Direction est alors confiée à Fritz
ORTLIEB, sorti de l'École en 1897. Un
nouveau cataclysme s'abat sur l'Europe et
notamment sur l'Alsace, au moment où, le
31 juillet 1914, la distribution de 29
diplômes vient de se terminer.
Le ler août 1914, l'Allemagne déclare la guerre
à la Russie et le 3 août la France. Le 4
août les troupes allemandes entrent en
Belgique et la Grande-Bretagne déclare
la guerre à l'Allemagne. L'Europe
s'embrase. Dès le début des hostilités,
les troupes
françaises avancent à deux reprises jusqu'à
Mulhouse pour refluer finalement à une
vingtaine de km de notre ville jusqu'à la fin de
la guerre. Mulhouse, zone de front,
reste soumis à l'arbitraire militaire allemand.
L'École doit rester fermée durant toutes les
hostilités, d'autant qu'elle
"n'avait jamais
été en odeur de sainteté durant les 47 années
d'occupation allemande". En réalité,
elle fut toujours considérée par les autorités
allemandes comme un foyer de propagande française, avec ses cours professés en
langue française, avec de nombreux
industriels, enseignants et élèves français et
alsaciens dont la mentalité francophile
était notoire. Et l'École l'était en fait. En
conséquence, une demande de réouvertu
re de l'École adressée à l'administration
allemande fin 1914 est rejetée. Au
contraire, les Allemands ordonnent en 1915 une enquête
dans le but de placer l'École sous
séquestre en tant qu'institution ennemie. Le président
du Conseil d'administration
et ancien député Théodore SCHLUMBERGER et le
directeur Fritz ORTLIEB restés sur place, s'ils n'ont pas réussi à empêcher
la mise sous séquestre, ont néanmoins
repoussé cette échéance jusqu'au mois
d'octobre 1918, trois semaines avant la
débâcle allemande. Mieux encore, on a même
utilisé ce temps d'inactivité de l'École
pour améliorer l'aménagement des immeubles, en
vue d'accueillir des promotions
plus importantes dès le retour à la paix.
Bâtiments et matériels sont restés intacts et
des matières premières sauvées. Les
dirigeants se mettent immédiatement à l'œuvre
et les cours reprennent, les premiers de toutes les écoles du secteur, le 1er février
1919 avec 57 élèves, la plupart
Alsaciens, certains encore en uniforme. Après
avoir "avalé" le programme
annuel
en 7 mois 112, 49 élèves passent les examens
avec succès le 12 septembre 1919. Pour
la rentrée suivante, comme à l'École de Chimie,
affluence record avec 120 élèves, le
double d'une promotion normale, dont 60 Français
pour la plupart démobilisés
entre temps. Les professeurs ORTLIEB, KLEIN et
BURGARDT, dans un assaut de
dévouement, sont obligés de dédoubler leurs
cours.

Un nouveau
visage : l'École Supérieure en 1919
Si la guerre faisait rage et les activités de
l'Association des Anciens de Mulhouse
mises en sommeil, il n'en est pas de même des
Anciens du groupe régional d'Épinal.
En effet, en octobre 1915, une réunion de huit
Anciens du remuant groupe régional des Vosges engage "une discussion sur la
réorganisation de l'École et sur la transformation indispensable des statuts de
l'Association dont la plupart des articles
sont à modifier ou à remplacer". Le
lieutenant Henri BONDOIT installé à
Chevilly
(Loiret) soumet, dans une édition provisoire du
Bulletin de l'Association N° 1, les
réflexions, entre autres, sur l'avenir de l'École
: "La guerre, considérée au
point de
vue exclusif de nos intérêts mulhousiens, est
un événement dont nous devons nous
féliciter. En éliminant des éléments
germanophiles remuants, elle fera disparaître
tous les points de friction - malheureusement trop nombreux
- qui
ont entravé la
bonne gestion de notre Association.
Raisons essentielles d'une réorganisation de l'École
:
le programme de l'École ne contient pas tout ce
qu'il faut pour faire d'un diplômé
un directeur parfaitement documenté :
- études du domaine d'ingénieur : mécanique,
machines à vapeur, moteurs, électricité,
hydraulique,
- économie : droit commercial, législation
du travail, étude de marchés textiles,
organisation, direction des usines,
comptabilité,
- complément d'études textiles :
fibres, botanique, chimie tinctoriale,
apprêts.
Comme corollaire, prolongation des études:
filature 2 ans, tissage 2 ans, filature et
tissage 3 ans. La 1 ère année
partiellement commune aux deux sections
comprendrait des cours de révision, math,
matières textiles, notions de chimie
tinctoriale, etc..."
"En conséquence, transformer, comme pour l'École de Chimie, le titre de
l'École en "École Supérieure de Filature et de
Tissage" ; créer comme sanction des études
un diplôme d'ingénieur en filature etc...
;
augmenter le corps professoral et
organiser des conférences par des
industriels ou anciens élèves. Il faudra
reconstruire l'École en presque totalité... avec salles de cours, d'échantillonnage,
de dessin, amphi de 150 places,
laboratoire, musée-bibliothèque,
ateliers, bureaux des prof., appartement
de la Direction, etc... L'Association devra
être représentée au sein du Comité
d'administration de l'École". Vaste
programme ! ...
Dès 1919, l'École s'approprie le nouveau nom d'École Supérieure de Filature et
Tissage. "Bien que prétentieux,
souligne De LACROIX, il était bien mérité
après la réorganisation complète des
cours et l'élévation du niveau des études
suite aux concours d'entrée". Devant
l'affluence des étudiants, il fallut dédoubler
les séances de travaux pratiques en
demi-sections chaque jours de 10 h
à midi et de 14 à 16 heures, les cours
théoriques ayant lieu le matin de 8 à 10
h et le soir. Au tissage, on déplaçait
des moteurs individuels transportables
pour faire marcher les métiers
indispensables.
En 1920, si l'on n'a pas entièrement reconstruit
l'École selon les vœux des Spinaliens, on
augmentait sérieusement sa surface pour
un budget de plus de 450.000 F. Le nouvel
amphithéâtre permettant d'accueillir les
deux promotions réunies est inauguré en
janvier 1921.
En 1923, la Direction de l'École présente une
plaquette de 24 pages illustrées (Annexe
N° 8) avec le nouveau programme d'études
en refondant entièrement les cours de
filature, de tissage et d'instruction générale
et en les complétant en 1924 par une
section de bonneterie. Cours de filature :
Matières textiles, titrage, technologie
de filature coton, laine peignée et cardée,
autres matières ; cours de tissage : matières
premières, filature et retordage de ces
matières, machines de préparation et de
tissage, théorie de liage, échantillonnage,
fabrication ; cours de bonneterie :
machines, mailles cueillies, métiers chaîne,
tricots, confection, etc... ; cours
d'instruction générale : mécanique cinématique,
appliquée, dynamique et statique, chaudières
et moteurs, électricité, résistance des
matériaux, éléments de machines,
technologie, chimie textile, droit,
finances et comptabilité, marchés de
coton.
A cette époque, les frais de scolarité se
montent pour les élèves français
suivant les deux cours à 7000 F par an,
10.000 F pour les étrangers, en plus des
frais de fournitures et d'assurance
accidents.

Cours préparatoires et de perfectionnement
Durant les vacances d'été 1920, on organise,
dans le but de mieux préparer les élèves
à l'entrée à l'École, des cours de mise
à niveau. Ces cours préparatoires
devaient garantir annuellement une
vingtaine de recrues bien initiées. Si,
en 1930, on compte encore 27 élèves à
ce cours de vacances, l'année suivante,
la crise textile faisant rage, il est
supprimé, faute d'inscriptions.
Par ailleurs, à la même époque le Lycée de
Mulhouse tient compte des souhaits exprimés
par l'École en dispensant dans sa section
scientifique un enseignement mieux gradué,
ce qui permet d'avoir annuellement une
quinzaine d'élèves sérieusement préparés.
Une classe préparatoire à l'École
Professionnelle de Mulhouse fonctionne
depuis 1921 pour fournir un petit
contingent d'élèves à l'École de
Filature et Tissage mais, par suite de la
crise textile, elle est supprimée par le
Recteur d'académie en 1932 en raison des
faibles effectifs.
Les cours du soir organisés par la SIM, destinés
aux contremaîtres de tissage et autres
actifs de l'industrie et du commerce
textiles, reprennent dès l'automne 1919
sur de nouvelles bases plus solides. Bien
que moins bien fréquentés à cause de
l'augmentation substantielle de l'écolage,
ils procurent des ressources supplémentaires
à l'École. Ils ont lieu deux fois par
semaine de 20 à 22 heures de début décembre
à juin et comportent les matières
suivantes : dessin et croquis industriels,
matières textiles, notions de filature,
tissage machine et théorie de liage,
travaux pratiques et réglage des
machines. Ils sont dispensés en partie en
dialecte alsacien et sanctionnés par un
examen. Entre 1921 et 1929, 50 à 80
adultes suivent ces cours. Des cours
semblables sont réclamés pour la
filature. En raison de la crise, les cours
du soir ne pouvaient plus être autofinancés
et sont supprimés durant les années 1932
et 1933 pour reprendre avec 32 inscrits en
1934. Avec la reprise des affaires à
partir des années 1937, on enregistre
jusqu'à la guerre entre 40 et 50 élèves
aux cours du soir qui profitent également
du patronage de l'Alliance Corporative. Ce
cours de perfectionnement pour les employés
d'entreprises textiles devait être dédoublé
en octobre 1938 par une formation du mardi
matin. Il fallut en outre organiser un
autre cours professionnel de tissage à Châtenois
(Bas-Rhin) dispensé par deux
professeurs de l'École de Mulhouse (dont
un en langue alsacienne) pour une
quarantaine d'élèves les samedis de 14
à 17 heures pendant l'hiver. Ce même
cours a dû être repris à Rothau en
hiver 1939.

24.
Combat pour le titre d'ingénieur
A l'Assemblée générale des Anciens de juillet
1922 est formulée une demande au Ministre
de l'Instruction Publique afin que le
gouvernement autorise les élèves de l'École de Mulhouse à prendre le titre
d'ingénieur textile. Camille De LACROIX,
président du Conseil d'Administration de
l'École, fidèle à l'esprit des
manufacturiers mulhousiens, soupire en décembre
1922 "Si nous pouvions donner un
brevet signé d'un sous-secrétaire
d'État, notre recrutement serait
certainement meilleur. Mais pour être
reconnu par l'État, il nous faudrait
renoncer à cette indépendance... mais
nous sommes enfants de Mulhouse,
francs-tireurs dans le sang...
".
Branle-bas de combat au Comité de
l'Association des Anciens en été 1923.
Le président du groupe régional des
Anciens de Paris envoie un extrait de
presse en provenance de l'École Supérieure
de Filature et Tissage de l'Est à Épinal,
(Annexe N°
9) publié dans un journal
alsacien, signalant "qu'elle est
habilitée à recevoir l'instruction
militaire supérieure, qu'elle se classe
parmi les premières du Continent et que
c'est la seule École à décerner le
Brevet d'Ingénieur Textile visé par le sous-secrétaire d'État à
l'Enseignement Technique, etc...". Les
Anciens de l'École de Mulhouse se
rebiffent en estimant qu'il "est
inadmissible qu'Épinal ait des privilèges
aussi intéressants alors que Mulhouse, la
première et la plus ancienne de France ne
les ait pas" et demandent d'effectuer
des démarches auprès de Daniel MIEG, président
de la SIM Malheureusement, Mulhouse est
bien plus éloigné de Paris qu'Épinal,
politiquement, et Frédéric ORTLIEB calme
le jeu par quelques explications embarrassées.
Néanmoins un premier résultat est acquis en
automne 1923 avec l'autorisation accordée
à l'École par décret ministériel d'être
admise à la Préparation Militaire Supérieure
(P.M.S.). 46 étudiants suivent cette
instruction en première et deuxième année
et 7 sont reçus. Les années suivantes
une trentaine de candidats s'inscrivent à
cette formation de P.M.S. durant deux ans.
Plus tard, entre 2 et 5 candidats réussissent
annuellement le brevet P.M.S. et une
demi-douzaine le peloton de sous-officier de réserve. Suite au
décret du 10 août 1938, seuls les élèves
ingénieurs sont admis à la P.M.S. ce qui
fait fondre les effectifs.

De 1924 à 1937
Les démarches pour l'obtention du titre d'ingénieur
aboutissent en 1924 à la solution souhaitée
:
on accorde le brevet d'ingénieur textile
de l'E.S.F.T.B. (Annexe N°
10) aux élèves
ayant suivi les cours pendant deux ans et
obtenu dans chaque section un diplôme de
1er ordre (moyenne 16 sur 20 à partir
des années 1925). Quatorze brevets d'ingénieurs
sont ainsi décernés pour la première
fois en été 1925 et ce système dure
jusqu'à la fin de l'année scolaire 1937.
En 1930 le directeur Frédéric ORTLIEB publie
une nouvelle plaquette luxueuse de 36
pages format 19 x 29 cm avec le programme
rénové des études de filature, tissage,
bonneterie et d'instruction générale
obligatoire et facultative (commerce de
cotons bruts, droit, finances et
comptabilité). Les conditions d'admission
sont plus sévères et on propose aussi
des cours de vacances pour les candidats
devant passer un examen d'admission. Les
frais de scolarité se montent à 4000 F
par an pour les nationaux et 6000 F pour
les étrangers, en plus des frais de
fournitures et d'assurance. L'École
accorde des demi ou quart de
bourses aux élèves français méritants.
Une nouvelle étape est entamée à la suite de
l'application de la loi du 10 juillet 1934
instituant une Commission des Titres d'Ingénieurs.
En réponse à la requête du Conseil
d'administration et de la Direction de l'École, le ministère de
l'Éducation
Nationale rend son jugement, publié au
journal Officiel du 26 juillet 1936 :
"La Société de l'E.S.F.T.B.M. pourra,
dans l'avenir, délivrer un titre d'ingénieur
libellé ainsi : diplôme d'Ingénieur
Textile délivré par l'École Supérieure
de Filature, Tissage et Bonneterie de
Mulhouse. Les personnes ayant acquis ces
diplômes dans le passé
pourront en faire usage dans l'avenir lorsqu'il
aura été procédé à la formalité de dépôt
prévue par l'article 9 de ladite
loi". En 1953, le directeur Victor
HILDEBRAND rappelle que le Brevet d'Ingénieur
Textile décerné aux élèves dans les
années 1925 à 1936 est assimilé au
titre d'Ingénieur Textile.
Toutefois, une profonde réforme de
l'organisation scolaire est imposée par
la Commission des Titres à toutes les écoles décernant
le diplôme d'ingénieur textile.
Une lettre adressée à notre École par ladite
Commission le 14 juin 1937 précise les
conditions à remplir lors de la création d'une
section spéciale d'ingénieurs en
octobre 1937 :
- recrutement par examen niveau baccalauréat
mathématiques complet,
- trois années d'études,
- culture générale scientifique,
notamment mathématiques, physique et
chimie, et culture générale technique, en
principe 1 h 1/2 de cours par jour,
- le reste du temps culture technique
professionnelle.
Le ministre de l'Éducation Nationale précise
"l'an prochain à pareille époque il
sera procédé à une nouvelle inspection
de votre École. Si vous ne vous êtes pas
conformés aux vues de la Commission...
nous serions amenés à retirer le droit
accordé à des écoles privées de décerner
le diplôme d'ingénieur". Le Comité
d'admistration de l'École réuni le 28 juin
décide de se conformer à cette nouvelle
organisation qui prévoit trois catégories
d'élèves :
-
section ingénieurs diplômés, avec 3
ans d'études, admission des élèves avec
le baccalauréat complet (séries
scientifiques),
- section brevet textile, avec deux années
d'études, admission des élèves avec le
baccalauréat 1 ° partie,
- section diplôme en Filature ou en
Tissage ou en Bonneterie avec une année
d'études, admission des élèves
titulaires du brevet industriel d'une École
Pratique du Commerce et d'Industrie.
Avec cette nouvelle organisation, l'École est obligée de consacrer des
sommes
importantes à l'engagement de
professeurs spécialisés et à
l'installation de laboratoires de technologie, physique et
chimie indispensables pour l'enseignement
scientifique. En outre, le jury d'examen
est nommé par le Ministère et présidé
par un
Inspecteur général de
l'Enseignement technique.
Le directeur de l'École Frédéric
ORTLIEB donne les informations sur ces
changements fondamentaux dans
l'organisation de l'École à l'Assemblée générale
de l'Association des Anciens en été
1938. A partir d'octobre 1937, dans la
section ingénieurs, 14 élèves suivent les
cours de première année, 12 passent en
deuxième
année, les derniers brevets d'ingénieur
textile après deux années d'études sont
décernés en été 1938.
D'ailleurs, cette réorganisation et le
ralentissement de la crise
font augmenter le nombre de
candidats à l'entrée. Malgré la
complexité des programmes que cette nouvelle
organisation a posée provisoirement au
corps professoral, 90 % des élèves subissent
avec succès les examens de fin d'année
1938.
En 1939, l'organisation d'une
quatrième section est envisagée pour des
ingénieurs
d'autres écoles désireux d'acquérir
des connaissances en matières textiles
avec une
durée d'études d'une année,
sanctionnée par le diplôme d'ingénieur
textile.

L'enfer de la guerre de 1939 à 1945
Pour la troisième fois depuis sa création, l'École subit le douloureux sort de sa
province, l'annexion de fait par
l'Allemagne hitlérienne dans des
conditions particulièrement tragiques.
La dernière année scolaire avant la guerre 1939/45 a commencé sous d'heureux
auspices. A la suite de l'institution de
la section ingénieur en 1937, les
effectifs vont en augmentant pour
atteindre, en automne 1938, 99 étudiants
dont 74 étrangers, 25 Français dont 5
Alsaciens. Cette année est perturbée par
la mobilisation de certains professeurs et
étudiants et par le rappel d'élèves étrangers.
Néanmoins les examens de fin d'année ont
lieu en été 1939 aux dates prévues et
72 candidats y sont admis.

Réfugiés indésirables
Pour la nouvelle année 1939/40 de nombreuses
inscriptions laissent augurer d'une année
record. Mais Mulhouse étant à la portée
de l'artillerie allemande, la déclaration
de la guerre force la Direction de l'École
à choisir entre sa fermeture ou son
transfert en des endroits plus sûrs dans
les départements français de l'Intérieur.
A l'instar de l'École de Chimie qui se
replie dès l'automne 1939 à Toulouse et
par la suite à Lyon, notre Direction,
avec l'appui des autorités et de la
Direction Générale de (Enseignement
technique, cherche des locaux à Dijon,
Roanne, Lyon, Épinal, Elbeuf pour s'y
installer provisoirement pendant la durée
des hostilités. En vain. Personne ne
voulant de cette École, le Conseil
d'Administration se voit contraint en
novembre 1939, la mort dans l'âme, de
fermer l'établissement et de renvoyer les
élèves inscrits.
Après l'invasion de l'Alsace par l'armée
allemande en juin 1940, le directeur Frédéric
ORTLIEB qui venait d'être promu en août
1939 Chevalier de la Légion d'Honneur,
reste à son poste pour garder l'École et
veiller au bon entretien de ses
installations. Il prend contact avec les
autorités d'occupation en vue de
reprendre (activité tout en conservant à
l'École le caractère d'indépendance dont
elle avait joui depuis l'origine. Mais,
comme il fallait s'y attendre, les
Allemands prennent petit à petit
possession de l'École pour s'y installer.
Alors, plutôt que de signer des déclarations
de loyalisme qu'on lui présente, explique
Frédéric ORTLIEB qui a 63 ans, il préfère
demander sa retraite. Il quitte son
logement qu'il a occupé à l'École pendant
28 ans mais a pris soin de mettre les
archives de l'École en lieu sûr.

Annexion nazie de 1940 à 1944
En mars 1941 arrive un professeur allemand qui
devait commencer à organiser des cours du
soir pour contremaîtres et débutants. Le
1er décembre 1941 le directeur allemand
de l'École Textile de Chemnitz,
Oberstudienrat BAUER, vient s'installer
dans notre École. Le 1er avril 1942, elle
reprend officiellement ses activités
d'enseignement sous le nom de
"Staatliche Textilfachschule",
d'abord pour l'instruction de contremaîtres
et de techniciens et l'année suivante,
sous le nom de "Textilingenieur
Schule" pour la formation d'ingénieurs.
Durant ces trois années d'occupation, l'École a formé une soixantaine de
techniciens et cinq ingénieurs. Grâce à
cette École, un certain nombre de jeunes
Alsaciens a également pu reculer la date
fatidique de l'enrôlement de force dans
l'armée allemande.
Un enseignement de 36 heures hebdomadaires est
dispensé par le directeur BAUER pour la
théorie de liage en tissage et par des
professeurs allemands, JANSEN, venant de
Nordhorn, pour la technologie de filature,
BULWER pour les matières textiles, l'échantillonnage,
la métrologie et une initiation à la
filature (pour le tissage), au tissage
(pour la filature) et au finissage,
KLOTTER de Heidelberg pour la mécanique,
le dessin, etc. Ce dernier prend également
en charge l'instruction politique nazie!
Quelques Alsaciens, anciens élèves de
notre École engagés dans l'industrie,
complètent le corps professoral en tant
que vacataires: les ingénieurs à la S.A.C.M.
Émile MIESCH (promo 1925), Gaston MARTIN
(1901-1968, promo 1920), René
SINGER (promo 1926), pour le tissage et l'échantillonnage.
Des techniciens instructeurs dont Jean
GSELL (de 1928 à 1947) pour la préparation
tissage et la bonneterie, et de l'été
1942 à fin 1944, Paul STAAD pour les
travaux pratiques, Joseph KOLLIFRATH pour
la filature, etc. s'occupent de la
formation en atelier. En été 1944,
plusieurs étudiants sont embauchés pour
des travaux de laboratoire et d'assistance
aux professeurs. Dans la cour de l'École,
des élèves creusent des abris
anti-aériens.

Un an de flottement en 1945
Ce directeur allemand et son personnel restent en
fonction jusqu'en novembre 1944. Grâce à
l'avancée rapide des troupes françaises
de libération, les Allemands, quittant précipitamment
Mulhouse, ont laissé tout en plan. Les bâtiments
et installations sont sortis indemnes de
la tourmente . Début 1945, l'ancien
directeur Frédéric ORTLIEB remet les
archives françaises en place, mais, âgé
de 67 ans, il exprime le désir de ne pas
reprendre la charge de la Direction de l'École. Le Conseil l'appelle à siéger
en son sein en le nommant membre du Comité
d'Administration. Lavis de la Commission
d'Épuration du Comité de Libération du
Haut-Rhin installé à la Sous-préfecture
de Mulhouse est
sollicité avant de réintégrer certains
enseignants alsaciens. En avril 1945, une
partie des membres du Comité de
l'Association des Anciens Élèves se réunit
pour la première fois après la guerre
pour s'inquiéter de l'inertie du Conseil
d'Administration de l'École dépourvue de
Direction et de corps professoral. Frédéric
ORTLIEB y fait un rapport sur l'évolution
de l'École depuis 1919 et notamment
pendant la sinistre période de
l'occupation. L'ancien directeur souligne
le danger grave qui menace l'École si la
situation de léthargie actuelle devait se
prolonger. Le Comité décide d'effectuer
une démarche auprès de Jean DOLLFUS, président
de la SIM et vice-président du C.A.
de l'École, rentré depuis peu à
Mulhouse, en l'absence de Paul
SCHLUMBERGER, président du C.A.
de l'École et président d'honneur
de l'Association, pour connaître ses
intentions à
l'égard de notre École.
Après une période de flottement, la Direction
de l'École est confiée à Léon SCHULTZ
qui entre en fonction le ler août 1945
mais doit se retirer au bout de trois mois
pour raison de santé. A partir de cette
date, Gaston MARTIN, professeur
de tissage, dirige l'École par intérim et Victor
HILDEBRAND, professeur de tissage et de
bonneterie, est chargé par le Conseil de
recruter les professeurs et de réorganiser
les cours au niveau d'avant-guerre.
BURNER et LEHÉ en filature, MARTIN et
MITTERAND en tissage et LALLEMAND en
bonneterie forment la première équipe de
base d'après guerre. Les cours
d'instruction générale sont dispensés
par les mêmes professeurs vacataires
qu'avant la guerre. A l'instar de l'École
de Chimie qui reprit ses activités en
octobre 1945, l'École rouvre ses portes le
15 novembre 1945 à 129 élèves dont 113
Français et 16 étrangers. Les frais de
scolarité se montent alors à 13.000 F
annuellement pour les nationaux et 19.000
F pour les étrangers, l'année suivante
resp. 17.000 et 25.000F. Une cérémonie
officielle de rentrée a lieu le 8 janvier
1946 en présence du Commissaire de la République
BOLLAERT, du Préfet du Haut-Rhin
PAIRA, du Maire de Mulhouse WICKY, du
Doyen de la Faculté des Sciences de
Strasbourg WEISS, du Président de la SIM
Jean DOLLFUS, du Président de
l'Association des Anciens Élèves Pierre
LAVER, du Conseil d'Administration, des
professeurs, des élèves, etc... Victor
HILDEBRAND prend officiellement la
Direction de l'École en mars 1946.
C'est le début d'une longue période de profonde
adaptation.

25. Vers la
nationalisation
Le perfectionnement constant des programmes et le
rehaussement du niveau polytechnique du
titre d'ingénieur nécessitent des moyens
accrus. La superbe affirmation de l'esprit
franc-tireur mulhousien de 1922 est
battue en brèche. L'ancienne structure de
l'École privée indépendante, sous l'égide
de la SIM, ne semble plus répondre aux
nouvelles exigences de ressources. Le
Comité de Direction de l'École doit
envisager une réforme lui permettant de
s'appuyer davantage sur le soutien de l'État. Tant pis pour l'indépendance. A
l'Assemblée générale des Anciens de
juin 1958, Victor HILDEBRAND se posant la
question fondamentale sur la justification
de cinq grandes écoles textiles en France
au vu de la désaffection des jeunes pour
l'industrie textile, annonce de
bouleversants projets d'avenir: le très
prochain rattachement de l'École à l'Éducation Nationale, la construction
d'une nouvelle École dans le cadre
grandiose du futur Campus Universitaire,
l'adaptation de l'enseignement dans le
domaine des sciences et des méthodes de
travail, etc. Mais par ailleurs, la sélection
d'admission des élèves se complique car
le niveau général en fin des études
secondaires semble être en baisse alors
que les bons éléments ont un plus grand
choix pour poursuivre leurs études et que
notre formation est devenue supérieure.
Paul WINTER, président des Anciens, après
une visite de l'École de Reutlingen dans
le cadre de V.D.I., déclare à cette A.G. que
notre École pourrait faire au moins aussi
bien que celle de Reutlingen qui, rattachée
à l'Université de Stuttgart, compte 700
élèves dont 40 % d'étrangers et dispose
d'installations et de matériels
ultramodernes, dont certains de provenance
française qui n'existent pas à l'École
de Mulhouse. "Nous devons faire
davantage de publicité pour notre École".
Ce rattachement tant souhaité n'arrive pourtant
pas rapidement. En 1960 le nouveau
programme d'études de l'École est inséré,
pour la première fois depuis la guerre,
sous forme de page publicitaire dans la
revue des Anciens qui s'appelle alors
"Les Annales Textiles" (Annexe N°
11). A cette époque, sous la Direction de
Victor
HILDEBRAND, le corps enseignant est renforcé et
en grande partie renouvelé : RENARD,
DETHOOR et THEILLER pour la filature
coton, HUSER puis LUDWIG pour la filature
laine, HANN, KIRSCHNER et BURGER pour le
tissage, PAPEGAY, DUNGLER et HILD pour la
maille, SPECKLIN pour les nontissés,
SCHUTZ et HABERBUSCH pour la métrologie
et les matières textiles, SCHUTZ et J.
DUNGLER pour la chimie et
l'ennoblissement, BRAUN pour la mécanique
et le dessin industriel, CALLOT, JUNG,
LUDWIG, FISCHBACH pour la physique et la
physique industrielle, etc. Cet effort de
renouvellement du corps professoral se
poursuivra et quelques années plus tard,
François RENNER pour le tissage et R.
PETITEAU pour les sciences de l'ingénieur
viendront renforcer l'équipe enseignante
permanente.
A la même époque, le vice-président délégué
du Conseil d'Administration MONNIER déclare
"l'École ne peut plus demeurer indépendante
dans une ville qui a vocation
universitaire ; comme l'École de chimie,
nous avons choisi le rattachement à
l'Université". A l'A.G. des Anciens de
1964, on s'impatiente car la promesse
faite en juin 1958 n'était toujours pas réalisée.
Au moment où un membre du C.A. de l'École répond
à un étudiant "l'École sera sans
doute fermée" et où un recteur
estime que "l'École n'avait pas rang
universitaire", Victor HILDEBRAND
souligne que "personne n'accroche ses
soucis au-dessus de sa porte"
et console les impatients en rappelant que
le rattachement de l'École de Chimie a
bien duré dix ans, de 1947 à 1957.
En fait, le principal obstacle à la prise en
charge de l'École par l'Éducation
Nationale est essentiellement d'ordre pédagogique.
Déjà en 1954, à l'instigation du Ministère
et de la Commission des Titres d'Ingénieurs,
le professeur MAILLARD, Inspecteur général
de l'Enseignement Textile Supérieur est
chargé d'un audit pédagogique de l'École.
Il s'intéresse davantage aux niveaux mathématiques
et scientifiques classiques qu'aux
connaissances spécifiquement textiles des
élèves qu'il interroge. Suite à son
rapport, il est décidé de maintenir
l'habilitation de l'École à délivrer le
titre d'ingénieur textile. Mais en
1962-63 le Ministère et la Faculté
des Sciences de Strasbourg à laquelle est
rattaché le tout nouveau Centre
Universitaire de Mulhouse, jugent
insuffisant le niveau de l'École. De plus,
le maintien d'une formation de Techniciens
supérieurs, parallèle à celle des Ingénieurs,
est fort mal vu à Strasbourg. C'est
pourquoi, sur conseil du professeur
BENOIT, doyen de la Faculté des Sciences
de Strasbourg, le professeur
Jean-Baptiste DONNET, futur
Directeur de l'École Supérieure de Chimie
de Mulhouse, avec l'appui de la SIM présidée
par Bernard THIERRY MIEG, demande à
Richard SCHUTZ, professeur à l'École Supérieure
de Chimie et à mi-temps à l'École
textile (de 1951 à 1960), d'élaborer un
nouveau programme pédagogique plus
conforme "au niveau et à l'esprit
universitaires".

1966
: École Supérieure des Industries Textiles
C'est grâce aux efforts conjugués de toute une
équipe comprenant le Directeur de l'École
Supérieure de Chimie et du Centre de
Recherche de la Physico-Chimie des
Surfaces Solides Jean-Baptiste
DONNET, le Conseil d'administration de l'École sous la présidence de
Jean-Mathias HORRENBERGER, la Société
Civile de l'École textile sous la présidence de Pierre SIEGER, la
Municipalité de Mulhouse, la Direction de
l'École, l'Association des Anciens élèves
présidée par René DUC et les milieux
politiques que put être annoncé à l'A.G.
des Anciens de juin 1966 : "Nous voilà
arrivés au but ! La reconnaissance
officielle du rattachement à la Faculté
des Sciences de l'Université de
Strasbourg le 26 mai 1966, confirmée par
le décret du 26 août, de notre École qui
s'appellera dès lors École Supérieure
des Industries Textiles de Mulhouse"
(Annexe N°
12). Désormais, les diplômes
seront signés par le Recteur de l'Académie
de Strasbourg.
Au cours de cette mémorable Assemblée, Victor
HILDEBRAND se lève pour tenir "son
dernier discours, arrivé au terme d'une
longue période de travail riche en
soucis, misères et tribulations, où rien
n'a manqué, même pas les fins de mois
difficiles. Mais les résultats obtenus
par les élèves pèsent davantage dans la
balance". A cette occasion, son
successeur, Jean René MEUNIER, appuyé
par Jean-Baptiste DONNET, se présente
"comme un néophyte électricien-électronicien,
parachuté au milieu des textiles en
suivant sa destinée".
Outre l'acquisition d'équipements modernes
notamment dans le domaine de métrologie
et des sciences de (ingénieur, le nouveau
Directeur jean René MEUNIER mène une
politique de changements profonds dans le
fonctionnement de l'École, en particulier
sur le plan pédagogique selon le projet
agréé. Le niveau scientifique des
enseignements est considérablement
rehaussé et des disciplines nouvelles
relevant des sciences de l'ingénieur
introduites, tandis qu'on s'achemine vers
la suppression de la section des
Techniciens.
Désormais il ne s'agissait plus tellement de
dispenser des connaissances technologiques
encyclopédiques des processus textiles
traditionnels mais de former des ingénieurs
susceptibles d'analyser les processus, de
procéder aux changements, de concevoir
les innovations, ceci dans le cadre d'une
rentabilité industrielle. La formation
comprend dès lors :
- des compléments en sciences et
techniques fondamentales pour ingénieur,
- les sciences et techniques spécifiquement
textiles,
- une initiation aux problèmes de
l'entreprise et de la recherche, suivie
d'un stage en entreprise de trois mois en
fin de scolarité,
- une initiation en sciences humaines,
sociales, économiques et de
communication.
L'arrêté ministériel du 4 avril 1969
officialise et impose l'introduction de
disciplines nouvelles : électrotechnique
et électronique, métallurgie structurale
et plasturgie, langues vivantes et
informatique, statistiques appliquées,
gestion et marketing, etc... Le nouveau
programme est publié dans les Annales
Textiles d'avril 1968 (Annexe N°
13). Mai
1968 a aussi des influences sur
l'organisation et le fonctionnement de l'École ainsi que sur la composition du
Conseil d'Administration (plus forte représentation
du corps professoral, de l'Université,
des étudiants, etc.).

1971 : le creux de la vague
En dépit du rattachement à l'Université Louis
PASTEUR de Strasbourg, l'École voit sortir
cette année la plus faible promotion de
son histoire avec 2 ingénieurs et 7
techniciens supérieurs, comme en 1862 après un
an de fonctionnement. Avec la nouvelle
organisation, la plupart des candidats
sont recrutés sur concours au niveau des
classes préparatoires aux Grandes Écoles
Scientifiques (Mathématiques Spéciales)
dans les centres d'examen de Paris et de
Mulhouse, les candidats sur titre détenant
un D.U.E.S. (D.E.U.G.) ou D.U.T. Mais les
candidats ne connaissent guère l'E.S.I.T. de
Mulhouse ce qui explique le recrutement médiocre.
Une nouvelle fois, le Ministère envisage
d'abandonner l'École et de la fermer.
C'est compter sans la fougue et la ténacité de
Pierre SIEGER, devenu président des
Conseils d'Administration de l'École et du
Centre de Recherches Textiles. II s'engage
non seulement en faveur du maintien de l'École, mais de son développement avec
une nouvelle construction, les anciens bâtiments
en bordure du canal de décharge de l'Ill
étant inadaptés et devenant un danger
public. Richard SCHUTZ, directeur des Études
depuis 1974, secondant en 1975 Jean
René MEUNIER en tant que
Directeur-adjoint, relève le défi,
veut faire de l'École de Mulhouse "la
meilleure école textile de France, sinon
du monde" et donne une nouvelle
impulsion à ces démarches. Il développe
la recherche pour former des enseignants
ingénieurs textiles-docteurs. Afin
d'attirer à l'École des élèves
candidats, il prend son bâton de pèlerin
pour faire connaître l'industrie textile
à l'Amicale des Professeurs de
"taupe" : "L'industrie
textile française représente 45
milliards de chiffre d'affaires annuel
comparable à celui de l'industrie pétrolière
et devançant celui de l'industrie
automobile. La France est le troisième
constructeur de matériel textile du
monde, dont 80 % se situe dans le
Haut-Rhin. Le textile est à la
base de nombreux progrès techniques, tels
le différentiel équipant tous les véhicules
automobiles du monde, la chromatographie
analytique, l'automation, les cartes
perforées utilisées en informatique de
première génération, etc..." D'autre
part, comme l'Institut Universitaire de
Technologie de Mulhouse ouvre une section
"Génie Mécanique à Orientation
Textile", notre École perd alors la
section des techniciens supérieurs dont
la dernière promotion sort en juin 1973.
Cette option ne figure plus au programme (Annexe N°
14).
Toute cette nouvelle dynamique contribue à l'amélioration
de l'image de l'École. Les deux centres
d'examen enregistrent au concours d'entrée
quelque 120 demandes, ce qui permet d'espérer
atteindre l'objectif prévu de nouvelles
promotions de 30 à 40 ingénieurs. En
1975, le Secrétaire d'État aux Universités
en tournée à Mulhouse pour inaugurer la
création de l'Université de
Haute-Alsace, annonce la
nationalisation des deux Écoles d'ingénieurs
de Mulhouse et leur intégration prochaine
à la nouvelle Université, assortie de la
promesse d'une contribution de l'État à
l'édification des nouveaux bâtiments de
l'École !
En 1976, Richard SCHUTZ quitte la chaire qu'il
occupe à l'E.S.C.M. pour prendre à temps
complet la direction de l'École. "Les
difficultés pour faire nationaliser notre
École sont innombrables, reconnaît le
nouveau Directeur à l'A.G. des Anciens de
1977, le budget n'est assuré que pour 50
% par l'État, l'École ne compte aucun
fonctionnaire, les anciennes structures
administratives sont à modifier, les
sciences textiles ne sont pas reconnues
comme discipline universitaire, etc...".
Il fallait la ténacité, l'acharnement
voire une dose de folie des responsables
pour ne pas se décourager. En effet, ce
n'est qu'au bout d'une quarantaine
d'entrevues avec les différentes
instances ministérielles à Paris, sans
compter les innombrables démarches auprès
es industriels, de la Ville, du Département, de
la Région, etc..., que le financement de
cette construction fut assuré.

1977
: l'Ensitm
dans sa nouvelle version
Par décret du 5 avril 1977 l'École de Mulhouse,
seule École en France dans cette spécialité,
est érigée en ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES INDUSTRIES TEXTILES en tant qu'Unité
d'Enseignement et de Recherche (U.E.R.) de
l'Université de Haute-Alsace
formant des ingénieurs E.N.S.I. (bac + 5) et
permettant à des chercheurs de préparer,
à l'issue d'un Diplôme d'Études
Approfondies (D.E.A.) en Sciences des fibres
textiles et des matériaux macromoléculaires
(devenu en 1984 "Génie des processus
et des matériaux textiles et
paratextiles"), un Doctorat en
Sciences de l'Ingénieur de l'Université
de Haute-Alsace.
Avec l'État assurant 80 % du budget vers 1982, il
revient à la Direction et à la Présidence
du Conseil d'Administration de l'École de
collecter le solde auprès du Syndicat
Textile, des Collectivités et par la Taxe
d'apprentisage. On élimine enfin les
problèmes matériels et financiers tout
en accroissant considérablement la
paperasse (rapports, budgets, contrôle,
etc...). A cause des problèmes juridiques
relatifs au transfert de propriété et
des difficultés administratives
concernant le paiement du personnel, est
créé, à côté de la Société Civile,
un nouvel organisme "Association pour
le développement de la formation et de la
recherche textile" (A.D.F.R.T.) présidé
par Pierre SIEGER qui sera l'employeur
pour le compte de l'Université du
personnel de droit privé de l'École (Annexe N°
55).
La nouvelle maison est inaugurée en décembre
1977 par le Directeur du cabinet ministériel
BEGUIN. A cette occasion, le professeur
J.B. DONNET, président de l'Université
du Haute-Alsace, fait l'éloge du
travail accompli en commun : "Là où
il y a une volonté, il y a un
chemin". L'A.G. des Anciens s'y tient
pour la première fois en juin 1978. Une
nouvelle page de l'histoire de l'École est
tournée.
Sous la Direction de Richard A. SCHUTZ, l'équipe
pédagogique est renforcée par les
professeurs universitaires DUPUIS, SIGLI,
WOLFF et VIALLIER pour le développement
des activités de recherche. Les premiers
diplômes d'ingénieur Ensitm sont délivrés
à la promotion 1980. L'École est également
habilitée à décerner des diplômes
d'ingénieurs dans la spécialité textile
pour les cas de promotion sociale. Le
recrutement des élèves se fait désormais
par la voie du Service des Concours
Communs Polytechniques et un quota réservé
aux titulaires d'un diplôme universitaire
de technologie (D.U.T) et après étude de
leurs dossiers (Annexe N°
15). C'est
aussi en 1980 que l'ENSITM dans le cadre
de l'Université de Haute Alsace, devient
le seul établissement français à être
habilité à délivrer un doctorat en la
spécialité des sciences textiles, ce qui
lui vaut la venue d'étudiants d'autres Écoles supérieures textiles de France,
mais aussi de plusieurs pays étrangers
(Allemagne, Égypte, Italie, Maroc,
Tunisie, Vietnam, etc.) pour préparer
leur D.E.A. et/ou leur thèse à l'École.
La collaboration régionale et nationale est également
intensifiée.
- Liaison plus étroite avec le Centre de
Recherche Textile de Mulhouse (C.R.T.M.)
affilié à l'Institut Textile de France,
créé en 1947 à l'initiative de l'École
de Chimie de Mulhouse.
- Création en décembre 1974, à
l'instigation du président Pierre SIEGER
sous le patronage du Centre de Recherches
Textiles et de l'École, d'un Atelier Expérimental
Textile de la Région Est (A.E.T.R.E.),
accueilli fin 1977 à l'École, regroupant
des professeurs, des industriels et des
constructeurs de la région pour définir
et entreprendre ensemble des programmes de
recherche, notamment avec le concours d'élèves
D.E.A. et doctorants de l'École.
- A la même époque, accueil dans les
sous-sols de l'École et
collaboration étroite avec le Centre de
Recherche Mécanique Appliquée au Textile
(C.E.R.M.A.T.), créé à l'initiative des
constructeurs alsaciens de matériel
textile et dirigé par Michel AVEROUS,
professeur à l'École.
- Fondation d'une Association pour le Développement
des Écoles Supérieures Textiles (A.D.E.S.T.).
regroupant une trentaine d'établissements
français, dont les cinq Écoles d'ingénieurs,
des Lycées techniques, l'Union des
Constructeurs de Matériel Textile Français,
l'Institut Français de la Mode, etc, avec
siège à l'École de Mulhouse et secrétariat
assumé par VIALLIER.
Toutefois, étant donné l'effet négatif sur les
jeunes des articles de presse relatant les
licenciements dans l'industrie textile, le
problème du recrutement des élèves
reste préoccupant. Un nouvel effort de
publicité est entrepris dans les années
1980 : visite à l'École des professeurs
des classes spéciales et portes ouvertes
en 1982, interview à FR3, articles dans
les journaux locaux et nationaux, à la
radio et sur les chaînes de télévision,
etc. Un classement des écoles d'ingénieurs
publié dans la revue Le Point de novembre
1982 place l'Ensitm au vingtième rang de
toutes les écoles, loin devant les autres
écoles textiles. "Pourtant, déclare
Claude WOLFF qui assure la Direction de l'École à partir de janvier 1987 à
l'A.G.
des Anciens de 1987, l'image de notre École
dans le public, à travers le
recrutement des jeunes fondé sur le
concours national des E.N.S.I. de Physique et
de Mécanique, n'est pas bon, car seuls
les étudiants reçus dans les deux derniers déciles
entrent à l'Ensitm".

Un rayonnement international
Richard SCHUTZ s'active pour faire connaître l'École à travers le monde. Les relations
internationales doivent demeurer un des
atouts majeurs de l'Ensitm
En février 1980, l'E.N.S.I.T. de Mulhouse accueille
le siège du Collège International de l'Enseignement
TEXtile (C.I.E.TEX.), structure
de liaison entre les 80 écoles textiles
du
monde dont SCHUTZ, plus tard VIALLIER, assume le
secrétariat. Cet organisme
s'occupe spécialement de l'étude des équivalences
internationales des diplômes et
des échanges inter universitaires d'étudiants et
de professeurs, etc... Outre la diffusion
de plus de 300 publications, de nombreuses conférences
sont prononcées en
Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, Grande
Bretagne, Italie, Pologne, Portugal,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie), aux États-Unis (Berkeley, Clemson,
Raleigh,
Triangle Resaerch, etc.), au Canada (Montréal,
Ottawa, etc.) au Brésil, à Mexico, en
Australie, en Nouvelle Zélande, au lapon (Kyoto
et Tokyo) et en Chine (Hangshou,
Souchou, Shanghai et Pékin, etc.). Au Portugal,
l'Ensitm devient le mentor et le
modèle de l'Enseignement Supérieur Textile à
Covilhà et à Porto-Guimarès. En
Italie, la Città degli Studi de Biella s'inspire
également du "modèle
mulhousien". En
Turquie le programme pédagogique de la Faculté
Textile du l'Université d'Izmir est
inspiré de Mulhouse, laissant aux Allemands la
construction des bâtiments. L'École
prend en charge la formation des futurs cadres
d'une usine textile construite par les
Allemands en Algérie. En juin 1980 le 4e
Symposium International sur l'Encollage Textile
(S.I.E.T.) est organisé à Mulhouse
avec 362 participants. En automne 1986, à
l'occasion du 125e anniversaire de l'École, est organisé sur le campus
universitaire de Mulhouse, parallèlement
au 7e S.I.E.T., le Premier Colloque
International des Nouvelles Technologies réunissant
plus de 600 participants venus d'une
trentaine de pays du monde entier.
A partir de 1987, les directeurs successifs
poursuivent cette politique d'ouverture
internationale de l'École tant dans le
cadre des contrats européens que hors CE.E.. EUROTEX, une institution européenne
de coopération entre l'université et
l'industrie regroupant des membres dans
huit pays européens est fondée en 1990
par treize Universités, écoles ou
centres de recherche textile européens,
dont l'Ensitm, avec siège à l'Université
de Minho au Portugal. En 1992 est créé
à l'École un département des relations
internationales pour gérer les échanges
d'enseignants et d'étudiants (Allemagne,
Angleterre, Belgique, Bulgarie, Canada, Grèce,
Hongrie, Israël, Italie, Maroc, Mexique,
Pologne, Portugal, Suisse, Tchécoslovaquie,
Tunisie, Ukraine, Vietnam, etc...). Le
Royaume du Maroc choisit le "modèle
mulhousien" pour créer, en étroite
collaboration pédagogique avec l'Ensitm,
deux écoles de techniciens supérieurs à
Casablanca et à Tanger et une École supérieure
d'ingénieurs textiles à Casablanca.

Formation pluridisciplinaire de haut niveau
A partir des années 1980, les élèves-ingénieurs
textiles se voient offrir la possibilité
de préparer simultanément la licence en Électrotechnique,
Électronique et
Automatismes (E.E.A.) de l'UHA.
Entre 1977 et 1995, 68 thèses de doctorat ont été
soutenues à l'École sous la direction
effective des professeurs de l'Ensitm et
en 1995196, 17 étudiants préparent un D.E.A. et 18 thésards un doctorat. Pour la
première fois en 1986, un prix A.D.R.E.R.U.S.
(Association pour le Développement des Relations entre
l'Économie et la Recherche auprès des Universités de
Strasbourg) est décerné à une thèse de
docteur-ingénieur textile.
Créé en 1980, le Laboratoire de Physique et Mécanique
Textile de l'Ensitm (L.P.M.T.) , associé au
C.N.R.S. - Jeune Équipe en 1986,
devient en mai 1988 comme seul laboratoire
textile en France, L.P.M.T.- Unité de
Recherche associée au C.N.R.S., dirigée
successivement par les professeurs
Danielle SIGLI, Claude WOLFF et Pierre
VIALLIER.
En 1983, une formation d'ingénieur en
confection-habillement, inexistante
en France, est envisagée et ouverte en
novembre 1985. A partir de ce moment, les
élèves avaient le choix entre deux
options en 3° année: ingénieur en
fabrications textiles ou ingénieur en
confection-habillement. En 1989, on
institue aussi une section spéciale
permettant aux ingénieurs diplômés
d'autres écoles d'obtenir en une année
un diplôme "ingénieur Ensitm spécialisé
en confection-habillement". La
même année, la Conférence des Grandes Écoles accrédite
l'École pour délivrer
le
Mastère Spécialisé en Ingénierie Confection-Habillement et plus tard
en Ennoblissement textile, une formation
intensive en une année accessible aux
titulaires d'un diplôme scientifique français
ou européen de niveau Bac + 5).
Le Syndicat Textile d'Alsace et PROTEXTAL créent
en 1986 l'InStitut Textile d'Alsace (IS.T.A.)
formant en deux ans des chefs de produits
textiles en recrutant des jeunes de niveau
D.U.T. ou B.T.S. Ce fut l'Ensitm qui prit en
charge toute la formation technique du
programme de PISTA.
Les étudiants, de leur côté, fondent en 1987
avec le soutien de la Direction de l'École
une Junior-Entreprise puis
Tex-Junior proposant des
prestations payantes aux industriels. Sur
cette lancée, ils éditent un journal
trimestriel "Crac". Ils
inaugurent également les voyages d'étude
en fin de troisième année dans les pays
étrangers lointains, U.S.A., Chine, Mexique,
Brésil, Vietnam, Indes, Thaïlande, etc.
En 1989 un Centre de Formation des Professeurs de
l'Enseignement Technique dans les spécialités
"Textile-Cuir-Habillement"
(matériaux souples) est ouvert à l'Ensitm dans le cadre de l'Université de
Haute-Alsace et l'Institut
Universitaire de Formation des Maîtres de
l'Académie de Strasbourg pour délivrer
le Certificat d'Aptitude au Professorat de
l'Enseignement Technique (C.A.P.E.T.).
A partir d'octobre 1987, l'École organise
annuellement avec un certain cérémonial
une rentrée officielle en présence des
présidents de l'Université de
Haute-Alsace, du
Conseil d'Administration de l'École, de la Société
Civile de l'École, des Anciens
élèves, ainsi que du directeur et du personnel
administratif, des professeurs et
chercheurs, thésards et étudiants. En septembre
199, Auguste KIRSCHNER major
de la promotion 1955 et professeur d'Université,
est nommé à la Direction de 'l'École, poste qui reviendra ainsi, pour la première
fois depuis 25 ans, à un Ancien
de l'École. En septembre 1995 il passe le
flambeau à son directeur-adjoint
Marc
RENNER, également ancien élève de l'Ensitm,
major de promotion en 1981 et
professeur d'Université.
Un événement universitaire notable eut lieu en
1992 : le titre de Doctor Honoris Causa est
décerné à un enseignant vacataire de
l'Ensitm, le professeur Ron POSTLE de
l'Université australienne de New South
Wales.
Un audit approfondi de toutes les composantes de
l'Université de Haute-Alsace, donc
également de l'Ensitm,. est effectué en
1993 durant les années 1991 à 93 par le
Comité National d'Évaluation des
Universités, aréopage indépendant du
Ministère de l'Éducation Nationale (Annexe N°
16). Ce rapport aux
conclusions particulièrement élogieuses,
lu par le directeur Auguste KIRSCHNER au
cours de l'A.G. des Anciens de juin 1993,
devient un atout de poids pour l'avenir de
notre École.
Une troisième option de la formation d'ingénieurs
textiles dans la spécialité Traitements
et Textiles Techniques (T3) (Annexe
N°17).
Cette option complète judicieusement les
deux autres mentions existantes
"conception et fabrications
textiles" et
"confection-habillement".
L'équipe enseignante des années 1995 est composée
des professeurs KIRSCHNER, Marc RENNER,
THEILLER, HUA VAN MINH pour la filature,
DRÉAN et RUÉ pour le tissage, BUENO et
TOILLON pour la maille, DURAND, ADOLPHE et
TOILLON pour la confection, BRINKERT pour
les nontissés, VIALLIER, LALLAM, JORDAN
et SCHACHER pour la chimie textile et
l'ennoblissement, LE MAGNEN, ADOLPHE et
SCHACHER pour la métrologie, LE MAGNEN
pour les matières textiles, DUPUIS,
CAMILLIÉRI, BRAND, FREYBURGER, LALLAM et
HUA VAN pour les sciences de l'ingénieur,
etc..., la direction des recherches étant
assurée par Pierre VIALLIER et la
direction des études par Dominique
DUPUIS.
En annexe N°
18, le comité
d'administration de 1995.
Innovation créative et communicante destinée
à la nouvelle promotion d'élèves ingénieurs
de 1° année depuis la rentrée 1994 : un
week-end d'intégration dans un
chalet des Vosges auquel participent le
personnel enseignant et administratif de
l'École ainsi que des anciens élèves.
Buts : développer l'esprit d'équipe,
faciliter l'intégration à l'École et
faire prendre conscience de l'implication
de leur futur métier d'ingénieur.
La liste des onze Directeurs de l'École de 1861
à 1996 est donnée
en annexe N° 19 et la
photographie de quelques-uns
en
annexe N° 20, les noms des Présidents du
Comité ou Conseil d'Administration depuis
l'origine
en annexe N°
21. On relève que
la longévité de fonction des directeurs
a considérablement diminué au fil des
135 ans d'existence de notre institution.
Le record de 27 ans est tenu par F. ORTLIEB. A moins que l'on compte également
les fonctions professorales de Victor
HILDEBRAND, appelé affectueusement
Bouboule par les élèves, qui cumulerait
alors 39 années au service de l'École.
Mais à ce compte-là, Auguste
KIRSCHNER serait le champion hors concours
avec plus de 41 ans de fidélité à l'École.

26.
Bâtiments et matériel
Vu le développement rapide du nombre d'élèves,
le local primitif, loué en 1861 pour
trois ans ayant permis le démarrage de l'École, s'avère rapidement trop exigu.
Dans son rapport du 29 juillet 1863 à la
SIM, Henri THIERRY, président du Comité
de Surveillance de l'École de Tissage mécanique
souligne la nécessité d'un local plus
vaste spécialement affecté à l'École de
Tissage, car "être propriétaire de
l'immeuble donne une forcé extraordinaire
à l'institution qui l'occupe". Le
Comité d'administration envisage donc la
construction d'un bâtiment définitif.
Une Assemblée générale des premiers
souscripteurs est convoquée le 24 février
1864 en vue d'une augmentation du capital.
On forme une nouvelle Société Civile
avec un fond social de 76.000 F divisé en
76 parts de 1000 F réparties entre 56
actionnaires mais qui ne touchent aucun
dividende.
1865
: la première École Textile
Un bâtiment à étage d'environ 375 m2 avec une
petite annexe pour la chaudière est édifié
en 1864 sur un terrain cédé à des
conditions avantageuses par André
KOECHLIN & Cie entre la rue
Gay-Lussac et le canal de décharge
(Annexe N°
22
et
23). C'est le début d'une longue histoire
d'un immeuble qui ne cessera d'être
agrandi et aménagé, selon l'évolution
du nombre des élèves et des besoins de
l'enseignement, près d'une dizaine de
fois pendant plus d'un siècle. En 1977,
l'École quittera sa vieille maison
d'origine pour un nouvel espace sur le
campus universitaire créé entre temps sur
les hauteurs des collines de l'Illberg.
Les travaux de construction sont terminés en
1865 et la section de tissage s'y installe
d'abord. L'équipement est renouvelé, à
la mesure de la nouvelle maison. Une
machine à vapeur à condensation de 12
chevaux, 28 métiers à tisser comprenant
les systèmes mécaniques les plus répandus,
excentriques, ratières, jacquard, déboîtage,
etc. et le matériel de préparation,
bobinoirs, cannetières, ourdissoirs,
pareuses, etc... A partir de 1867, l'atelier
expérimental industriel de 40 métiers à
tisser, travaillant à façon, y
fonctionne également jusqu'en 1870.
En 1866 on ajoute au sud du bâtiment principal
à étage un atelier en deux sheds de 400
m2 pour y installer, suite à la fusion
des deux Écoles, la filature déménagée
de l'ancien local loué.
Après avoir repris sa vitesse de croisière après
les années difficiles de 1870, un grave
problème préoccupe les dirigeants de l'École, la vétusté du parc de machines
datant pour la plupart de 1861 pour le
tissage et de 1864 pour la filature. En
1878 on fait un nouvel appel aux
constructeurs tant alsaciens et français
qu'étrangers "leur demandant de
contribuer au renouvellement et à la
livraison de matériel complémentaire de
l'École, soit en faisant dons de leurs
machines ou en les vendant à prix réduit,
soit en les exposant". En 1884, on
ajoute deux sheds, soit environ 400 m2,
pour installer beaucoup de nouveau matériel
de provenance internationale. Pour la
filature, construction A.K.C. devenu entre
temps S.A.C.M., constructions anglaises
DOBSON & BARLOW, HOWARD &
BULLOUGH, CURTIS Sons & Cie, Samuel
BROOKS, DICKSON, Robert HALL, Georges
HODGSON, garnitures de cardes lames
WALTON, John HYDE, montage et aiguisage de
garnitures de cardes HORSFALL &
BICKHAM, DRONSFILED, courroies POULAIN,
peignes extensibles Charles TROENDLÉ,
tubes et brochettes en bois STRENLÉ,
temples mécaniques LATSCHA, tubes en
papier MOREL & MOTSCH, SCHAFFHAUSER,
machines-outils avec tour à
fileter et perceuse,
HEILMANN-DUCOMMUN, STEINLEN,
appareils de laboratoire ULLMANN, etc.
Pour le tissage, métiers à tisser et
ratières HAHLO & LIEBREICH, HODGSON,
WITHESSMOTH, S.A.C.M., Construction de
Bitschwiller, HACKING, SUMNER, TATTERSAL
& HOLDSWORTH, VERDOL, BROOKS, etc. En
1891, la S.A.C.M. a renouvelé tout son équipement
et MERTZ de Bâle installe des appareils
d'humidification et de ventilation. Un peu
plus tard, avec l'enseignement de la
laine, on s'équipe également d'un
assortiment de machines S.A.C.M. travaillant
la laine peignée et vers 1896, d'un
assortiment de laine cardée. La vieille
machine à vapeur est remplacée par un
moteur neuf d'un autre modèle. D'autre
part, avec la vulgarisation de l'emploi de
l'électricité, on envisage dès 1894
d'installer "la transmission de force
par l'électricité où chaque métier à
tisser est mû par son moteur spécial".
Ce qui est réalisé quelques années plus
tard en même temps que la production de
l'énergie électrique par une
dynamo-génératrice de 65 volts et
50 ampères mue par une machine à gaz
pour faire tourner 6 moteurs de métiers
à tisser. De cette façon, à l'étude
pratique de la chaudière et du moteur à
vapeur, s'ajoute celle du moteur à gaz et
de la machine électrique.
Après l'Exposition de Paris de 1900 (industrie,
sciences et arts, éducation et
enseignement), l'École s'enrichit de
plusieurs machines exposées cédées
gracieusement à l'École par les
constructeurs. Un nouvel appel est lancé
pour compléter le matériel de tissage de
laine, l'achat de deux métiers soie avec
appareil jacquard lyonnais à grande
vitesse, un métier à tapis et un
bobinoir américain. Au début du siècle,
la S.A.C.M. met en dépôt une peigneuse
dernier modèle et remplace le self-acting
coton puis le banc-à-roches
en gros. GRUN et SCHLUMBERGER de
Guebwiller fournissent une peigneuse et
d'autres machines pour la laine.
En 1912 on construit une loge pour le portier,
une buanderie pour supprimer celle installée
à la cave du bâtiment principal et des
vestiaires avec W.C. pour les élèves. La
machine à vapeur est définitivement
remplacée par un moteur électrique.
Durant la fermeture forcée de l'École pendant la
guerre de 1914 à 1918, on en profite pour
améliorer l'organisation des immeubles,
installer le chauffage à l'eau chaude et
l'éclairage électrique.
Importants agrandissements entre 1920 et 1925
avec le doublement des quatre sheds
existants pour la filature, la nouvelle
section de bonneterie et la construction
d'un nouveau tissage, chacun avec une
salle de cours adjacente (Annexe N°
24).
La souscription ouverte début 1920
atteint en 1922 la somme de 385.000 F pour
un coût se montant à 470.000 F. On
comptait sur un solde de liquidation du
Comptoir des Chambres de Commerce
d'Alsace-Lorraine, alimenté avant
la guerre par l'industrie alsacienne, mais
l'État l'avait de suite accaparé. Le matériel
de tissage quitte l'étage du grand bâtiment
pour son nouveau local. Celui-ci
est transformé en grand amphithéâtre de
132 places. Désormais, les ateliers à
eux seuls couvrent une surface de 2500 m2
avec les machines les plus récentes en
filature, préparation, tissage,
bonneterie, laboratoire, etc. en
provenance de N.S.C., S.A.C.M., CROUZET,
SCHWEITER, Bitschwiller, etc... Les quatre
salles de cours atteignent 350 m2 de
superficie.
Des travaux d'aménagement d'un laboratoire de
chimie et d'un amphi-labo de
physique sont entrepris en 1938 en même
temps que l'acquisition de nouveau matériel
de laboratoire. Une nouvelle extension de
ces laboratoires prévue en 1939 devait
servir également de Centre de recherche
textile permettant de doter notre
industrie alsacienne d'un outil de travail
susceptible de lui rendre d'indispensables
services.
En 1951, l'École agrandit son atelier de tissage
par un nouveau bâtiment en quatre sheds
ultramodernes de 1000 m2 et y installe une
salle de cours, un petit atelier
d'ajustage et un nouveau laboratoire de métrologie
textile en collaboration avec le Centre de
Recherches Textiles de Mulhouse
nouvellement créé. Cette extension, conçue
par l'architecte mulhousien SPOERRY et
construite par ZAHM et GYSPERBER pour un
coût total de 35 M F, financée par
l'industrie textile régionale, les
Chambres de Commerce, la ville, le département
et l'Enseignement Technique, est inaugurée
en 1952 par DISSLER (dont le père fut un
Ancien de l'École, promo 1893), Directeur
du Cabinet du Secrétaire d'État à
l'Enseignement Technique.
Le rattachement de l'École à l'Éducation
Nationale, évoqué dès 1958, devrait lui
procurer les moyens nécessaires à un
meilleur développement. La vétusté et
l'inadaptation de certains locaux et surtout les
dangers que présentaient notamment
l'affaissement partiel du bâtiment
administratif et l'effondrement d'un
morceau de la toiture de l'atelier de
filature datant de 1868, contraint les
responsables d'envisager une
reconstruction sur le campus universitaire
entre le Centre de Recherches Textiles et
l'École Nationale Supérieure de Chimie,
sur un terrain mis à la disposition par
la Ville de Mulhouse. Ce projet est une
nouvelle raison d'espérer. On estime les
coûts d'un bâtiment de 4000 m2 (contre
3500 actuels) à 240 MF auxquels il
faudrait ajouter 160 MF d'équipements
nouveaux ce qui ferait un total de 400 ME
Le budget de fonctionnement de l'École
serait grossi également du fait de
l'augmentation du personnel enseignant. Il
faudra presque 20 ans de l'idée à la réalisation
de cette nouvelle construction.

1977
: un bâtiment grandiose sur le campus
universitaire
Grâce aux efforts conjugués des instances
politiques et économiques, municipales et
régionales, ministérielles,
universitaires et industrielles, la
construction de 5.918 m2 de nouveaux
locaux est menée à son terme par
l'entreprise SAVONITTO après la pose de
la première pierre en septembre 1974 (Annexe N°
25). La rentrée scolaire dans
cette nouvelle maison sur la colline de
l'Illberg a lieu le lundi 17 octobre 1977.
L'inauguration est faite le 9 décembre
1977 conjointement par le Recteur J.
BEGUIN et le Député-Maire Émile MULLER en présence de plus de 600
personnalités, amis et visiteurs de
France et de l'étranger. Quant à la
vieille École du quai des Pêcheurs de
1864, les sheds de filature datant des années
1866 à 1920 sont démolis et le reste des
bâtiments réhabilité pour accueillir l'École des Beaux-Arts de Mulhouse.
En 1986, la nouvelle École s'est encore agrandie
de 1000 m2 supplémentaires de salles de
cours et de travaux pratiques, notamment
pour abriter le nouveau département de
confection. Avec l'augmentation du nombre
d'élèves et de filières et la
complexification des études, un nouveau
projet d'extension de 2000 m2 est prévu
pour les années 1997-98.

27.
La grande famille des étudiants
Après les balbutiements des trois premières années
d'existence de l'école, le nombre d'élèves
se stabilise entre 30 et 40 jusqu'aux événements
de 1870.
Les fils de manufacturiers et les autres
Le Comité de Surveillance de l'École observe l'évolution
des étudiants en les divisant en trois
catégories, selon leur origine sociale.
On fait le point en 1866 :
- "les fils d'industriels qui, à
leur sortie de l'École, ont leur place
assurée dans les établissements de leurs
parents" ; ils représentent 51 % de
l'ensemble ;
- "les fils d'employés industriels,
envoyés à l'École par des chefs d'établissement
qui désirent faire compléter leur
instruction avant de les recevoir définitivement
chez eux" ; ils ne sont que 15 % ;
- "d'autres jeunes gens" - ils sont 34 % des 133 élèves réguliers
considérés -, qui suivent les
cours "soit par vocation, soit par désir
d'utiliser dans l'industrie leurs capacités,
soit dans l'espoir de trouver une place de
directeur ou de contremaître".
En 1866, le Conseil d'administration de l'École
relève qu'une évolution se dessine en
faveur de la troisième catégorie ce qui
est interprété "comme un intérêt
de nombreux jeunes gens pour l'industrie
textile indépendamment de leur origine et
la preuve manifeste de la bonne marche de
l'École". D'ailleurs,
remarque-t-on, "ces
jeunes de la troisième catégorie sont
ordinairement placés comme directeurs,
contremaîtres ou employés de tissage par
l'intermédiaire de la Direction de l'École. Le chiffre de leurs appointements
varie, pour les débuts, de 1500 à 2000 F
par an".
A partir de cette époque on n'étudie plus ce
facteur de l'origine sociale, tout en
affirmant que "la Direction porte le
plus vif intérêt à la catégorie des déshérités".
De fait, on souligne à plusieurs reprises
la charge des frais d'écolage élevés (au cours des premières années
de fonctionnement de l'école, 600 F par
an, correspondant à un salaire annuel
d'un ouvrier) ce qui favorise, tout en le
limitant en nombre, le recrutement des
jeunes gens des classes aisées et élimine
les enfants de parents aux moyens
modestes. Pendant de nombreuses années on
envisage d'attribuer des bourses d'études
à des élèves, mais, faute de moyens, il
fallut attendre longtemps la concrétisation
de ces bonnes intentions.
Vers la fin du XIX° siècle, l'école subit une
chute du nombre de rentrées, surtout en
filature à cause de la pléthore de
cadres pour la filature où les jeunes
diplômés végètent trop souvent pendant
des années en attendant une promotion. En
1904, on offre des bourses à six élèves
alsaciens (sur 21) afin de faciliter le
recrutement régional. Le record annuel du
nombre d'élèves avant la Première
Guerre Mondiale est de 69 et 72 en 1910 et
en 1911.
Le démarrage après 1918 est impressionnant avec
57 élèves dès 1919, suivi de 122 et 119
les deux années suivantes. Le nombre d'élèves
croît régulièrement pour culminer en
1929 à 163 jeunes gens de 18 nationalités
différentes puis rechuter, suite à la
grave crise économique et de l'industrie
textile. Après un minimum de 45 élèves
en 1935, on remonte à 97 élèves en
1938. Ce creux d'élèves provoque
d'ailleurs pour l'industrie une pénurie
de cadres qui se placent facilement. La
crise internationale de septembre 1938
n'arrête pas le vigoureux élan de
redressement manifesté depuis 1937, cet
accroissement étant surtout dû à la
section d'ingénieurs. Néanmoins elle est
la cause de graves perturbations, notables
retards des inscriptions, impossibilité
d'obtention de visas pour plusieurs étrangers
et de rattrapage de retard pour d'autres.
La tension internationale en 1939
s'accentuant de jour en jour, de nombreux
élèves se trouvent mobilisés et les étrangers,
effrayés par l'importance du conflit qui
se prépare, rentrent précipitamment dans
leur pays d'origine.
Pendant la période désastreuse de la guerre de
1939 à 1945, à peine une soixantaine de
cadres sont formés sous une direction
allemande d'occupation. En 1946, la présence
réconfortante de 129 élèves de 7
nationalités, parmi lesquels des anciens
combattants et internés, marque la pérennité
de la renommée de l'École. Le nombre d'élèves
augmente encore pour atteindre en 1951 le
chiffre record de 188 de 12 nationalités
différentes, dont 80 diplômés. Vingt
ans plus tard, c'est un autre record,
négatif, de 9 diplômés sortis en 1971. Depuis
lors, les chiffres remontent régulièrement
avec 30 à 45 ingénieurs mis annuellement
à la disposition de l'industrie à partir
des années 1989. En 1994, le nombre d'élèves
fréquentant l'école dans les différentes
filières atteint 250, ce qui pose de
nouveaux problèmes d'espace.
Notons que vers 1895, l'école a déjà diplômé
1000 étudiants. Un siècle plus tard,
elle a formé quelque 5000 cadres de l'industrie
textile avec des variations annuelles considérables.
En annexe N° 26 on trouve un
graphique de l'évolution entre 1862
et 1996 des moyennes de cinq promotions
successives (ce qui écrête les pics).
Relevons également deux phénomènes sociaux
remarquables: d'une part, de nombreux élèves
ont fréquenté l'école textile de père
en fils. Nous citerons un seul exemple,
illustre, le directeur de l'école Victor
HILDEBRAND (1898-1987, promo
1920) est lui-même le fils d'un
Ancien, Victor HILDEBRAND, promo 1880 et
deux
fils ont fait leurs études à l'école (promo
1958 et 1960). D'autre part, on dit que l'Université est la meilleure agence
matrimoniale. A l'école textile peu de
femmes
font des études, mais on relève quelques
mariages d'anciens élèves.

De tous les coins du monde
Quant à l'origine géographique des élèves,
n'oublions pas que l'École fut créée en
1861 prioritairement pour les cadres de
l'industrie textile alsacienne. Toutefois,
on s'intéresse rapidement à l'élargissement
de son recrutement, ce que l'on considère
également comme un critère du
rayonnement de l'institution.
Un autre critère est celui de la réussite des
élèves aux examens. Nous avons calculé
par décennies (approximatives) depuis la
fondation jusqu'à 1939, le nombre de diplômés
comparativement au nombre d'inscrits.
Nombre de diplômés et d'inscrits à l'école
|
Année
1861/69
1870/79
1880/89
1890/99
1900/09
1910/14
1919/29
1930/39 |
|
Inscrits
220
240
220
380
480
275
1305
880 |
|
Diplômés
90
100
170
250
350
206
1120
704 |
|
soit
en %
40
42
77
66
73
75
86
80 |
On relève que le nombre de diplômés est
relativement faible durant les vingt premières
années, soit que les jeunes arrêtaient
les études en cours de route, soit qu'ils
ne se présentaient pas aux examens ou
qu'ils avaient échoué aux examens
finaux. Une des grandes constantes pendant
de nombreuses années avant 1914 est la
trop faible instruction initiale des
candidats, ce qui incite la Direction de
l'École à prendre plusieurs mesures de
collaboration avec d'autres écoles
techniques et professionnelles, de créer des cours
de vacances, etc. Avec les concours d'entrée
systémanquement imposés, ce taux de
diplômés remonte sérieusement après la
guerre
1914/18. Depuis 1945, le taux de
diplômés voisine autour de 90 à 95 %.
Quant à la répartition de
l'origine géographique des élèves
(principe adopté dès la
fondation de l'école), de
l'Alsace-Lorraine, des autres départements
français hors les trois départements de l'Est,
d'Allemagne et des autres pays étrangers,
voici les taux
approximatifs (les bases de calcul
ne sont pas toujours les mêmes), indépendants
du
nombre d'élèves, mais forcément
influencés par lui.
|
Années
1861/69
1870/79
1880/89
1890/99
1900/09
1910/14
1919/29
1930/39
1946/60
1961/70
1971/80
1981/94 |
|
Alsace
46%
27%
40%
47%
39%
39%
34%
21.7%
38%
13%
14%
21% |
|
France
34%
40%
15%
22%
34%
38%
46%
33%
41%
39%
66%
56% |
|
Allemagne
4%
4%
4.5%
5%
3.5%
4%
0%
0.3%
0%
0%
0%
0% |
|
Autres
16%
29%
40.5%
26%
23.5%
19%
20%
45%
21%
48%
20%
23% |
On constate que jusqu'à la grande crise économique
de 1930, le recrutement est régional pour
deux cinquièmes des élèves, répondant
parfaitement au but que s'étaient fixé
les fondateurs. Mais ce taux est en
diminution constante, l'apport régional
étant particulièrement faible de 1934 à
1939 et de 1965 à 1972. Le pourcentage élevé
après la Deuxième Guerre Mondiale est dû
à un recrutement local important,
l'industrie alsacienne refaisant son plein
de cadres.
Les élèves venant des autres départements français
ne dépassent jusqu'en 1970 jamais 40 %
sauf durant la décennie 1919/29 où ils
sont particulièrement nombreux pendant
les premières années d'après-guerre.
Depuis une quinzaine d'années, suite au
recrutement par concours national E.N.S.I.,
notre École est devenue très hexagonale,
au détriment du recrutement régional et
étranger. Notons que les années 1889 à
1891 n'avaient apporté presqu'aucun
contingent français à cause de
l'obligation de visa exigée par les
autorités allemandes pour venir en
Alsace.
Quant aux élèves d'origine allemande, leur
nombre oscille entre 0 et 5 %, alors qu'on
aurait pu s'attendre à une
"invasion" durant la période du
Reichsland de 1871 à 1914, puisque la
ville de Strasbourg comptait 25 %
d'Allemands et Mulhouse 20 %. Au
contraire, pendant les 17 années entre
1870 et 1887 on ne trouve au total que 15
étudiants allemands. On peut en conclure,
d'une part que les fonctionnaires et
militaires allemands installés en Alsace
à cette époque n'envoyaient pas leurs
fils dans une École tenue par les
industriels mulhousiens (francophiles) et
d'autre part, que les écoles textiles
allemandes avaient la préférence de
leurs concitoyens.
Le contingent d'étrangers, comparativement à
d'autres écoles textiles françaises, est
remarquablement élevé, à partir de 1870
entre 20 et 40 %, avec un fléchissement
pour raisons politiques avant la guerre de
1914/18. Les taux importants des années
1930/39 et 1961/70 s'expliquent par des
arrivées massives d'étrangers dont nous
parlons plus loin. Il est, en effet, intéressant
de connaître les pays d'origine de nos
recrues. La liste est impressionnante.
Déjà deux ans après la première promotion, en
1864, arrivent un élève de Suède et
deux Allemands, puis jusqu'en 1869 des
jeunes de Suisse, Hollande, Danemark. De
1870 à 1879, en dépit de la perturbation
de la guerre, en plus des nationalités déjà
signalées, on trouve des élèves
d'Italie, Grande-Bretagne, Belgique
et Autriche. Entre 1880 et 1889, c'est le
rush, car aux 9 nationalités citées
s'ajoutent des jeunes de Portugal,
Espagne, Bohême, Hongrie, Pologne, Brésil,
Turquie, Russie, U.S.A. et en 1890 du
Mexique. Si le nombre d'étrangers
augmente, le nombre de nationalités ne
changera plus jusqu'en 1921 où arrive un
Grec, la vingtième nationalité enregistrée.
Arrivée en masse en 1929 de 211 candidats, mais
après examen il n'en restera que 164 dont
72 étrangers avec un contingent de 30
Polonais. En 1932, les 45 étrangers représentent
17 nationalités différentes. Jusqu'en
1939, on ajoute aux nationalités déjà
citées des ressortissants d'Égypte,
Roumanie, Géorgie, Indochine, Lettonie,
Syrie, Chine, Bulgarie, Iran, Yougoslavie.
Cela fait 30 nationalités différentes en
trois quarts de siècle.
Le redémarrage de 1945 est difficile, la première
promotion de 129 élèves ne compte que 17
étrangers et celle de 1946/47 157 jeunes
avec 22 étrangers. Quelques années plus
tard, le nombre d'étrangers atteint la
trentaine, avec une très nette prédominance
d'Égyptiens, d'Italiens, de Portugais.
Jusqu'en 1960 on trouve encore, outre les
nationalités citées, des élèves
d'Irak, Honduras, Haïti, Indes, Liban,
Israël et Apatrides. A partir de 1960,
changement complet de la population des étrangers
avec l'arrivée massive de Vietnamiens,
Marocains, Tunisiens et Algériens, outre,
en plus de celles déjà citées, les
nationalités du Pakistan, Éthiopie, Côte
d'Ivoire, Dahomey, Ghana, Norvège, Équateur. Puis le contingent des étrangers
se stabilise autour de 20 % à partir des
années 1968 avec, entre autres, des étudiants
de Madagascar, Cameroun, Volta, Sénégal,
Afghanistan.
En annexe N° 27 nous reproduisons la photo de la
plus ancienne promotion trouvée dans les
archives de l'École, celle de la section
filature de 1885/86 avec 1 Français, 4
Mulhousiens, 4 Italiens, 1 Suisse, 1
Hongrois et 1 Polonais.
*
*
*
Nous venons de mettre en évidence combien la vie
de l'École est dépendante des événements
politiques et économiques et combien et
avec quelle opiniâtreté ses dirigeants
n'ont cessé d'adapter son enseignement
aux exigences des besoins de l'industrie
et de la science.
Il est proprement stupéfiant de constater la
rapidité avec laquelle les industriels
mulhousiens du XIXe siècle concrétisent
leurs idées. En 1860 il n'y a ni téléphone
ni électricité et les déplacements se font à
la vitesse du cheval ou d'un chemin de fer
balbutiant. Il leur faut à peine quelques
mois, après avoir été mis devant le
fait accompli du nouveau Traité de
commerce franco-anglais et avoir
analysé ses risques et ses conséquences,
pour élaborer un projet d'école,
rassembler les finances nécessaires,
trouver les hommes, un local et le matériel
pour créer une institution privée qui
fonctionne. A la même époque, dans
d'autres villes en France, il faut plus de
10 ans pour créer une École Nationale.
Dans les années 1960, il faudra plus de
10 ans pour rattacher cette École privée
à l'Université et bien plus pour
construire un nouveau bâtiment et y emménager.
Bien évidemment, l'entreprise privée a ses
limites. L'envers de la médaille, c'est
la vulnérabilité financière de l'École,
sa dépendance de la reconnaissance et du
nombre d'élèves. Cette vénérable
institution a fermé ses portes ou failli
être condamnée plusieurs fois, pour des
raisons économiques ou politiques, en
1874, de 1914 à 1918, en 1939, en 1945,
en 1964. Le nombre de diplômés formés,
critère dépendant de nombreux facteurs,
est très variable, de 9 en 1862 à 9 en
1971, en passant par des pointes de 80 à
90 en 1929 et en 1948 pour se stabiliser
autour de la quarantaine de nos jours.
Quant au nombre d'élèves, avec les
formations multiples dispensées depuis
les années 1980, il atteint aujourd'hui
quelque 250.
L'internationalité de l'École a toujours été un
atout. Dès les premières années, la fréquentation
de l'École par des étrangers est
importante, entre 20 et 40 %. Pendant un
siècle, ce sont principalement des jeunes
gens des pays européens et américains
alors que durant les quarante dernières
années, les étrangers viennent surtout
des pays francophones d'Afrique et d'Asie.
Depuis une vingtaine d'années, l'École
collabore de plus en plus avec toutes les
institutions du monde.
L'évolution des outils est aussi extraordinaire
que celle de l'enseignement. Si à
l'origine, il s'agit surtout d'acquérir
des connaissances technologiques encyclopédiques
aussi proches que possibles de la
pratique, de plus en plus, par le
rehaussement du niveau de recrutement et
de la formation polytechnique, on produit
des ingénieurs, des chercheurs, des
gestionnaires, des formateurs de haut
niveau.

Chapitre
III : la vie tumultueuse d’une
association centenaire
La création de l École Textile à
Mulhouse par la Société Industrielle
remonte à 1861. Nous venons d'en parler.
Ici nous relatons l'histoire parfois impétueuse
de l'Association depuis ses origines en
1896 et même depuis les premières
tentatives en 1868.
Si l'Association fête aujourd'hui
ses cent ans d'existence, des prémices
eurent lieu dès 1868. En effet, cette année-là,
quelques élèves des deux écoles qui
venaient de fusionner et d'entrer dans les
nouveaux locaux définitifs spécialement
construits à cet effet au quai des Pêcheurs,
décidèrent de former une Association et
élaborèrent des statuts. A cette époque,
le nombre d'élèves se montait à 40 par
promotion et l'école avait déjà formé
quelque 250 cadres pour l'industrie
textile. Mais, faute de participants assez
nombreux et enthousiastes et par suite de
la guerre franco-allemande désastreuse
suivie de l'annexion allemande de 1871,
cette initiative avorta.
Toutefois, les statuts furent
archivés.
31.
Une structure et des hommes
Les années passent. Ce n'est qu'en
1894, le 24 juin, jour de l'assassinat par
un anarchiste italien du président de la
République Française Sadi CARNOT, une étincelle
jaillit. Les étudiants étant en cours de
tissage avec le directeur Oscar WILD,
connu pour sa francophilie, à l'instar
des milieux industriels et étudiants,
apprennent ce tragique événement par la
bouche d'un condisciple italien. Le cours
est immédiatement suspendu et les étudiants
se retrouvent tous à Mulhouse où un monôme
de sympathie pour la France est organisé.
Nos textiliens essayent d'entraîner dans
leur sillage leurs camarades de l'École de
Chimie, mais sans succès, car ces
derniers comprenaient de nombreux futurs
chimistes de nationalité allemande dans
leurs rangs. Ils manifestent donc seuls,
mais la police du Kaiser veille. Le soir
nos étudiants se réunissent au Café
Luxhof de la rue du Sauvage, l'établissement
"in" de l'époque, pour arroser
l'événement et discuter de la fondation
d'une association des anciens élèves. En
effet, en 35 ans, l'école avait déjà
formé quelque 1000 cadres pour
l'industrie textile. Des statuts basés
sur ceux de 1868 sont élaborés et déposés
à la Kreisdirektion pour autorisation
d'existence juridique. Malheureusement,
cette autorisation, après enquête par
les autorités allemandes et au vu du
comportement francophile des étudiants du
textile, est refusée sans indication de
motif. Autre conséquence de leur
manifestation, à partir de cette époque,
les étudiants alsaciens n'ont plus le
droit - sous peine de refus de diplôme -
d'assister aux cours dispensés en langue
française à l'École qui enseigne ses
matières dans les deux langues, une
section française pour les Français et
les étrangers et une section allemande
pour les Alsaciens et les germanophones. Néanmoins,
les étudiants alsaciens continuent à
pratiquer la langue française et
deviennent ainsi parfaitement bilingues.
Sur les fonts baptismaux
Deux ans plus tard, fin juin 1896,
les étudiants fêtent avec leur
professeur de filature et ancien élève
Henry BRUGGEMANN (promo 1887/88) la fin
des études par un dîner dans la grande
salle de l'Hôtel de l'Europe. On décide
de tenter pour la troisième fois la création
d'une Association, on élabore des
statuts, cette fois-ci en deux langues, et
on charge le professeur BRUGGEMANN du secrétariat
provisoire. Le secrétaire envoie quelque
500 convocations aux Anciens pour assister
à une Assemblée générale constitutive
provisoire fixée au 22 décembre 1896 au
Café Luxhof. Si 75 convocations sont
retournées pour adresse incomplète, 55
anciens élèves se présentent au Luxhof
pour approuver les statuts (Annexe N°
30
et
31), y apposer leur signature
(Annexe N°
32) et procéder à l'élection du Comité
de l'Association. On choisit Gustave
DOLLFUS, fondateur de l'école et président
du Conseil d'Administration comme président
d'honneur, le directeur Oscar WILD comme
premier président d'une longue lignée
(Annexe N°
33 et
34), Jules BICKING (le 1°
élève de la 1° promotion 1861/62) comme
vice-président, Henry BRUGGEMANN comme
secrétaire-trésorier, Albert STORCK,
Paul GÉGAUFF, Auguste BREITENSTEIN et
Camille De LACROIX (vice-président du
C.A. et Chevalier de la Légion d'Honneur)
comme assesseurs. A noter que De LACROIX
et STORCK faisaient déjà partie en 1868
du Comité de la première association
avortée. On charge le secrétaire de la
demande d'autorisation auprès de la
Kreisdirektion. BRUGGEMANN, originaire de
Cologne, donc de nationalité allemande,
entretient d'excellentes relations avec le
Kreisdirektor SOMMER à Mulhouse. Il
demande encore une faveur supplémentaire
aux autorités allemandes, "rédiger
les statuts et la correspondance en langue
française avec les étrangers et les
autochtones qui ne maîtrisaient pas la
langue allemande, si le bien de
l'association l'exigeait". A
l'occasion d'une réception en l'honneur
du Dr. CHEBULIEZ, directeur (suisse) de l'École Professionnelle de l'Est à
Mulhouse, en avril 1897, SOMMER, entre la
poire et le fromage, glisse à l'oreille
de BRUGGEMANN : "Joignez au texte
allemand des statuts de votre Association
la traduction française si les intérêts
de l'Association l'exigent".
L’autorisation est accordée facilement
à BRUGGEMANN et notre Association fondée
officiellement.

Les Statuts : pérennité et
adaptation
Constituée le 30 juillet 1896,
notre "Association Libre des Anciens
Élèves de l'École de Filature et de
Tissage de Mulhouse" adopte également
son nom allemand "Freie Vereinigung
ehemaliger Schüler der Spinn und
Webschule Mülhausen" et se
singularise par le mot "libre".
Cet adjectif "libre" souligne à
mots couverts l'esprit antigermanique des
initiateurs. En effet, comme déjà signalé,
Mulhouse a envoyé à chaque élection législative
de 1873 à 1887 des députés
contestataires anti-annexion au Reichstag
à Berlin. Notre association
"libre" a aussi la particularité
de fonctionner avec des statuts rédigés
en allemand et en français, d'éditer une
"Revue de la Filature et du
Tissage" et un "Bulletin de
l'Association" dans ces deux langues.
Il faut néanmoins souligner que l'usage
de la langue française, si son
enseignement fut supprimé dès 1871 à l'école
primaire, n'était pas interdit, tout au
moins jusqu'à la guerre de 1914. Si les
discussions au Comité de notre
Association se font en français, les
rapports sont écrits en allemand. Même
si, par pur formalisme, l'article 32 de
ses statuts interdit toute discussion
politique ou religieuse, on peut
s'imaginer que ses membres ne manquent
jamais d'arrière-pensées politiques,
ainsi que le prouvent les différents
incidents relatés.
Une stabilité assurant la pérennité
de l'Association est garantie par
l'article 12 qui exige que les président,
vice-président, secrétaire-trésorier et
un membre du Comité devront habiter
Mulhouse. En effet, si cet article est
contraignant pour le choix des membres du
bureau, il a également permis de protéger
l'Association, entre 1897 et 1925 et au
cours de périodes politiquement troublées,
contre plusieurs attaques des groupes régionaux
tendant à prendre le pouvoir, à la décapiter
ou à la faire éclater.
Pour mieux asseoir la légitimité
du bureau, l'assemblée modifie en 1900
l'article 8 qui précise que dorénavant
les président, vice-président et secrétaire-trésorier
sont élus chaque année au sein du
bureau. En ce qui concerne les élections
des membres du Comité aux Assemblées générales,
on introduit en 1913 sur proposition du
groupe de Lille le vote par procuration en
limitant le nombre de pouvoirs à cinq. Le
même groupe de Lille, ayant le secrétaire-trésorier
BRUGGEMANN dans son collimateur, propose
de séparer les fonctions de secrétaire
de celles de trésorier, ce qui ne s'est
pas fait par manque de volontaires. Pour
alléger les travaux des Assemblées, on décide
également de modifier l'article 5 en
stipulant que "le Comité seul peut décider
de la réintégration d'un ancien membre démissionnaire".
Bien sûr, avec le retour dans le sein de
la mère-patrie et conformément au projet
des Anciens d'Épinal de 1915, retravaillé
par les Parisiens, "de déchirer les
statuts et d'en refaire des
nouveaux", on délibère au cours de
plusieurs réunions de Comité, des
statuts adoptés à l'A.G. de juillet 1919.
Enfin, en 1923, l'Association est inscrite
au Tribunal de Baillage de Mulhouse.
Toutefois, avec les changements du nom de
l'École, on sera encore plusieurs fois
obligé de modifier le nom de
l'Association. Les statuts de 1919
subissent encore d'autres modifications
mineures à partir de 1931 (Annexe N°
35).

Des assemblées générales
contrastées
Comme toute Association, les
Anciens se réunissent annuellement avec
un minimum de 25 membres, conformément
aux articles 22 et 23 des statuts, en A.G.,
suivie d'un banquet. Le même rituel se déroule
depuis un siècle avec une précision
horlogère : accueil par le président,
rapport d'activités par le secrétaire,
rapport financier par le trésorier,
quitus au Comité, questions diverses, etc…
Quant à la date, on précise en 1896
"le dernier samedi du mois de
mai", mais en 1901 on recule la date
à fin juillet pour la mettre en
concordance avec la fin des études. On
connaît ainsi les résultats scolaires.
Si le nombre de participants a toujours dépassé
le minimum exigé, il varie entre 35 en
1902 et un maximum de 170 en 1920, période
de remise en cause difficile.
Le choix de la salle pour organiser
une A.G. d'une centaine de personnes n'est
pas aisé à Mulhouse. L'Assemblée générale
constitutive a lieu le 22 décembre 1896
dans la salle de l'étage du Luxhof. Avant
la Première Guerre Mondiale le choix se
porte souvent sur l'Hôtel Central ou l'Hôtel
de l'Europe, le banquet ayant lieu dans le
même établissement. En 1904 on choisit
le nouveau restaurant du Zoo tout récemment
inauguré. Ce local a bien sûr l'inconvénient
de l'éloignement, car on ne dispose pas
assez de calèches pour monter la côte.
Il faut attendre 1908 pour pouvoir y
monter en trolley appelé le "sans
rails", "Gleislose" que les
Mulhousiens connus pour leur "parler
vrai" désignent par "dr.
Geischtlose" parce que ce trolley déraille
facilement. De nombreux Anciens, toujours
aussi indisciplinés hors profession, en
profitent pour flâner dans le beau parc
du zoo ou lors de la belle montée pédestre
avant de se rendre à l'A.G. Mais à la
suite de l'incident avec la musique
militaire allemande, on abandonne jusqu'en
1919 ce local pour revenir en ville. En
1905 le président BICKING, ingénieur en
chef à la S.A.C.M. met à la disposition
de l'A.G. la grande salle de la Société
Ouvrière de la S.A.C.M.. De 1920 à 1939,
on se réunit à tour de rôle à la Salle
de la Bourse, au Salon d'or du Casino du
faubourg de Colmar ou au Salon Vert du Café
MOLL. L’A.G. du retour à la paix en
1946 est aussi un retour aux sources, car
elle se tient à l'École où l'on inaugure
également la plaque commémorative des
Morts pour la Patrie. Les autres se
tiennent, selon le cas, à la Chambre des Métiers,
à la SIM, au Zoo, au Moll. Mais, à
partir de 1952, on revient à ses premiers
amours, l'amphithéâtre de l'École où
l'A.G. se tiendra pratiquement toujours.
Si les Assemblées générales
rythment la vie de l'Association, elles
sont marquées par les événements extérieurs,
sociaux, politiques, économiques et les
circonstances internes, création,
croissance, crises, commémorations, etc…
En dehors des périodes de paisible
ronronnement, les temps de rupture
tumultueux marquent toujours l'A.G. Nous
avons eu l'occasion de le souligner à
plusieurs reprises.

Comité et membres, actifs,
honoraires et d'honneur
L’article 7 des statuts de 1896
précise que l'Association est administrée
par un Comité voté au scrutin secret
pour 3 ans par l'Assemblée générale et
se renouvelle par tiers chaque année. Le
Comité comprend 9 membres dont le président,
le vice-président, le secrétaire-trésorier.
Très tôt, on se rendit compte que le
nombre de membres du Comité était
insuffisant et on modifia les statuts en
conséquence. Avec la création des
groupes régionaux à partir de 1907, le
président ou le délégué de chaque
groupe régional devinrent membre de droit
du Comité. Pendant la Première Guerre
Mondiale, toute activité associative étant
interdite en Alsace, le Comité se mit en
sommeil, sauf pour une réunion en mai
1917. En effet, suite à une législation
sur l'obligation de remettre à l'État
allemand des titres suédois, danois et
suisses par les propriétaires allemands
domiciliés dans le Reich, le bureau de
trois membres (président, secrétaire- trésorier
et assesseur) de notre Association qui
possédait pour 5000 F d'obligations
suisses 1908 à 4 % décida de les vendre
à la Banque de Mulhouse.
Les activités du Comité
reprenaient dès le 1er février 1919. En
temps normal, le Comité se réunit 3 à 4
fois par an, mais en périodes de crise,
notamment dans les années 1919 et 1920,
on comptait jusqu'à 10 réunions. Les
nouveaux statuts de 1919, influencés par
les initiatives spinaliennes, fixèrent le
nombre des membres du Comité à 12 avec
deux vice-présidents et séparèrent les
fonctions de secrétaire et de trésorier.
On relève que, pendant ce siècle, la durée
de mandat de 10 présidents sur 12 n'a pas
dépassé 10 ans, le record étant détenu
par Pierre LAUER avec 29 ans de présidence.
Une des difficultés d'une
Association d'anciens élèves est
d'inciter les étudiants diplômés à
s'inscrire dès la sortie de l'École. Un
an après l'année de sa fondation en
1896, l'Association ne comptait que 200
membres alors que l'École en avait déjà
formé 1000. Une autre difficulté, la
connaissance des adresses des anciens élèves,
fut régulièrement abordée par le Comité
en lançant des questionnaires. Mais le
succès de ces opérations fut souvent
mitigé. Ainsi en 1907 par exemple, sur
1180 élèves répertoriés, l'adresse de
510 était inconnue. En 1903, Charles
WELKER dessine une belle carte de membre
remise à chacun (Annexe N°
36).
Malgré tous les impondérables, le
nombre d'adhérents grimpait rapidement
pour atteindre en 1931 un pic de 921
membres, pour baisser régulièrement
jusqu'à la guerre de 1939/45 et reprendre
allégrement vers un deuxième sommet de
940 membres en 1956 (Graphique en Annexe N°
37). Toutefois, en appliquant avec plus de
rigueur la règle inscrite dans les
statuts excluant les membres en retard de
paiement de cotisation depuis plus de deux
ans, on fit chuter le nombre de membres.
Depuis, le nombre d'adhérents baissait
pour se stabiliser pendant les trente
dernières années à 500 ou 600. En 1995
l'Association compte 524 cotisants alors
que l'école a formé environ 5000 élèves
en 135 ans.

Qui sont nos Anciens ?
Lors de la fondation de l'école en
1861 par la SIM, la Direction classait
les élèves selon leur origine sociale en
3 catégories : les fils de patrons, les
fils de directeurs et les autres. L'écolage
de 600 F par an, correspondant au salaire
annuel d'un ouvrier auquel il faut, d'après
une étude du Dr. PENOT de 1842, un
minimum vital de 400 F pour subsister,
devait éliminer pas mal de jeunes gens
modestes.
Selon l'annuaire des Anciens de
1905, les patrons d'usines appelés
manufacturiers représentaient 28 % des
348 membres de l'Association. Aujourd'hui,
même si on n'établit plus ce genre de
statistique et que la notion même du
"patron" du XIXe siècle a
disparu, on peut affirmer qu'il y a peu de
"fils de patrons". Les emplois
des Anciens évoluent considérablement en
un siècle. Selon le même annuaire de
1905, sur les 348 Anciens on trouve 2
"rentiers" et 143 gérants,
directeurs ou sous-directeurs (41 %) ; 37
% travaillent en Alsace, 30 % dans les
autres départements de France notamment
dans ceux de l'Est, 7 % en Allemagne et 26
% dans d'autres pays, Italie, Russie,
Espagne, Belgique, Suisse, Portugal,
Autriche, États-Unis, Turquie, Égypte, Brésil,
Indes, etc... En ce qui concerne leur
nationalité, rappelons la belle envolée
lyrique à l'occasion d'une excursion des
Anciens à la Schlucht en juin 1909 où le
président STORCK s'exclama "On ne
demande pas s'il est Allemand, Français,
Italien, Anglais, etc... mais simplement s'il est ancien élève de
l'École". Dix ans plus tard, en 1919,
cette affirmation était caduque puisqu'on
expulsa les Allemands et les Autrichiens
de l'Association.
En 1995, sur 524 Anciens, 132 soit
24 % sont retraités. Quant aux 321 actifs
ayant indiqué leur lieu d'activité, 34 %
travaillent en Alsace, 54 % dans les
autres départements français, 2 % en
Allemagne et 10 % dans d'autres pays,
Suisse, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg,
Espagne, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire,
Afrique du Sud, Canada, Mexique, Hong-Kong, Australie. Il n'est pas possible
d'en tirer une conclusion car les deux
populations d'Anciens de 1905 et de 1995
ne peuvent être comparées. Avant 1914,
la plupart des élèves s'inscrivaient à
l'Association des anciens élèves, alors
que depuis 1945, peu d'étrangers s'y
trouvent.
Quant à leur âge ou plutôt leur
ancienneté, les écarts se creusent. En
1905, les plus vieux, sortis de la première
promotion de l'école en 1861/62, ne
pouvaient avoir que 44 ans d'ancienneté
et en tout état de cause, l'espérance de
vie était nettement plus faible. En 1995,
19 Anciens appartiennent à des promotions
d'avant 1939, le plus ancien de 1922, soit
63 ans d'ancienneté.
Autre évolution remarquable, la féminisation.
Pendant près de 80 ans d'existence de l'école,
aucune femme n'a fait d'études textiles.
Cela n'a rien d'étonnant puisque la
plaquette de présentation de l'École de
1930 affirme péremptoirement
"l'École n'admet que des jeunes
gens". Il faut attendre 1939 pour
trouver deux jeunes femmes diplômées en
textile. Par contre, à l'École de Chimie
de Mulhouse, la première jeune fille
s'inscrivit en 1908 ! Mais à l'École
textile, il fallut encore près de 30 ans
supplémentaires avant qu'un contingent d'à
peine 10 % de femmes se lançât régulièrement
dans ces études techniques. Enfin en 1984
une femme est élue au Comité de
l'Association. Toutefois en juin 1908, ces
messieurs se consolent de voir ces dames
participer avec des enfants à la première
excursion au Ballon d'Alsace organisée
par l'Association.
À la première Assemblée générale
en 1897, on élit des membres honoraires :
le président et des membres du CA de l'École Gustave DOLLFUS, Camille De
LACROIX, Alfred WENNING directeur de la
S.A.C.M., Jacques-Mathieu WEISS, Albert
ROHR, et des anciens professeurs à l'école
Jean HAEFFELÉ, Fernand ZUNZER, ainsi que
les examinateurs. Une subtilité latine,
inexistante dans les statuts de 1896, fait
une distinction dans ceux de 1919 entre
les membres d'honneur qui sont "des
personnes ayant rendu des services signalés
à l'École, à l'Association ou à
l'industrie textile" et pour
lesquelles le paiement de cotisation est
facultatif, et les membres honoraires
auxquels on impose des cotisations sans
limite supérieure. Leur nombre atteint près
d'une centaine en période de vaches
grasses mais a fortement diminué pour
presque disparaître dans les années
1950. Relevons parmi les personnalités
marquantes, outre les industriels d'avant
1939, bienfaiteurs de l'École ou acceptant
les visites de leurs usines, l'emploi de
stagiaires et les embauches d'étudiants :
le député Théodore SCHLUMBERGER de
Mulhouse en 1900, le député et Ministre
du Travail Paul Léon JOURDAIN en 1920
(1878-1945, dirige en 1911 avec son frère
Aimé - promo 1887 - les Filature et
Tissage X. JOURDAIN à Altkirch), le député
Alfred WALLACH (promo 1898/99) en 1932, le
Ministre des Finances et plus tard Président
du Conseil et Maire de Strasbourg Pierre
PFLIMLIN en 1955, etc…

32. Des activités mulhousiennes
qui perdurent
Dès la fondation
de l'Association, à la première A.G. du
1er mai 1897, le président BICKING
rappelle les buts de l'Association, entre
autres "favoriser les relations
amicales entre différentes promotions,
donner la possibilité de se perfectionner
dans sa spécialité et dans des questions
d'intérêt général, sans porter préjudice
aux secrets de fabrication... par
l'organisation de réunions mensuelles à
Mulhouse où seront discutés des sujets
techniques qui pourraient être publiés
ultérieurement". Pour le groupe de
Mulhouse, on met en place une structure légère,
un président et un secrétaire qui
devraient animer les rencontres, soigner
la convivialité et trouver des sujets de
conférences techniques, de visites
d'usines, etc…
Quant au local des rencontres, les
Mulhousiens se réunissent d'abord chaque
semaine dans la salle de l'étage du
restaurant Luxhof, autour du "Stammtisch".
Par contre les réunions du Comité
central se tiennent toujours au bureau de
l'usine du président. Mais après la
Première Guerre Mondiale, on éprouve le
besoin d'un local plus spacieux et on loue
à partir de février 1919 pour 250 F par
mois avec un service payant de boissons,
la salle de répétition de la musique
CONCORDIA, place du Nouveau Quartier N°
4. Le groupe y tient les rencontres
hebdomadaires amicales du mercredi soir,
les causeries techniques et les réunions
du Comité central. Mais quatre ans plus
tard, se rendant compte du coût de loyer
élevé pour une occupation insuffisante,
on abandonne la location du local au
profit du Salon vert du Café MOLL. Avant
la crise économique de 1929, on se met à
rêver "On aura peut être un jour
une Maison des anciens élèves".
Mais ce ne fut qu'un fantasme. On change
plusieurs fois de local dans l'espoir de
rassembler davantage d'Anciens. En 1951 on
quitte le MOLL trop bruyant à cause de
l'orchestre, pour le Café GATTANG place
Franklin. En 1969, on passe du Bureau de
l'Association de la SIM au Caveau du théâtre,
sans pour autant attirer davantage
d'Anciens.
Formation continue centenaire
Ces réunions techniques sont concrétisées
dès l'automne 1898 par des conférences
présentées une fois par mois durant
l'hiver un samedi soir dans la salle du
Luxhof, en langue française ou allemande,
fréquentées par 50 à 70 auditeurs,
anciens élèves. Les thèmes techniques
suivants sont abordés, un vrai programme
de formation continue inspiré par les préoccupations
du moment : "Histoire de la filature
et du tissage" par BRUGGEMANN,
"Les machines textiles" illustré
par des projections, par BRUGGEMANN,
"Les presse-balles LOWRY pour
coton" par WILKENS de Brême,
"Principes des moteurs électriques"
par GÉGAUFF "Le calorifugeage"
par le chimiste PASQUAY, "Utilisation
de l'acétylène" par BRUGGEMANN,
"Courroies de transmission" par
LEVERD-DRIEUX, "Brevets
allemands" par BRUGGEMANN, "Législation
professionnelle" par un avocat,
"Le ciment armé" par ZUSLIN de
Strasbourg suivi de la visite du nouveau bâtiment
de la filature Charles MIEG,
"Nouvelle pompe révolutionnaire système
RIEDLER" par l'ingénieur en chef HUF
"Contribution à la connaissance de
la chimie des fibres textiles" par
Dr. GASSMANN-ENGEL, "Les
encolleuses" par BICKING, "Récents
brevets français, allemands et anglais en
filature et tissage" par BRUGGEMANN,
etc…
Après quelques années
enthousiasmantes, ces réunions commencent
à manquer d'intérêt et notamment de
conférenciers et d'auditeurs. En 1912,
DUBOIS, responsable du groupe de Mulhouse
relance ces causeries techniques d'un soir
par mois. Lui-même traite le sujet
"Le titre moyen de filage et sa
relation avec la livraison réelle",
BRUGGEMANN reprend une série de causeries
sur "le droit du travail", dans
l'espoir que d'autres suivent. D'ailleurs,
les Spinaliens, dans leur projet de réorganisation
de l'école de Mulhouse d'octobre 1915, prévoient
une place de choix aux conférences données
par des industriels et des anciens élèves.
Si la guerre met fin à toutes ces réunions,
à la première A.G. d'après la guerre,
en juillet 1919, le président annonce que
les cinq réunions mensuelles du groupe de
Mulhouse sont fréquentées par 7 à 15
membres. Mais en 1920, plus de réunions
faute de conférenciers. L’année
suivante, on projette de les reprendre en
y invitant le Cercle des étudiants (on
versera un don de 250 F à leur caisse) et
en prenant une collation avec prestations
musicales. En 1922, un Ancien, représentant
de S.K.F. présente une conférence avec un
film sur la fabrication des aciers spéciaux
et des roulements à bille, on y invite également
les étudiants, les chimistes et les
mineurs.
Nouvelle initiative de formation
continue en 1922 : le groupe de Mulhouse
voudrait organiser des cours supérieurs
post-scolaires par correspondance pour les
directeurs qui veulent postuler pour des
places de gérants et d'administrateurs,
en recommandant les cours suivants :
- École d'Administration et des
Affaires, 100 rue Vaugirard, Paris 6e,
- École du Génie Civil, Avenue de
Wagram, Paris 17e,
- École
Universelle
par correspondance de Paris, 10 rue
Chardin, Paris 16e.
En 1923, un ingénieur de la
S.A.C.M. parle, au cours d'un dîner, des
forces motrices hydroélectriques et on
donne une conférence sur "Les grands
étirages" suivie d'un dîner amical
pour 14 F. Autre conférence en 1926 qui
s'adresse également aux contremaîtres
des tissages de Mulhouse, sur le nouveau métier
RÜTI avec présentation d'un film de 900
m de long (sic) montrant les détails du métier
au ralenti. Quelques jours plus tard,
l'ingénieur en chef de la S.A.C.M.,
membre du Comité, élève une vive
protestation contre ce film de RÜTI
"qui n'était que de la réclame"
alors qu'on avait promis un film purement
technique. La crise économique à partir
de 1929 perturbe les réunions amicales du
groupe. Ce n'est qu'en 1934 qu'on décide
de reprendre les réunions avec
discussions techniques qui sont de nouveau
très bien fréquentées. En 1936 on parle
du système BEDEAUX et du filage de la
laine cardée, en 1939 du travail des fils
et tissus élastiques, de l'organisation
du travail, des impôts et des assurances
accident .
Après l'interruption due à la
guerre 1939/45, on décide de reprendre
les causeries, en 1946 "Les fibres de
verre", un an plus tard, un thème à
la mode "L'organisation scientifique
du travail" et
"L’encollage", en 1949
"la qualité en filature" et
"le cannetage", en 1951 avec
"Voyage d'études en Amérique du
Sud" et "Voyage d'études aux
USA". Ces conférences attirent de
moins en moins d'auditeurs et il faut
attendre les années 1961 et l'action
dynamique de Pierre SIEGER, responsable du
groupe de Mulhouse, pour découvrir de
nouveaux titres : "Applications des
fibres acryliques", "Psychologie
appliquée à la sélection du
personnel", "Filature des fibres
synthétiques", "Le régime des
retraites des cadres" ,
"Assurance vie", "
Application de l'ordinateur à l'industrie
textile", "Gestion industrielle
par ordinateur dans l'industrie mécanique",
"Le système japonais de
filature" et, plus classique,
"Caractéristiques du coton", néanmoins
les participants sont peu nombreux.
Innovation après les événements
de mai 1968, révolution qui a également
secoué nos étudiants : la tentative d'améliorer
les relations entre Anciens et étudiants
au cours d'un dîner offert par
l'Association à la promotion sortante.
"Nos jeunes expriment leurs craintes
face à l'avenir et les doutes quant à la
valeur du choix d'une carrière dans une
industrie en perpétuelle mutation et
convulsion". Ces rencontres débats
entre étudiants de troisième année et
Anciens sont reconduits chaque année par
le Comité autour d'un apéritif, d'un
cocktail ou d'un buffet campagnard ou à
l'occasion d'un dîner. Elles permettent
aux jeunes d'entrer en contact avec des
hommes de terrain, entre autres pour la
recherche de stage de fin d'études voire
pour une première embauche.
Petit à petit, ces réunions
mensuelles du groupe de Mulhouse, avec ou
sans conférence, souffrent d'un manque
chronique de participants. Plus tard
d'ailleurs, la formation continue,
structurée et payante, élaborée et
proposée par l'École, par le Centre de
Recherche Textile de Mulhouse (C.R.T.M.)
ou par le Service de Formation Continue de
l'Université de Haute-Alsace (S.E.R.F.A.),
s'est institutionnalisée. Nos hommes
semblent trop sollicités par ailleurs et
nos étudiants taraudés par la recherche
d'un emploi, d'où de nouvelles pistes à
explorer : des conférences-débats
"opération carrière" entre
Anciens et jeunes. Depuis 1987, on
s'oriente vers des exposés faits à l'École dans le cadre des Assemblées générales
annuelles des Anciens, p.ex. "les
fonctions et le rôle du jeune ingénieur",
"Évolution de l'informatique jusqu'à
l'an 2000", "Textile et
recyclage, marché d'avenir", etc…

Visites d'usines instructives
Si les visites d'usines par les étudiants
font de tout temps partie du programme
scolaire, ce sont les Anciens d'Épinal qui
inaugurent en 1905, la tradition de
visites d'usines au cours d'excursions,
reprise en 1907 par le groupe d'Anciens de
Belfort (Annexe N° 37
A). Nous avons
longuement évoqué ces deux sorties
studieuses. D'autre part, presque chaque
Assemblée générale des Anciens est précédée
de visites d'usine, frisant parfois la
boulimie. Ainsi à l'excursion à Belfort
de juillet 1906, en une seule matinée près
de 100 Anciens visitent en plusieurs
groupes la filature modèle
KULLMANN-NAEGELY, la filature de laine
peignée SCHWARTZ, plus tard, la nouvelle
filature VAUCHER construite en béton armé,
la S.A.C.M., la nouvelle Centrale électrique
de la ville de Mulhouse avec sa machine à
vapeur (le déplacement se fait en calèches).
Une vraie course d'obstacles ! Tout le
monde est ravi de voir "ces usines
qui sont à l'avant-garde des
installations sociales". Bien qu'il
fut difficile d'obtenir des autorisations,
il fallait envisager de visiter également
des établissements d'autres régions,
"des industriels lyonnais font bien
visiter à leurs employés des usines
allemandes", signale-t-on. Dernière
visite avant la guerre à l'A.G. de 1912,
52 Anciens descendent à 680 m sous terre
pour visiter la Mine de Potasse Amélie.
L’École fait visiter aux élèves
des usines textiles, filatures, tissages,
ennoblissements, mais aussi de
constructions mécaniques et d'accessoires
textiles, de tissage de toiles métalliques,
de laboratoires, de chimie, de brasseries,
de menuiseries, de musées, etc... aussi
bien en Alsace qu'à Bâle. En 1906, le
manufacturier Paul KULLMANN fonde un prix
de 800 Mark offert à deux jeunes diplômés
sortants, membres de l'Association, qui
devaient visiter le matériel de filature
à la Foire de Milan, le matériel de
tissage à la Foire de Tourcoing,
plusieurs usines à proximité de la foire
sur recommandation de l'école, après
quoi ils devaient rédiger un rapport
illustré de dessins sur les moteurs et
les chaudières, les nouveautés
concernant l'éclairage électrique et le
transport d'énergie, les machines
textiles, les schémas des bâtiments,
l'implantation des machines et sur les
conditions de travail des ouvriers. Du
pain sur la planche !
Dès l'A.G. de 1921, la fringale des
découvertes techniques se manifeste à
nouveau. A partir de cette année, on
visite successivement plusieurs puits des
Mines de Potasse, les Forces Motrices du
Haut-Rhin, les Houillères de Ronchamp, à
plusieurs reprises l'avancement du
chantier de la Société de l'Énergie Électrique
du Rhin à Kembs, de 1930 à
1939, la Brasserie de Mulhouse, la
Manufacture de Glaces, les Bains
Municipaux, l'Usine à gaz, la chaufferie
et le poste de signalisation de la gare de
Mulhouse, le Port de Strasbourg, etc…
Après la Deuxième Guerre mondiale les
visites reprennent mais pas systématiquement,
notamment durant les 20 dernières années,
revisite de Kembs reconstruit, Bains
Municipaux, les installations de surface
du puits d'Ensisheim des Mines de Potasse,
à plusieurs reprises le chantier de
l'usine hydroélectrique d'Ottmarsheim,
l'Usine à gaz, la S.A.C.M., DECK, RIETER
à Winterthur, le centre d'aiguillage et
de signalisation de la gare, SULZER à
Winterthur et à Soleure, le Tissage de
Bourtzwiller, PEUGEOT à Sochaux, ROTI à
Winterthur, RHÉNAMÉCA à Ottmarsheim, le
Port de Mulhouse, N. SCHLUM BERGER à
Guebwiller, MAB à Soultz, BRAECKER à
Wintzenheim, les Cartonneries de
Kaysersberg à Kunheim, Chaux et Ciments
PORTLAND à Altkirch, les Zones
industrielles de Mulhouse sous la conduite
du sénateur STOESSEL, l'Imprimerie du
journal L'Alsace, RHENALU à Biesheim, les
Tuberies DOLL TEMPÉ à Ingersheim, la
Manufacture Alsacienne de Produits Métalliques
à Wintzenheim, l'Aéroport de Mulhouse-Bâle,
les Arts Graphiques DMC, CLEMESSY, la
Caserne des Sapeurs Pompiers, le Musée du
Chemin de Fer, le Musée de l'Impression,
le Port de la CCI, les Services techniques
de la gare des voyageurs, le Musée du
Papier Peint, etc…

Actions sociales
Le souci de l'aide aux anciens élèves
est inscrit dans les statuts de 1896, où
son article 17 précise : "Tout sociétaire
connaissant une place vacante est prié
d'en informer immédiatement le secrétaire,
celui-ci se concertera avec quelques
membres du Comité pour le choix du sociétaire
à recommander". Dès la troisième
Assemblée générale, en juin 1899, un
bureau de placement est créé et une
circulaire envoyée à tous les
industriels les rendant attentifs à cette
nouvelle institution et les engageant à
en faire usage.
Mais au-delà de l'assistance aux
anciens élèves que doit assurer
l'Association pour la recherche d'un
premier emploi ou, plus tard, pour
faciliter leur évolution de carrière,
bien d'autres formes de soutien et d'aide
s'ajoutent à cette initiative au fil des
ans et selon les besoins :
- soutien aux nécessiteux par la
création en 1907 d'un fond de solidarité
avec les finances de l'Association, en
1909 on souhaitait arriver à un capital
de 100.000 Mark afin que les intérêts
puissent être mis à la disposition des nécessiteux
; en 1930, un Ancien de Paris sans emploi
sollicite un prêt de 400 F qui n'est
jamais remboursé,
- conseil juridique commercial et
social en 1907,
- conseil pour l'assurance-vie en
signant en 1903 un accord avec la société
GOTHA ; en 1919 un accord passé avec la
Société d'assurance-vie LE PHÉNIX et un
autre pour les assurances-accidents avec
la Société PROVIDENCE prévoit des réductions
pour les membres de l'Association,
- conseils pour la caisse de
retraite et projet de fondation d'une
telle caisse demandée en 1924 par les
Belfortains, examinée à plusieurs
reprises et encore en 1936 par des
experts,
- revendications salariales : à
l'A.G. de juillet 1920, une demande des
groupes d'Épinal et du Nord d'effectuer
des démarches auprès du patronat par
envoi d'une circulaire en vue du relèvement
des salaires des cadres est soutenue
verbalement par tous les groupes mais ne
fut concrétisée que par les Mulhousiens
qui en subirent des conséquences désagréables
; une démarche analogue est repoussée en
1924 du fait que "notre Association
comprend toutes les catégories
professionnelles, employeurs et employés,
et n'est pas un syndicat",
- gratuité pour les annonces de
recherche d'emploi demandée par les
Strasbourgeois en 1939,
- fondation d'une prime pour les
meilleurs travaux techniques, etc…

Un local pour une permanence
Pendant les vingt premières années
de l'existence de l'Association, tout le
travail administratif d'assistance est
effectué bénévolement par les membres
du Comité, notamment par le secrétaire-trésorier
qui prend en charge avec l'aide du
directeur d'École le bureau de placement.
Quant au local, trois chambres
entretenues, éclairées et chauffées
sont mises à la disposition de
l'Association dans la maison de BRUGGEMANN
qui loge et offre le petit déjeuner à
des stagiaires travaillant pour la Revue.
En 1919, avec l'entrée au Comité de
Pierre LAUER alias LEDUC, venant de Paris,
de grands projets sont échafaudés. LAUER
propose de louer un bureau pour les
travaux et un magasin pour déposer les
archives et de scinder la fonction de secrétaire-trésorier
en 4 postes. A partir de 1921, une pièce
dans la villa DUBOIS au 11 b rue de
l'Argonne, président de l'Association et
directeur de la Revue, est mise à la
disposition de l'Association et la fille
du président y est employée, un crédit
de 6000 F est voté à cet effet. Après
le décès de DUBOIS, on loue en octobre
1925 un local au 3 rue du Chêne pour
installer le siège de l'Association, le
bureau de FROEHLIGER embauché pour la
direction de la revue et la permanence. Le
Comité estime toutefois que pour le
placement des étudiants le directeur Frédéric
ORTLIEB est le plus qualifié. Le beau rêve
émis en 1929 d'une Maison des Anciens élèves
ne se réalisera jamais. En 1934 on emménage
dans un autre local loué au rez-de-chaussée
du 21 rue des Vergers pour un loyer de 250
F par mois. Ce bureau est fermé au début
de la guerre.
Après la Deuxième guerre
mondiale, le bureau de placement reprend
ses travaux dès le mois de mai 1945.
Jusqu'en 1950, le sous-directeur de l'école,
MARTIN installé dans un local mis à la
disposition par l'École, s'occupait du
placement, puis BRITZEL aidé par le
directeur Victor HILDEBRAND. A partir de
1956, le Comité renforce les moyens
d'action de l'Association en installant le
bureau dans les bâtiments de la SIM et
en embauchant une secrétaire, Madame REINBOLD qui assure chaque après-midi une
permanence. Elle prend sa retraite et est
remplacée début 1976 par Madame Alice
GEORGER.

Un office de placement efficace
En 1903, on constate avec
satisfaction que 16 anciens élèves et
l'année suivante 15 ont trouvé du
travail grâce à l'Association qui envoie
chaque trimestre une circulaire aux
industriels. En 1905, 24 camarades sont
embauchés, mais les offres de places avec
beaucoup d'expérience ne peuvent plus être
satisfaites. En 1907, l'année du boom de
l'industrie textile, on n'a pas assez de
candidats pour répondre à toutes les
demandes.
Les reproches de favoritisme dans
le placement en entreprise ne manquent
pas. A l'A.G. de 1904 on trouve qu'un
"membre honoraire a favorisé
l'embauche d'un ancien non-membre de
l'Association, ce qui est contraire à la
solidarité morale". Par contre, on
critique les Anciens qui n'engagent pas
suffisamment par l'intermédiaire de
l'office de placement. La création d'un
groupe régional à Belfort en 1907 entraîne
une certaine autonomie dans les démarches
de placer les Anciens dans la région de
Belfort ; toutefois, le groupe se plaint
que les Belfortains ne réussissent qu'à
placer 5 des leurs auprès de leurs
industriels et accusent les Mulhousiens de
faire barrage ; un nouveau système de
fonctionnement basé sur des "hommes
de confiance" est élaboré, sans
plus de succès. En fin de compte on
revient au principe du bureau à Mulhouse
centralisant les demandes et offres. Après
1920 les places vacantes ne sont communiquées
qu'aux élèves sortants et aux Anciens
qui en expriment le souhait.
En 1946, le bureau de placement a
des ennuis avec l'Administration du
Service de la Main-d’œuvre qui aurait
voulu garder le monopole et le contrôle
du placement des demandeurs d'emploi, mais
après quelques démarches et la démonstration
de l'ancienneté et de l'efficacité de
notre service, notre office de placement
pouvait continuer ses travaux.
A partir de 1966, les annonces
d'emplois disponibles sont largement
diffusées dans les Annales Textiles, puis
dans le Bulletin d'Information des
Membres. Comme conséquence à l'élargissement
de la formation de nos étudiants, une
nouvelle méthode de collecte des offres
d'emplois est adoptée en 1979. On diffuse
non seulement dans le B.I.M., mais aussi
à tous les demandeurs, toutes les offres
de l'industrie textile reçues à notre
office de placement, mais également
celles publiées pour des industries
annexes dans une dizaine de périodiques
techniques et commerciaux, textiles et
autres, nationaux et internationaux. A la
suite de cette initiative, des Cabinets de
recrutement avec lesquels nous entretenons
de bonnes relations font souvent appel à
nos services. Les résultats de placement
de ces 15 dernières années en sont
notoirement améliorés.
On trouve
en annexe N° 38 l'évolution
des offres et demandes d'emploi et des résultats
obtenus par le bureau entre 1920 et 1995.
Ces chiffres reflètent évidemment aussi
la situation économique de l'industrie
textile.

La convivialité par les
excursions, sorties et rallyes
La mode des sorties se propageant,
nos Anciens décident en juin 1908
d'organiser une excursion au Ballon
d'Alsace pour retrouver les Belfortains et
les Vosgiens, "respirer l'air pur des
Vosges et de la liberté" et boire du
vin rouge, symbole de la France de la
belle époque. "Les Alsaciens montent
à pied depuis Sewen, les Vosgiens et
Belfortains, profitant des deux bonnes
routes de Saint-Maurice et Giromagny - on
y organise annuellement des courses
automobiles - s'y rendent en voitures à
cheval, bicyclettes, automobiles, etc…
Qui arrive en premier vers 11 h à l'Hôtel
LALLOZ ? Bien sûr, les Alsaciens à pied
! Après de nombreux apéritifs, la
soixantaine d'excursionnistes, y compris -
autre innovation remarquable - des dames,
enfants et invités, montent au Ballon
pour jouir d'une magnifique vue sur la
plaine. Après le banquet, les discours,
les multiples toasts au champagne, on
prend le chemin de la descente non sans s'être
promis d'entreprendre l'année suivante
une nouvelle excursion dans les
Vosges". Effectivement, en juin 1909
on se retrouve à 72 participants, grâce
au petit train, à la Schlucht. On se
rappelle qu'il y a quelques mois,
GUILLAUME 11, l'Empereur d'Allemagne, y a
fait une excursion se terminant par une réception
dans le chalet de chasse de l'Altenberg
appartenant à l'Industriel HARTMANN à
Munster où, il y a 40 ans, NAPOLÉON III
avait été accueilli dans le même chalet
par le père de l'industriel. Après un
rafraîchissement à l'Hôtel DENAFROUX,
on grimpe au restaurant du Hohneck. Sa
salle à manger est occupée par un groupe
de 400 excursionnistes du Nord de la
France y faisant une halte avant de
continuer un périple vers Baden-Baden.
Bussang est la destination de la rencontre
de juin 1910. En dépit d'une pluie bien
vosgienne, 80 membres s'y retrouvent avec
quelques dames et des invités, quelques
Anciens d'Alsace y sont montés à pied,
des Belfortains et des Spinaliens en
automobile. Le banquet à l'Hôtel aux
Deux Clés suivi des discours et des
toasts au champagne créent une joyeuse
ambiance. L'année suivante c'est l'Hôtel
Cheval de Bronze à Cornimont - très éloigné
des lignes de chemin de fer - qui
accueille les Anciens du textile, malgré
un temps exécrable. Après la visite des
usines Les Héritiers de Georges PERRIN,
on se retrouve dans la salle décorée aux
couleurs françaises et alsaciennes. La
musique de la filature et le bon vin réchauffent
l'ambiance. Comme il est difficile de
trouver un autre lieu facilement
accessible aux trois groupes , on refait
en 1912 le choix du Ballon d'Alsace, les
Mulhousiens arrivant par Sewen ou
Wesserling. Les excursions de juin 1913 à
la Schlucht et de juin 1914 sont les dernières
avant la longue interruption de la guerre.
Après le cataclysme, le Comité essaie de
reprendre la vieille tradition, toutefois,
le choix des sites visités est davantage
marqué par les souvenirs douloureux de la
guerre, les excursions deviennent des pèlerinages,
en juin 1920 au Drumont, en 1921 au
Hartmannswillerkopf. Puis les sorties se
raréfient, en 1924 aux Trois-Epis et en
1928 aux Houillères de Romchamp.
Après les années de crise économique,
on reprend l'idée de sorties conviviales
communes en automne. Les vendanges de 1937
attirent des Anciens de Mulhouse, Colmar,
Strasbourg et Belfort à un déjeuner à
"La ville de Nancy" à
Ribeauvillé, suivi d'une visite de cave.
En octobre 1938 GAERTNER à Ammerschwihr
est le but de la sortie avec visite de la
cave SCHOECH. Mais une nouvelle guerre
casse l'élan excursionniste. Il faut
attendre mai 1948 pour la première sortie
à Ammerschwihr chez GAERTNER (déjeuner
de 400 à 500 F).
A partir de 1966, le Comité
organise régulièrement des sorties
d'automne avec dîner parfois suivi d'une
soirée dansante. Elles jouissent d'un
succès notoire, la première année une
soixantaine de participants à Eguisheim,
76 l'année suivante à Niedermorschwihr ;
à partir des années 1970, une présence
de 50 à 100 participants, à Kaysersberg,
à Mittelwihr, à Wintzenheim, à
Thierenbach, à Kientzheim, à
Village-Neuf, à Diefmatten, à Westhalten,
à Hochstatt, à Moosch, à Habsheim.
Sous l'influence de l'évolution démographique
sur la population des Anciens et la
propension des industriels de mettre de
plus en plus tôt les vieux cadres à la
retraite, le nombre de retraités de notre
Association augmente sensiblement. Ainsi,
à partir de 1975, Edouard DERESINSKI,
plus tard Henri ABEGG, organise avec le
Comité et le secrétariat un ou deux déjeuners
annuels, parfois précédés d'une visite
de musée, pour une quarantaine de retraités
qui se nomment - les euphémismes sont à
la mode - "Le Club des toujours
jeunes". Presque tous les bons
restaurants de notre région ont eu le
privilège de les accueillir, mais nous
nous abstenons d'indiquer le nom des
restaurants afin de ne pas transformer
cette énumération en guide gastronomique
des textiliens : Bitschwiller, Wettolsheim,
Ostheim, Riedisheim, Trois-Epis, Mulhouse,
Pulversheim, Guebwiller, Bruebach,
Gueberschwihr,Thann, Baldersheim,
Pfaffenheim, Wattwiller, Thierenbach,
Berrwiller, Bergholtz, Merxheim, Linthal,
Soultzmatt, Hunawihr, Bollenberg, etc…
Autre signe des temps, certaines
promotions se retrouvent tous les 5 ans
pour marquer leurs "noces" en
festoyant ensemble.
En juin 1975, des jeunes Anciens
actifs lancent une initiative connaissant
un gros succès pendant une demi-douzaine
d'années : le rallye touristique,
artistique, sportif, historique, culturel,
etc… d'une douzaine d'équipages sur une
cinquantaine de km à travers notre région.
La dernière étape de cette gaie expédition
est toujours une table bien garnie et sérieusement
arrosée.

Joyeux banqueteurs
Si statutairement, d'après
l'article 22, le banquet suit toute
Assemblée générale, pour de nombreux
Anciens, c'est annuellement l'ardente
obligation de rencontre conviviale, le
plaisir de se retrouver entre copains d'études,
la joie de se sentir une grande famille,
le partage de souvenirs exquis d'une
jeunesse imaginaire retrouvée. Sans
tomber dans l'exégèse sémantique,
relevons que le "banquet", mot
qui commence à sentir la naphtaline en
mai 1968, est remplacé cette année-là
par le "dîner amical" avant de
disparaître complètement de notre
vocabulaire. Personne ne peut dire si la
"citoyenneté" y a gagné. Par
contre on peut affirmer que les
participants, au nombre de 40 à 120 selon
les années, s'y sont de tout temps bien
amusés.
L’Assemblée Générale
Constitutive de 1896 se termine sans
banquet, mais on se rattrape par une
excellente prestation gastronomique le
soir de la première A.G. à l'Hôtel
Central et l'on note avec satisfaction que
les vins sont offerts par les honorables
messieurs ayant le plus d'ancienneté.
C'est un événement mondain important
pour les industriels mulhousiens qui reçoivent
de belles invitations imprimées avec le
menu (toujours en français, p. ex. en
1903, 32 ans après l'annexion allemande,
Annexe N° 39). On reste fidèle à l'Hôtel
Central pendant de nombreuses années,
sauf en 1904 où l'on inaugure le nouveau
restaurant du zoo, avec les incidents dont
la presse s'est fait l'écho, pour revenir
à son ancienne bonne tradition. Après la
guerre, les banquets se tiennent dans la
salle de la Bourse, au Casino, à l'Hôtel
de Parc, à partir de 1933, au restaurant
"A la ville de Strasbourg", au
Bristol, au Café de la Paix, au Zoo, au
Buffet de la Gare, à Thann, à
Riedisheim, après 1950 à l'Aéroport, au
Caveau du Théâtre, etc… On n'hésite
pas à banqueter à l'extérieur de
Mulhouse à partir des années 1970, à
Diefmatten, à Wahlbach, à Thierenbach,
à Uffholtz, à Blodelsheim, à Habsheim,
à Kingersheim, à Soultz, Wittelsheim, à
Moernach, etc...
Ces banquets d'autrefois, protocole
oblige, sont souvent présidés, outre le
président ou le vice-président de
l'Association, par les personnalités du
monde industriel mulhousien, Camille De
LACROIX, président d'honneur de
l'Association, Gustave DOLLFUS, président
du Conseil d'administration de l'École,
Albert KOECHLIN, de la SIM, Théodore
SCHLUMBERGER, ancien député, Daniel MIEG
président de la SIM, etc… qui
offrent le champagne. Depuis 1903, on
profite du banquet pour remettre un livre
au major de promotion, invité et se
soumettant à l'obligation d'un discours
rituel. A partir de 1945, le banquet est
présidé par jean DOLLFUS président de
la SIM et vice-président du C.A. de l'École,
Paul SCHLUMBERGER, LICHTENBERGER,
directeur de l'École Supérieure de
Chimie, etc… Avec le rattachement de l'école
à l'Université, rupture de tradition,
les banquets ne sont plus présidés par
quelque notable des grandes familles
mulhousiennes d'industriels. Citons un événement
remarquable, le banquet de 1967 présidé
par le président d'honneur de
l'Association, Pierre PFLIMLIN, Maire de
Strasbourg, membre du Conseil
universitaire de Strasbourg, qui rappelle
le leitmotiv de son père, Jules PFLIMLIN
(promo 1890/91) "L’idée la
meilleure ne suffit pas au but à
atteindre, c'est la mise au point qui en
donne la consécration".
Le banquet est l'occasion pour
certains talentueux Anciens de créer une
ambiance musicale et divertissante de haut
niveau. Ainsi, quelques jeunes et vieux
Anciens, notamment ALLONAS, E. BRITZEL,
CAQUELIN, CLAUSS, DÉPIERRE, PETIT, ROMANN,
SCHEIDECKER, STIFFEL, après 1930
WIERNSBERGER, etc… mais aussi le président
de la commission d'examen Albert KOECHLIN,
offrent leurs prestations musicales, en
solo, duo ou quatuor, de chant ou de
violon, violoncelle, cor, flûte et piano,
parfois tout un orchestre de danse
improvisé. Les banquets deviennent alors
de vraies soirées musicales avec des
oeuvres de F. SCHUBERT, WAGNER-LISZT, W.
BARGIEL, W. POPP, LABITZKY, PINGLIE, BÉRIOT,
MENDELSOHN-BARTHOLDY, JOCELYN, l'air de
Mignon "Connais-tu le pays",
etc..., suivies de numéros humoristiques
de chansonniers improvisés accompagnés
au piano, des imitations nasillardes du
phonographe, des discours en vers, des
monologues en français et en alsacien déclenchant
l'hilarité générale. Le camarade ROELLY
pour sa part, chante en dialecte
mulhousien durant de nombreuses années,
avec toujours le même succès, une
vieille rengaine qui se lamente de la dure
vie du fileur mulhousien au XIXe siècle
"Milhüser Spinnerliad" (Annexe
N° 40).
Changement de registre à la première
A.G. d'après la guerre le 12 juillet 1919,
sous les couleurs tricolores. Série de
discours enflammés, dont celui du président
MEYER : "La France a gagné la
guerre, il faut maintenant qu'elle gagne
la paix, la paix par le travail"
suivi de celui de FLAMAND, président du
groupe d'Épinal qui adresse "son
hommage aux Alsaciens qui sont morts des
deux côtés des tranchées, soit en
sauveurs, soit en victimes", après
quoi une vibrante Marseillaise fait
trembler les murs. Pendant plusieurs années
retentit à la fin du banquet la
"Chanson de Verdun" ou la
Marseillaise, ce qui n'empêche pas les
artistes "maison" d'amuser la
galerie. En juillet 1939, à la veille de
la guerre, au dernier banquet avant
longtemps, l'Association offre "deux
numéros extras" aux participants,
"un militaire déguisé en civil qui
raconte des histoires marseillaises et une
gracieuse danseuse au décolleté généreux
qui évolue, accompagnée au piano dans
une valse langoureuse, avec quelques
figures acrobatiques". A quelques
occasions, on engage un orchestre pour
animer le bal qui suit le banquet.
Un phénomène extraordinaire qu'il
n'est pas possible de passer sous silence
: la tenue à table et la capacité
d'absorption (bien supérieure au taux de
reprise de la laine !) de nos Anciens du
"bon vieux temps". Il suffit de
lire quelques menus d'avant 1928 : à l'Hôtel
du Parc pour 30 F (la cotisation annuelle
est à la même époque également de 30
F) : crème Marie Louise, filet de sole
bonne femme, cuissot de chevreuil aux
primeurs, sauce poivrade, pommes
croquettes, poularde rôtie, salade de
saison, bombe Marie-Louise, friandises, le
tout accompagné d'un 1/2 litre de vin par
personne et 1/3 de bouteille de champagne
par tête offert par l'Association. Crise,
chômage et restrictions en 1934, menu
maigrichon à 22 F à la "Ville de
Strasbourg" : Oxtail clair, saumon du
Rhin sauce gribiche, poulet de grain garni
riche, fromages assortis, bombe glacée
St. Jacques, gaufrettes, 1/2 litre de
Sylvaner, café nature (des petits malins
apportent leur burette de Schnaps),
champagne offert par l'Association. Le
nombre de discours entendus à ces
banquets est impressionnant. Chaque
orateur invite, au cours de plusieurs
toasts, de "vider le verre à la santé
de ...", ce qui, à la fin de la soirée,
fait un volume respectable. On ne se préoccupe
pas de 0,5 d'alcoolémie et l'ambiance
chaude et la bonne humeur sont directement
proportionnelles au nombre de toasts. Ceci
explique que certains banquets se
terminent, comme en 1905 en rentrant du
Zoo, en bruyant défilé aux flambeaux
jusqu'à l'Hôtel de Ville, en passant
devant la maison des examinateurs auxquels
on dédie une aubade nocturne.

33. Groupes régionaux :
grandeur et décadence
Si les relations entre le Comité
central et les groupes régionaux posent
parfois quelques problèmes, ces derniers
dynamisent considérablement la vie de
l'Association et, grâce à la proximité
géographique de ses membres, ils créent
des relations privilégiées entre les
Anciens d'une même région. Pourtant, ni
les statuts de 1896 ni ceux de 1919 revus
en 1931 ne font allusion à ces groupes régionaux
dont la création est encouragée par le
Comité dès qu'une petite vingtaine de
membres se retrouvent dans un secteur géographique
donné. Les groupes les plus virulents, Épinal, Belfort, Lille et Paris, se créent
encore avant la guerre de 1914/18, souvent
dans le but d'établir des liens entre les
Mulhousiens et les départements français
perdus après l'annexion. "Ici on
respire l'air pur des Vosges et surtout
celui du pays de la liberté"
s'exclame le président de l'Association
STORCK à l'occasion d'une sortie commune
des Anciens de Mulhouse, Belfort et Épinal
à Bussang.
Des tentatives de fondation de
groupes en 1907 à Moscou par le camarade
OCHS et à Milan, au Mexique, en Argentine
ne sont souvent que des feux de paille. La
reprise après la guerre n'est pas facile,
Lyon ne veut plus collaborer, Tourcoing et
Roubaix ne répondent pas, mais Épinal va
toujours bien. Entre 1919 et 1939, des
groupes se forment, s'endorment, se
reforment et se meurent à Lyon, Rouen,
Colmar, Strasbourg et même des
sous-groupes à Guebwiller et
Sainte-Marie-aux-Mines, des essais
avortent à Roanne pour réussir plus
tard. Après 1945, si les groupes de
Belfort, Lille, Épinal, Paris, Colmar,
Mexique (qui fait un don de 1100 dollars
à l'Association) reprennent contact avec
le Comité de Mulhouse et sont régulièrement
représentés aux Assemblées générales,
des essais sont tentés en Egypte, au
Portugal, en 1974 en Tunisie et un nouveau
rassemblement fondé à Troyes, mais leurs
activités déclinent après quelques années.
Certains groupes jouissent d'une
vie passionnante, d'autres traînent dans
la morosité et s'usent très vite, au gré
d'un président, d'une équipe dirigeante,
d'une mutation professionnelle, etc...
Leurs relations avec le Comité de
Mulhouse, théoriquement structurées par
des Règlements Intérieurs, prennent des
allures erratiques, se resserrent ou se
disloquent, au gré des circonstances.
Vers les années 1980, avec l'accélération
des rythmes de vie et de travail,
l'individualisme aidant, les groupes régionaux
constitués disparaissent. Aux Assemblées
générales à Mulhouse, on retrouve avec
plaisir des Anciens venus individuellement
des quatre coins du monde pour se
requinquer dans l'ambiance mulhousienne.
Les remuants Vosgiens sont les
premiers
Dès la première Assemblée générale
du 1er mai 1897, MATHEY, un Ancien d'Épinal
demande qu'une réunion annuelle des
Anciens se tienne dans la chef-lieu des
Vosges à laquelle les président et secrétaire
de Mulhouse devraient participer. Mais,
comme les statuts prévoient que le siège
est à Mulhouse, on ne voulait pas accéder
à cette demande, "ce qui n'empêchent
pas des Anciens d'effectuer des excursions
privées à Épinal". Un an plus tard,
le même MATHEY avertit le Comité
mulhousien qu'il veut créer avec les
nombreux Anciens de la région d'Épinal un
groupe vosgien, mais se heurte encore à
l'hostilité des Alsaciens qui craignent
des tendances séparatistes. L'opiniâtreté
des Vosgiens ne désarme pas et le 1.
octobre 1899 un groupe de 24 Anciens se réunit,
décide de créer un comité d'une
"section française" avec des
statuts, des finances et une
administration autonomes et siège et
administration à Épinal. Ils invitent à
la réunion suivante le président
BICKING. Bousculé par les Spinaliens, le
Comité mulhousien réticent propose de
fonder un "groupe régional" et
non pas une "section française"
et convoque une assemblée générale
extraordinaire pour mai 1905 à Épinal.
Les Anciens d'Épinal font bien les
choses en préparant une rencontre festive
qui dure deux jours. Levés très tôt,
les Mulhousiens arrivent en gare d'Épinal
à 9 h 52 accueillis par de nombreux
Anciens. Deux groupes se forment pour
visiter au pas de charge les Filatures et
Tissage V. PETERS à Nomexy où ils déjeunent
au champagne. L’après-midi les
filateurs visitent une filature à Igney
et les tisseurs la maison ZIEGLER à Épinal, ensuite ensemble les Ets. DAVID
& MAIGRET A 19 h apéritif et dîner
au Grand Hôtel après quoi des petits
groupes font des descentes dans différentes
auberges de la ville où le vin rouge
coule à flots joyeux. Ce qui ne les empêche
pas d'être présents dimanche matin à 7
h 30 pour visiter ensemble les curiosités
d'Épinal et l'École professionnelle de
la ville où des sections de filature et
de tissage pour dispenser des cours de préparation
à l'École de Mulhouse sont en cours de
création. (Bien qu'à cette époque on
n'envisage officiellement pas de créer
une école concurrente, ce sont les prémices
à la fondation en 1913 de l'École de
Filature et de Tissage d'Épinal). A 10 h
30 grand rassemblement de tous les Anciens
dans la grande salle du Syndicat cotonnier
de l'Est sous la présidence de BICKING,
président des Anciens de Mulhouse,
accompagné du secrétaire-trésorier
BRUGGEMANN. Re-banquet au Grand Hôtel
avec 54 Anciens et quelques élèves
textiles d'Épinal, discours enflammés,
champagne, ambiance musicale, quelques
joyeux lurons manient l'archet du
violoncelle ou se lancent dans l'imitation
d'un phonographe nasillard. Une fête
inoubliable que FLAMAND demande de
renouveler tous les deux ans dans une
ville des Vosges. Départ en bruyant cortège
entre deux rangs de drapeaux tricolores
jusqu'à la gare pour le train de 16 h 30
vers l'Alsace allemande. Mais le groupe régional
d'Épinal fort de 40 membres, parrainé
par Mulhouse et Belfort, n'est
officiellement fondé qu'en février 1908
en présence du président STORCK et du
secrétaire BRUGGEMANN. MATHEY qui en 1897
avait lancé l'idée de rassemblements régionaux
demande la réintégration dans
l'Association des membres qui avaient démissionné
à la suite du premier refus.
La vie du groupe continue avec des
réunions, conférences, visites d'usines,
excursions, etc... témoignant d'un grand
dynamisme. Toutefois, la guerre disperse
les membres et les rencontres se font plus
rares jusqu'en décembre 1915, où un
nouvel élan est donné pour se substituer
aux Mulhousiens qui semblent écrasés
sous la chape de plomb germanique. Nous
avons parlé ailleurs de l'initiative des
Spinaliens de lancer une édition
provisoire d'un "Bulletin N° 1 de
l'Association des Anciens Élèves de l'École
de Filature et Tissage de Mulhouse".
Ce groupe remuant participe régulièrement
aux Assemblées à Mulhouse jusque dans
les années 1980.

Les Lions de Belfort en 1907
Comme souhaité, une réunion de 60
Anciens venus de Belfort, d'Alsace (avec
le président STORCK et le secrétaire
BRUGGEMANN), d'Épinal, de Paris, d'Italie
et même de Lodz a lieu les 21 et 22
septembre 1907 à Belfort. Les Alsaciens
sont à pied d’œuvre samedi matin à 8
h pour visiter la S.A.C.M.. Dans les
ateliers qui occupent 3.500 personnes
(l'ensemble des usines S.A.C.M. de
Mulhouse, Belfort et Grafenstaden compte
à cette époque plus de 10.000 salariés),
on construit des peigneuses et autres
machines textiles, mais aussi des moteurs
et turbines à vapeur, des dynamos et
moteurs électriques, des turbines
hydrauliques et des locomotives. Nos
Anciens visitent également les Filature
et Tissage Gustave DOLLFUS (dirigé par
son fils Daniel), la corderie mécanique
STEIN, le Tissage de coton Max DOLLFUS à
Héricourt, la Filature de laine SCHWARTZ
à Valdoie. On déjeune et dîne chez
DANJEAN et, dimanche matin, on grimpe
jusqu'au Lion, aux Forts de la justice et
de la Miotte. Réunion constitutive du
groupe régional de Belfort et décision
d'élaborer un Règlement Intérieur pour
la fondation de groupes régionaux si un
nombre suffisant de 30 Anciens est réuni,
par exemple à Épinal, Paris, Milan,
voire Moscou, une espèce de Fédération
internationale dirigée par Mulhouse. Un
comité régional composé de 6 membres
est formé, dont un président qui dirige
le groupe et un secrétaire qui envoie les
comptes rendus de chaque manifestation au
Comité central à Mulhouse. Le groupe régional
de Belfort sous la présidence de Léon
FLAMAND est officiellement créé en
octobre 1907 et le secrétariat de
Mulhouse l'annonce à la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Belfort.
Le président STORCK accompagné de
BRUGGEMANN participe également à une
Assemblée des Belfortains qui se tient en
octobre 1909 à Giromagny, suivie d'une
excursion en montagne. On se plaint du peu
de succès du service de placement des
Belfortains, en dépit des circulaires
envoyées aux industriels du secteur et
aux Chambres de Commerce de Lille, Lyon,
Roanne et Roubaix.
En octobre de l'année suivante, de
nombreux Mulhousiens avec STORCK et
BRUGGEMANN et quelques Spinaliens
assistent à l'Assemblée à Belfort présidée
par FLAMAND. Promenade dans la vieille
ville, réunion et banquet à l'Hôtel
JEANNIN, un tour à la Grande Taverne,
discussion sur l'organisation d'un Bal du
Textile à Belfort en janvier 1911 auquel
les Mulhousiens sont invités, et retour
à la gare. La tenue de ce Bal rencontre
un scepticisme de la part des industriels
belfortains qui veulent bien y participer
si les Mulhousiens y viennent également.
Mais le Comité de l'Association de
Mulhouse "doute fort que les
industriels, directeurs et employés
veulent se rencontrer à l'occasion d'un
bal, encore moins avec les dames. Comme
peu de temps auparavant a lieu le Bal du
Coton à Mulhouse, ils n'entreprendront
pas un voyage à Belfort à cet
effet".
L’idée de "section française"
fait son chemin en dépit des coups de
frein des Mulhousiens. A l'Assemblée générale
du groupe des Belfortains en octobre 1911
au restaurant WAGNER à Belfort, on suggère
une rencontre à Paris de tous les groupes
de France.

Les tièdes Nordistes
A l'occasion de l'Exposition
Internationale de Paris au printemps 1900,
DANZER suggère de convoquer une réunion
des Anciens de Mulhouse à Paris.
Toutefois, l'idée ne se concrétise pas
et le groupe ne se formera que plus tard.
Mais à la Pentecôte 1911, des Parisiens
se rencontrent à Lille avec les Anciens
du Nord et de Belgique pour former le
troisième groupe régional sous la
houlette de Eugène JUILLIOT en présence
du seul représentant du Comité central
BRUGGEMANN. Ce dernier avait envoyé des
invitations à tous les Anciens des
secteurs concernés. Apéritif à la
terrasse du Café JEAN et banquet à l'Hôtel
BAILLEUL à Lille. Discours de JUILLOT sur
la nécessité de créer ce groupement
face à d'autres groupes puissants
d'anciens élèves de l'École Centrale, de
l'École des Arts et Métiers à Lille, de
l'Institut Industriel du Nord, etc... Après
midi, avec le tramway par le Nouveau
Boulevard, visite de la Foire textile de
Roubaix où de nombreux constructeurs
alsaciens exposent. Certains profitent
d'un baptême de l'air avec des
"machines à voler"(sic). L'année
suivante l'Assemblée du groupe de Lille a
lieu en octobre au restaurant Rocher de
Concale non loin du Café JEAN. Les
rencontres se tiennent régulièrement,
sauf pendant la guerre, jusqu'en 1927 et
reprennent entre 1934 et 1937, puis, avec
plus ou moins d'ardeur de 1947 à 1971.

Les Parisiens batailleurs
En 1913, De MOOR constitue à Paris
même un groupe régional autonome. Un de
ses animateurs, DENIS, bouillonnante
personnalité, représente en mars 1918 l'École de Mulhouse au Congrès du Génie
Civil à Paris et voudrait "faire de
notre École une espèce d'École Centrale
du Textile pour atteindre le sommet de
l'instruction textile en France".
DENIS a aussi élaboré des nouveaux
statuts de l'Association qui font en 1919
l'objet de discussions passionnelles au
Comité de Mulhouse. Ce groupe parisien se
rencontre régulièrement et envoie un
compte-rendu de chaque réunion au Comité
central. Le dynamisme agressif du groupe
de Paris à travers son président DENIS
met les Mulhousiens à rude épreuve et
souvent dans l'embarras, par exemple, au
sujet de la désignation de "supérieure"
que DENIS veut voir accorder à l'école
de Mulhouse, de la publicité faite en
1922 par l'École d'Épinal décernant le
titre d'ingénieur, de la fondation en
1924 d'une Fédération des associations
des anciens élèves des écoles textiles
de France, de l'installation en 1925 d'un
bureau central à Paris, des remarques
outrageantes proférées à l'adresse du
Président de l'Association et du Comité
de Mulhouse, de la formation d'un Comité
supérieur décapitant le Comité central
de Mulhouse, jusqu'à la démission
collective du comité de Paris au
printemps 1926. Mais le groupe se réorganise,
se réunit régulièrement, envoie entre
les deux guerres et à partir de 1946
jusque vers les années 1980 presque
chaque année un délégué pour
participer aux Assemblées à Mulhouse,
accueille des Alsaciens de passage à
Paris, bref, vit la convivialité telle
qu'elle est prévue par le règlement des
groupes régionaux.

34. Les publications de
l’association
Déjà un an après sa fondation,
le Comité de l'Association décide, en février
1898, de créer un bulletin. D'ailleurs
l'article 18 des statuts de 1896 précise
que "tout membre peut soumettre à
l'association un travail concernant la
filature, le tissage ou les industries y
attenant. Le Comité le fera imprimer aux
frais de l'association s'il en reconnaît
l'utilité. Chaque membre en recevra un
exemplaire". Le but du bulletin est
plus large, "donner l'occasion aux
membres de publier les résultats de leurs
expériences et d'en faire profiter leurs
camarades, de renseigner sur les membres
et sur la marche de l'association en vue
de constituer un lien fraternel".
Des Anciens peu participatifs et un
gouffre financier
Ce "bulletin" se présente,
en fonction de l'évolution des événements
et des besoins, sous différentes formes.
1) Les "Nouvelles de l’Association
de l'Année... Association libre des
Anciens Élèves de l'École de Filature et
de Tissage de Mulhouse Alsace"
sont éditées à partir de 1898 régulièrement
ou occasionnellement, en langue française
et en langue allemande (Annexe N°
41 et
42). En effet, l'article 29 des statuts prévoit
"qu'il sera remis annuellement à
chaque membre un bulletin contenant la
liste actuelle des membres". Cette
publication comprend les listes des
membres du Comité, des membres
honoraires, des membres du Comité des
groupes régionaux, une liste alphabétique
de tous les membres, le rapport de
l'assemblée générale, les nécrologies
(souvent une page entière par personne),
les statuts et réglement intérieur, le
rapport sur l'année scolaire établi par
la Direction de l'école, des notices et
correspondances, des appels de
cotisations, d'adhésion à l'association
et de collaboration au bulletin, des
tarifs des annonces, des comptes rendus
des groupes régionaux, des distinctions
honorifiques, une liste des anciens élèves
dont l'adresse est inconnue, etc…,
enfin, une bonne vingtaine de pages
publicitaires. Brochure de 44 à 60 pages,
format 19 x 28 xm, imprimerie BRINKMANN à
Mulhouse. (cf. plusieurs pages de publicité
de constructeurs textiles des années 1905
annexées à la fin de l'ouvrage).
2) "Bulletin de l
Association Libre des Anciens Elèves de
l'École de Filature et de Tissage Mulhouse
Alsace" est édité pendant de
nombreuses années à partir de 1898, en
allemand et en français (Annexe N°
43).
Il comprend des articles techniques sur
des problèmes de l'industrie textile et
connexes illustrés par de nombreux
dessins, schémas et photos et une
vingtaine de pages publicitaires. Le rédacteur
responsable de 1899 à 1914 est Henri
BRUGGEMANN, auteur de plusieurs livres
dont il diffuse des prospectus avec le
bulletin. A partir de 1900, pour des
raisons d'économie (ou d'arrière-pensées
politiques?) on décide de n'envoyer aux
Alsaciens qui ont suivi les cours de l'école
en langue allemande que l'exemplaire en
langue allemande. Souvent les articles
sont rédigés par des anciens élèves de
l'École. Brochure de 60 à 100 pages,
format 19 x 28 cm, imprimerie BRINKMANN à
Mulhouse.
3) "Bulletin de l’Association
des Anciens Élèves de L’École de
Filature et de Tissage de Mulhouse"
Premier Numéro de la nouvelle série française,
édition provisoire bimestrielle de 16
pages, publiée à partir de décembre
1915 par un groupe d'Anciens d'Épinal,
format 15 x 23 cm, imprimée chez KLEIN à
Épinal (Annexe N°
44). Le gérant est le
président du groupe des Anciens d'Épinal
Léon FLAMAND et le rédacteur provisoire
le lieutenant Henri BONDOIT. Dans ce
premier Numéro - nous sommes en pleine
guerre - on relève : "Notre devoir
est d'affirmer notre vitalité"... A
noter que le mot "libre" n'est
pas repris dans le titre que l'Association
s'était donnée en 1896 à Mulhouse, car
en France on est libre, on n'a donc pas
besoin de le souligner. Le service de ce
bulletin est fait gracieusement à tous
les membres de l'Association, Français et
neutres . ...
"A nos camarades : Dès la
première ligne de ce bulletin, notre pensée
va vers ceux qui, en libérant le sol de
la Patrie, nous rendront entière notre
vieille École !... Le premier devoir que
les `Mulhousiens' auront à cœur de
remplir sera de tendre une main
fraternelle à ceux que l'effroyable lutte
aura terrassés et dans l'accomplissement
de ce geste de reconnaissance, nous ferons
l'union féconde..." Dans le Livre
d'or de l'Association pendant la guerre
figurent les morts au champ d'honneur, les
blessés et les citations. Malgré la
guerre, ce bulletin paraît avec une bonne
régularité.
4) "La Revue de la Filature
et du Tissage, Bulletin Technique de
l'Association des Anciens Elèves de l École
de Filature et de Tissage de
Mulhouse" est le titre que prend
le bulletin à partir de mars 1917, avec
quelque 400 pages annuelles (Annexe N°
45
et
46). En 1919, cette revue est reprise
par le Comité central de Mulhouse qui le
confie à la direction d'un rédacteur-gérant.
On y trouve de nombreuses rubriques :
liste des membres du Comité central et de
ceux des groupes régionaux, plusieurs
articles techniques avec dessins, photos
et graphiques, service des consultations
commerciales ; à partir de 1928 on ajoute
une rubrique bonneterie, liste des
brevets, question de droit commercial et
fiscal, partie commerciale, rapport du
Directeur de l'École sur l'année
scolaire, nouvelles de l'Association avec
séances du Comité central, réunions
amicales mensuelles à Mulhouse et
ailleurs, service de placement, petites
annonces personnelles, nécrologies et, à
l'occasion, une liste des anciens élèves.
En outre, à partir de 1920, le Comité crée
un service de "consultations
techniques" qui répond, par l'intermédiaire
de la revue, à la dizaine de questions
techniques posées par les lecteurs ;
toutefois vers 1930, ce service
s'essouffle et ne fonctionne pratiquement
plus, même si, en 1935, certains
souhaitent le voir repris. Entre 1919 et
1939, la revue de 11 numéros annuels
connaît un épanouissement extraordinaire
en atteignant au cours de ces 20 ans
quelque 50.000 pages imprimées dont pas
loin de 30.000 pages rédactionnelles. Une
performance !
5) Entre 1939 et 1947, par suite de
la guerre, aucune publication imprimée ne
paraît. En février 1946, le Comité
tente de reprendre contact avec les
Anciens en envoyant à ceux dont il a
l'adresse le premier Numéro des "Nouvelles
de l'Association des Anciens Elèves de l'E.S.F.T.B.M."
sous forme d'une dizaine de feuilles ronéotypées
agrafées, format 21 x 27 cm (Annexe N°
47). Plusieurs "Nouvelles" sont
ainsi diffusées en attendant de relancer
l'édition d'une revue.
6) Avec un nouveau titre, les
"Annales Textiles"
paraissent de 1948 à 1972, d'abord en
tant que "Bulletin trimestriel de
l'Association des Anciens Elèves de l'École Supérieure de Filature, Tissage
et Bonneterie de Mulhouse" et à
partir de 1967 "de l'École Supérieure
des Industries Textiles de Mulhouse"
(Annexe N°
48 et
49). Elles comportent
quelques articles techniques originaux ou
repris ailleurs et des nouvelles de
l'Association. Brochure de 40 à 100 pages
dont une vingtaine de publicité. Format
21 x 27 cm. Impression Imprimerie de
L'ALSACE.
7) Un "Bulletin
d'Information des Membres"
(B.I.M.), organe de liaison entre les
Anciens, devait paraître
trimestriellement à partir de début 1973
sous la responsabilité d'un jeune membre
du Comité (Annexe N°
50). Il est édité
deux fois par an en ronéotypé de 1974 à
1977, puis à partir de 1978 avec
couverture imprimée et textes photocopiés.
Il comprend des comptes rendus de
l'Assemblée générale annuelle, des
informations sur l'École et sur les
enseignements, des nouvelles de
l'Association et des groupes régionaux,
des informations pratiques, un ou deux
articles techniques (habituellement publiés
par des anciens élèves dans d'autres
revues), etc… ; signe des temps, le
service de placement publie in extenso les
offres d'emploi dans chaque numéro.
Brochure de 15 à 30 pages, format 21 x
29,7 cm,
8) Un "Annuaire des anciens
élèves" de l'école est la
suite logique de la "liste des
membres" diffusée dans le
"Bulletin" de 1898 et la
"Revue" de 1917 à 1939. Il est
édité de temps à autre à partir de
1947 en petit format de 12 x 17,5 cm avec
une cinquantaine de pages, puis publié en
annexe aux Annales Textiles en 1957 avec
261 noms. En 1973, l'Institut Textile de
France a contacté l'Association pour l'édition
d'un annuaire commun à toutes les Écoles
Textiles. Mais on préfère d'abord sortir
celui de l'Association, ce qui est enfin réalisé
régulièrement à partir de 1974. Il paraît
alors annuellement en format 15 x 21 cm
avec 100 à 150 pages (avec 54 annonceurs
en 1976, 45 en 1986 et 27 en 1996) et
comprend un bref historique de l'école,
la liste nominative alphabétique des
membres actifs de l'association avec
adresse, promotion et fonction, une liste
par région et établissement, une liste
par promotion et une liste des membres
retraités (Annexe N°
51). Rédaction et
mise à jour par le secrétariat du Bureau
de l'Association.

Des hommes s'engagent
Si l'édition de ces publications a
été la fierté et la manifestation
publique de l'Association, elle représentait
aussi, de tout temps, une préoccupation
constante pour ne pas dire obsessionnelle
et parfois insurmontable pour ses
responsables. C'est une longue et
lancinante litanie de soucis : le coût,
la publicité, un local adapté, le
contenu technique, les délais - des
membres démissionnent parce que la revue
sort en retard ! - etc… Trouver des
annonceurs pour couvrir les frais
d'impression, dénicher de rares auteurs
parmi les anciens élèves qui veuillent
bien écrire des articles techniques sur
leurs expériences professionnelles, écrire
dans les deux langues, indispensable entre
1900 et 1914, et faire exécuter des
dessins et des graphiques compréhensibles,
contrôler la qualité des écrits par un
comité de lecture, dégoter l'imprimeur
assurant la meilleure qualité au meilleur
coût, n'est pas une mince affaire. Ainsi,
à l'instar des "Nouvelles de
l'Association", ce premier bulletin
est réalisé à partir de 1899 par le
secrétaire-trésorier de l'Association,
professeur de filature et sous-directeur
Henri BRUGGEMANN. Le premier bureau de
l'Association et de la Revue fut installé
pour 10 ans dans une pièce du logement de
son directeur-rédacteur BRUGGEMANN, pour
laquelle il demande 2 Mark par an de
location. En 1900 le Comité trouve exagérées
les dépenses pour les traductions et les
dessins pour la revue. Par la suite et en
vue d'un meilleur contrôle des coûts, le
Comité procède, dès 1901, à la séparation
des comptes de la revue de ceux de
l'Association. En 1903, les frais de la
revue se montent à 2.120 Mark alors que
les ressources de cotisations ne représentent
que 2.664 Mark. En 1905, les dépenses se
montent à 4.250 Mark. A la suite de la
non-parution de la revue en 1911, on relève
avec satisfaction que les biens de
l'Association avaient augmenté de 3.300
Mark en un an. Les difficultés de
publication de la revue subsistent
longtemps encore : manque de moyens
financiers et trop faible participation
intellectuelle des Anciens.
Pour surmonter ces embarras, on
essaye à plusieurs reprises de collaborer
avec des revues textiles de notoriété
nationale. Déja en 1901, des pourparlers
avec le propriétaire et rédacteur en
chef de la Leipziger Monatsschrift für
Textilindustrie échouent, de même en
1903 avec l'éditeur de Textil und Färbereizeitung
à Braunschweig. A l'inverse, en 1907 l'éditeur
italien BIVIS de Milan propose d'acheter
nos articles avec mise à disposition des
clichés, à 0,15 F la ligne, pour
publication dans sa revue italienne "Industria
Tessile". En 1909, BRUGGEMANN assure
la rédaction technique d'une nouvelle
revue textile alsacienne hebdomadaire en
langue allemande "Elsässisches
Textilblatt" (Annexe N°
52) éditée
par J. DREYFUSS à Guebwiller (format 33 x
25 cm), dans laquelle est publié le
"Bulletin de l'Association Libre des
Anciens élèves de l'École de Filature et
de Tissage de Mulhouse". D'ailleurs
BRUGGEMANN, professeur depuis 1889 et
sous-directeur depuis 1898, quitte l'École
en 1913 pour se consacrer entièrement à
la publication et à son cabinet
d'expertise textile installé rue du
Sauvage N° 76 à Mulhouse. Le même éditeur
guebwillerois DREYFUSS publie à partir de
1912 la même revue en langue française
appelée "L'Avenir Textile" à
laquelle tous les Anciens s'abonnent. Après
la guerre, notre Association n'ayant pas
voulu reconduire son contrat de
collaboration avec cette publication, cet
éditeur s'adressait aux Anciens d'Épinal
qui encartèrent leur revue dans l'Avenir
Textile (Annexe N°
53). La même année,
des pourparlers sont également entamés
avec la revue mensuelle parisienne
"L'Industrie Textile", format 31
x 24 cm créée en 1884, mais ils échouent
à cause des conditions financières désastreuses
(Annexe N°
54).
Toutefois le plus gros souci a
toujours été de trouver des articles inédits.
Leur absence provoque des interruptions de
parution. Les idées géniales et les
belles déclarations au cours des réunions
ne manquèrent pas, mais leurs concrétisations
n'en sont pas moins décevantes. Dès 1904
on essaye de payer des honoraires aux
auteurs, mais il faut vite déchanter par
manque de moyens et parce que la récolte
d'articles ne s'en trouve pas améliorée.
En 1908, on propose d'instituer des
concours sur des questions techniques en
attribuant des médailles, sans plus de
succès. La suppression de la revue est
envisagée en 1910 à cause des frais trop
élevés et du manque d' articles
publiables. Enfin en 1914, la guerre met
fin à tous ces tracas...

Vers un périodique d'audience
internationale
A partir de 1919 et jusqu'en 1939,
la revue bimestrielle fondée en 1915 par
les Spinaliens est reprise par le Comité
central de Mulhouse. Le président de
l'Association en confie la responsabilité
à un membre de son Comité qui s'en dégage
déjà au bout de trois mois. C'est
ensuite le secrétaire Robert DUBOIS qui
s'en charge en demandant au Comité de
lecture de se réunir chaque mois. On élabore
de nouveaux principes de fonctionnement de
la revue et de sa comptabilité distincte
de celle de l'Association.
En 1920 le rédacteur DUBOIS
s'occupe de la revue en abandonnant le
poste de secrétaire de l'Association.
Finalement, un an plus tard, DUBOIS, élu
entre-temps président de l'Association, démissionne
de son poste professionnel de directeur de
filature pour raison de santé et se
consacre à plein temps à la revue en
tant que gérant. Après son décès prématuré,
un autre Ancien travaille pour la revue
pendant quelques mois jusqu'à l'automne
1925 où Julien FROEHLIGER (promo 1905/06)
est embauché comme gérant. II porte à
bout de bras "sa" revue et lui
donne ses lettres de noblesse, diffusant
dans le monde entier le message de l'École. Mais les problèmes financiers
deviennent de plus en plus inextricables.
Avec l'apparition de la crise textile en
1929, de nombreux annonceurs résilient
leurs contrats, les ressources diminuent
et le compte de la revue laisse des bénéfices
de plus en plus maigres à l'Association.
En 1932, une trentaine d'entreprises
abandonnent les annonces. Les comptes de
la revue allouent pour 1931 au gérant
20.000 F, à la dactylo 1000 F et à
l'Association 9.620F, en 1934
respectivement 15.000, 300 et 2.780 F, en
1936 resp. 2.386, 300 et 0 F et en 1938,
pour la première fois depuis 1925, les
comptes accusent un solde négatif. Au 1er
septembre 1939, avec la guerre, la revue
est suspendue. Julien FROEHLIGER démissionne
début 1941 et remet les archives et le
mobilier de son bureau à l'Association.
Il décède prématurément en 1943.

Faiblesse des moyens et évolution des besoins
Dès début 1946, le Comité
reprend le projet de l'édition de la
revue technique. Le périodique parisien
"L'Industrie Textile" qu'on
avait recontacté, propose de faire paraître
notre revue encartée dans la sienne comme
bulletin spécial. Mais le Comité trouve
que notre bulletin, réalisé par nous
mais encarté dans une autre revue,
perdrait sa personnalité et son prestige.
Mi 1947, le Comité décide de confier à
Jacques WIERNSBERGER (promo 1919) et le
secrétariat et la gérance de notre
nouvelle revue qui s'appellera
"Annales Textiles" et paraîtra
trimestriellement. Des démarches auprès
des annonceurs (69 entreprises
potentielles), des difficultés
juridiques, administratives et
d'attribution de papier retardent encore
sa sortie. Enfin, début 1948, le premier
numéro est mis sous presse chez BRINKMANN
pour un coût de 85.000 E Un numéro coûtera
400 F par membre et par an. En juin 1949,
Jacques WIERNSBERGER part pour raisons
professionnelles à Thaon mais continue à
s'occuper de la revue. Il lance un appel
pressant à tous les Anciens de collaborer
à ce travail par des articles originaux,
car "diffuser du réchauffé ne présente
pas d'intérêt" souligne le
Directeur de l'École. Mais c'est un cri
dans le désert ! Bien que nous soyons une
des rares Associations à éditer un
bulletin technique parfois demandé par
des éditeurs d'Angleterre et d'Amérique,
nos efforts sont insuffisants. Avec
l'inflation galopante, il faudrait en
1952, pour couvrir les frais d'impression,
un MF de recettes. A cet effet, on
augmente le tarif d'annonce à 30.000 F la
page et les cotisations de 500 à 750F. En
1955, l'industrie textile marchant au
ralenti, le bulletin est maintenu en
veilleuse, malgré les promesses d'Anciens
du groupe Nord de remettre des condensés
d'articles techniques intéressants de la
presse technique française et étrangère.
En conséquence, la revue peu étoffée
lui fait perdre les annonceurs. A partir
de 1956 le rédacteur est secondé par une
secrétaire, Madame REINBOLD (veuve de
Robert REINBOLD promo 1925, décédé en
1955). L’année suivante, le coût
annuel de 900 exemplaires s'élève à
540.000 E. En 1961 WIERNSBERGER se plaint
"de moins en moins de substance pour
de plus en plus de publicité". Petit
à petit, les préoccupations concernant
le développement du statut de l'école et
le développement rapide de l'adaptation
de l'enseignement aux besoins de
l'industrie et de la recherche prennent le
pas sur le souci de diffuser une revue. Un
périodique textile technique particulier
ne répondant plus aux besoins du marché,
le manque de moyens financiers et de
collaboration intellectuelle devenant trop
pesant, les "Annales Textiles"
se meurent en 1972. Aucun avis de décès
au cours d'une Assemblée Générale ...
L’année suivante, le "Bulletin
d'Information des Membres", réalisé
par le secrétariat de l'Association, est
lancé. Mais ce n'est plus une revue
technique originale. Les travaux du bureau
de placement et les informations sur l'École et l'Association deviennent
prioritaires. Après le départ de Madame
REINBOLD à la retraite fin 1975, c'est
Madame Alice GEORGER (épouse de Hubert
GEORGER, promo 1947) qui prend la relève
début 1976. Depuis, le B.I.M. est publié
régulièrement.
*
*
*
Si notre Association fête ses cent
ans d'existence, ses statuts ont presque
130 ans d'âge. Bien sûr, cette suite
d'articles définissant les buts de
l'Association et réglant son
fonctionnement a subi l'outrage du temps
et a dû s'adapter aux nouveaux besoins.
Elle a dû supporter de nombreuses
attaques, dont les plus virulentes
exigeaient sa disparition ou son
changement complet. Finalement, le tronc
commun de nos statuts est resté inébranlé
et les Mulhousiens, parfois considérés
comme des provinciaux attardés, ont su
maintenir le cap contre toutes les
tendances centrifuges et les menaces de
scission.
L'Association apporte grandement
son soutien et son analyse critique et
constructive à l'École. Par ses activités
de publications et de visites
d'entreprises et d'institutions, elle
s'insère dans la vie de la Cité et complète
la connaissance du milieu socioéconomique
et culturel de notre région.
L’Association, grâce à la
convivialité qu'elle favorise, notamment
au cours des rencontres annuelles, développe
les relations humaines et permet
occasionnellement à tous les Anciens
d'effectuer leur "petite régression"
pour partager des souvenirs de jeunesse.
La gaieté et la joie des retrouvailles
d'Anciens des "bons vieux temps"
donnent l'impression que, malgré les
tribulations des époques hautement
perturbées d'autrefois, nos pères
textiliens savaient s'amuser, comme dit la
vieille chanson vinique,... "bien
autrement que nous, morbleu ! bien
autrement que nous !"
En dépit de 150 ans de crise de l'industrie
textile, avec le moral d'acier des anciens
élèves, avec la faculté d'adaptation
des responsables de l'École, notre vieille
École peut envisager l'avenir avec sérénité.

Sources
et bibliographie sommaire
Association
des Anciens Élèves de l’École
Registre
21 x 33 cm de 284 pages avec statuts 1896,
des procès-verbaux d'Assemblées Générales,
de Comités de Mulhouse, Belfort, Lille,
Épinal, etc. de 1896 à 1921,
majoritairement en langue allemande.
Registre
21 x 33 cm de 400 pages avec statuts de
1919/21, procès-verbaux des Assemblées Générales,
Comités, réunions des groupes régionaux,
etc. de 1920 à 1954 en langue française.
Revues,
bulletins et annuaires de l'Association de
1899 à 1996 :
LA
REVUE DE LA FILATURE ET DU TISSAGE de 1917
à 1939 (23 x 11 numéros)
ANNALES
TEXTILES de 1948 à 1972 (env. 75 numéros)
B.I.M.
de 1973 à 1996 (env. 50 numéros)
ANNUAIRES
de 1949 à 1996
Société
Industrielle de Mulhouse (Bibliothèque de
l'Université et de la SIM)
Bulletins
de la SIM de 1863 à 1919, 1927, 1958,
1961
Histoire
Documentaire, Mulhouse, 1902,
Centenaire
de la Société Industrielle de Mulhouse,
1926,
Revues
Textiles : L'Industrie Textile, L’Avenir
Textile, Elsässisches Textil-Blatt,
Plaquette
"Staatliche Höhere Textilschule Mülhausen",
1942,
Plaquette
École Nationale des Industries Textiles
de Mulhouse, 1982, 50 pages
Sources diverses
Bulletin
Municipal de Roubaix de mai 1881,
Écoles
textiles francophones in L’Industrie
Textile, mai 1979, pp. 450/451.
École
Supérieure de Chimie de Mulhouse,
Histoire de l'école 1822 - 1972
Historique
de l'École Supérieure des Industries
Textiles d'Épinal,
Historique
de l'Institut Textile et Chimique de Lyon,
Historique
de l'École Nationale Supérieure des Arts
et Industries Textiles de Roubaix,
LEFEBVRE
(Marcel) "Cent Ans d'histoire"
in "Centenaire de l'École Supérieure
de Filature, Tissage
et Bonneterie de Mulhouse 1861-
1961", 120 pages, ouvrage collectif,
Imprimerie L'Alsace, 1961
LIVET
(Georges) et OBERLÉ (Raymond) Histoire de
Mulhouse des origines à nos jours,
Strasbourg, 1977
OBERLÉ
(Raymond), "L’enseignement à
Mulhouse de 1798 à 1870, 1961
OBERLÉ
(Raymond), "Cent ans de construction
scolaire à Mulhouse 1831- 1939" in
Annuaire Historique de la Ville de
Mulhouse, 1990, pp. 47 à 72
SIEGER
(Pierre), "Quel gâchis!",
Construction d'une nouvelle École d'Ingénieurs
Textile, 1993, pp. 111 à 116
WAHL
(Alfred) et RICHEZ (Jean-Claude) La vie
quotidienne en Alsace entre France et
Allemagne 1850-1950, Hachette, 1993,
Du même auteur
"Foucherans,
Foi et fanatisme pendant la Révolution",
1984, 200 pages
"Histoire
de DOLLFUS & NOACK", 1985, 160
pages
"L'École
à Sausheim de 1830 à 1870", 1987,
120 pages
"Sausheim
sous la Révolution", 1989, 312 pages
"Sausheim,
Un village au temps du Reichsland (1871-
1918)", 1993, 486 pages
(en préparation)
"Brunstatt
entre les deux guerres (1918-1940)"
La
grande épopée du développement industriel
fulgurant de Mulhouse à partir du milieu du
XVIIIe siècle grâce à l'initiative de
trois jeunes pionniers, a fait l'objet de
nombreuses études. Mais on en sait moins
sur les tenants et les aboutissants de la
fondation en 1860, après plusieurs autres
écoles techniques à Mulhouse et en Europe,
d'une "École Théorique et Pratique de
Tissage Mécanique", devenue en 1868
"École de Filature et de Tissage et
installée dans des bâtiments neufs au bord
du canal de décharge de l'Ill. L'Association
des Anciens élèves, fondée après
plusieurs tentatives infructueuses en 1896,
si elle a toujours soutenu la Direction de
l'École dans les périodes de crise, s'est
aussi montrée exigeante quant à
l'adaptation de l'enseignement aux nécessités
de l'économie.
Les
quatre changements de nationalité de notre
région en l'espace de 75 ans eurent des
conséquences désastreuses sur le
fonctionnement voire sur l'existence même
de l'École et de son Association. La réalité
des évènements fut, à l'occasion, occultée
ou travestie selon l'opinion publique du
moment. Les influences économiques et
politiques ont donné lieu à des remises en
cause parfois douloureuses et à des évolutions
imprévisibles. Si l'industrie textile
alsacienne a vu fondre dramatiquement ses
effectifs en 150 ans, l'École Textile a
plus que décuplé le nombre de ses étudiants
entre 1861 et 1996.
Cet
ouvrage "défibre" de façon
minutieuse mais agréable, le fil de
l'histoire et souvent des petites histoires
de la longue vie tumultueuse de cette École
Textile et de son Association des Anciens élèves.
Le Centenaire de l'Association est
l'occasion de sa publication.
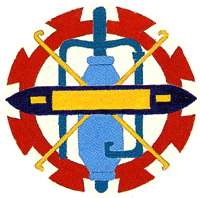
L'auteur,
Paul SPECKLIN, ancien élève de l'École
Textile, né en 1926 à Brunstatt, passe 38
ans d'activité professionnelle dans
l'industrie des textiles techniques, en
dernier lieu comme Directeur de Recherche
& Développement. En outre, il dispense
en tant que vacataire, des cours dans
plusieurs établissements d'enseignement supérieur
à Mulhouse. A partir de 1984, après une
initiation à l'étude de l'histoire sociale
à l'Université de Besançon, il publie une
demi-douzaine d'ouvrages d'histoire régionale,
tout en continuant à écrire dans des
revues techniques françaises et
internationales plus d'une centaine
d'articles sur les nontissés en Europe et
dans le monde. L'historien, membre de l'académie
d'Alsace, se passionne pour la vie mouvementée
du peuple d'Alsace, enjeu de nationalismes
opposés.
|